Les lecteurs permanents de cette revue ont certainement remarqué que le titre de cet article présente une grande similitude avec le titre du n° 30 de la Revue du MAUSS. A première vue, l’appellation de ce numéro Vers une autre science économique (et donc un autre monde) peut paraître bizarre. Effectivement, si l’on remplace le mot « économique » dans ce titre par les mots « physique », « chimique », ou « biologique », on obtient une très étrange déclaration : un autre type de physique (chimie ou biologie) nous donnera un autre monde dans lequel nous serions censés vivre, c’est-à-dire que les propriétés physiques des matériaux deviendraient différentes, les réactions chimiques se produiraient différemment, et les qualités biologiques des organismes seraient transformées. Mais si pour les sciences naturelles, cette phrase n’a pas de sens, pour la science économique, elle a une signification profonde. La clé pour la compréhension de ce sens nous donne l’institutionnalisme constructiviste [Hay, 2006]. Suivant cet institutionnalisme, la science économique fournit à la société les éléments pour le discours socio-économico-politique, et elle fait elle-même partie de ce discours qui, à son tour, influence considérablement les changements institutionnels [Hall, 1992]. Ce trait de la science économique crée pour les économistes une tentation de passer directement à ce discours (principalement à ce qui devrait être) sans consacrer assez d’attention à l’étude de la réalité (de ce qui est). Le fait que les économistes ne résistent pas à cette tentation a de graves conséquences : malgré toute leur bonne volonté, les solutions proposées et réalisées sans la connaissance des détails de la réalité soit ne donnent pas les résultats escomptés, soit provoquent très souvent des conséquences négatives inattendues. Le XXe siècle donne plein de témoignages dans ce sens.
La liaison génétique de la science économique avec l’économie politique comme branche de la philosophie morale et politique, d’où vient sa normativité [Combemale, 2007, p. 61], favorise cette précipitation des économistes. Le manifeste « Vers une économie politique institutionnaliste » publié dans le n° 30 de la revue annonce explicitement que la philosophie politique est « la forme la plus générale de la science sociale » (p. 38) et prône implicitement l’application à la science économique des pratiques de la communauté des philosophes politiques. Mon article est une tentative de convaincre les économistes de suivre plutôt les pratiques de la communauté des chercheurs des sciences naturelles. L’institutionnalisme constructiviste nous invite à ne pas céder à la tentation de passer directement au discours à propos de ce qui devrait être, mais, en partant de la vision du monde socio-économico-politique très proche de celle qui est exposée dans le manifeste mentionné ci-dessus, à se concentrer sur l’étude de ce qui est. L’institutionnalisme constructiviste nous indique également comment il faut le faire.
À l’heure actuelle, le ton dans le discours socio-économico-politique est donné par le courant dominant institutionnellement de cette science, l’économie néoclassique et ses ramifications récentes. Le manifeste et les articles qui l’accompagnent publiés dans la Revue du MAUSS représentent un appel pour élargir considérablement la place des courants hétérodoxes de cette science dans ce discours, ce qui exige d’ébranler la domination institutionnelle du mainstream. Les auteurs de ces articles admettent que le mot « institutionnaliste » dans l’appellation « économie politique institutionnaliste » remplace le mot « hétérodoxe ». Ils trouvent de l’institutionnalisme même chez les classiques. Suivant Nicolas Postel, « un paradigme hétérodoxe cohérent » doit avoir parmi d’autres éléments en commun « une ontologie commune : l’arrière-plan de l’économie est institutionnel et mouvant » [2007, pp. 97, 98]. Suivant le constructivisme social, « l’institutionnalisation se manifeste chaque fois que des classes d’acteurs effectuent une typification réciproque d’actions habituelles … chacune de ces typifications est une institution » [Berger et Luckmann, 1991, p. 72] [1]. L’institutionnalisme constructiviste voit la source des régularités sociales dans ces typifications réciproques, et de cette façon il exige d’étudier les institutions non comme l’arrière-plan de l’économie mais comme son premier plan. Ce type d’étude prévoit l’observation proche (« ethnographique ») pratiquée dans le passé par l’école historique allemande (Gustav Schmoller) et l’école institutionnelle de Wisconsin (John Commons). Les hétérodoxes actuels (post-keynésiens, marxistes, régulationnistes, conventionnalistes, socio-économistes) qui voient les institutions comme l’arrière-plan de l’économie, se contentent dans leur recherche de l’observation lointaine et n’exercent pas la collecte d’informations détaillées à propos des règles et des croyances qui les soutiennent. De ce point de vue, on peut considérer que les orthodoxes et la plupart des hétérodoxes actuels se trouvent dans le même paradigme qui ne permet pas d’obtenir une compréhension de la réalité économique suffisante pour avoir la possibilité d’expliquer les mécanismes et de prévoir l’arrivée de phénomènes comme celui de la crise actuelle. Les quelques personnes qui ont réussi à le faire ont fait leur recherche dans le cadre d’un autre paradigme, celui de l’institutionnalisme constructiviste, sans peut-être le savoir. Le passage de la communauté des économistes vers ce paradigme exigerait une réforme institutionnelle radicale de la profession. L’institutionnalisme constructiviste nous donne également les fils conducteurs de cette réforme.
Les règles qui gèrent actuellement la profession d’économiste sont fondées sur les croyances héritées des Lumières, lesquelles étaient elles-mêmes très influencées par la philosophie scholastique très étroitement liée avec la théologie [Secada, 2004]. Pour ces deux dernières, la vérité doit être cherchée non pas sur la base des contacts directs avec les objets étudiés, mais à partir de constructions abstraites déductives. On peut expliquer pourquoi ces croyances ont servi de point de départ pour la détermination des règles qui gèrent la profession d’économiste à partir de l’analyse historique de l’institutionnalisation de la profession à la fin du XIXe siècle. La profession d’économiste est née initialement au sein de l’institution de l’université. Le lourd héritage médiéval de l’institution de l’université à cette époque [Charle et Verger, 2007] en Angleterre, qui était transférée aux Etat Unis, fut l’un des principaux facteurs qui a déterminé les croyances de la profession dans le monde anglo-saxon. Un autre facteur déterminant fut l’opposition des hommes d’affaires, qui contrôlaient déjà à cette époque les universités de ces pays, aux investigations sur les problèmes courants, car il y avait de fortes chances que les études, même objectives et impartiales, puissent donner des arguments à la critique du capitalisme contemporain [Coats, 1993, pp. 439, 440]. La communauté des hommes d’affaires de l’époque a contribué à l’éradication des enseignants-chercheurs qui faisaient ce type d’investigations, et a soutenu ceux qui voyaient dans la discipline économique la continuation de la philosophie morale et politique légitimant l’ordre établi. A cette même époque, l’institutionnalisation de la discipline économique dans les universités allemandes se déroulait dans des conditions totalement différentes. C’est le jeune Etat allemand, lequel était très intéressé à la stabilité politique, qui contrôlait les universités du pays récemment unifié et non pas les hommes d’affaires, et ces universités étaient des universités « humboldtiennes », c’est-à-dire orientées plutôt vers les traditions expérimentales des sciences naturelles. Ce type de science économique fut pratiqué par la communauté des économistes allemands, présidée par Gustav Schmoller, qui travaillaient à résoudre la question sociale (Die Soziale Frage). Plus tard, cette façon de faire la recherche fut transférée aux Etats-Unis via l’école de Wisconsin de John Commons [2], école qui est à l’origine de l’élaboration du système de la sécurité sociale américaine en suivant l’exemple allemand. Le terme d’« institutionnalisme constructiviste » et son prédécesseur « l’institutionnalisme historique » sont assez récents et sont utilisés dans les sciences politiques [Rhodes, Binder et Rockman, 2006]. Pourtant ce sont les économistes Schmoller et Commons qui furent les vrais auteurs de ces directions de la pensée dans les sciences sociales. Maintenant, il s’agit de restaurer cette tradition à l’aide d’une réforme institutionnelle de la profession d’économiste.
Dans cette introduction j’explique le sens du titre de mon article. Pour finir je veux dire que j’aurais pu également intituler mon article « Pourquoi je suis un constructiviste non repentant », en suivant l’exemple de Jean-Louis Le Moigne [2001] qui, parodiant l’appellation de l’article de Marc Blaug « Pourquoi je ne suis pas un constructiviste. Confession d’un poppérien non repentant » [1994], a appelé le sien de cette façon. A mon avis, la communauté des économistes, pour être utile à la société (voire à l’humanité), doit aller non pas en direction d’une économie politique institutionnaliste mais d’une économie institutionnelle constructiviste.
Les sciences naturelles comme modèle pour les sciences économiques
Les économistes sont convaincus que dans leurs recherches ils suivent l’exemple des sciences naturelles. Pourtant trois questions se posent à propos de cette conviction. Est-ce que les représentants de la profession d’économiste connaissent vraiment comment la recherche dans les sciences naturelles se passe ? Est-ce que les membres de la communauté des économistes comprennent correctement le modèle qu’ils veulent suivre ? Et puis, est-ce que les orthodoxes et les hétérodoxes reproduisent dans leurs recherches le trait principal de ce modèle qui a assuré son énorme succès pratique ? J’oserais dire que les réponses à toutes ces questions sont négatives. Je pense que maintenant il faut se rendre compte de cette ignorance et s’adresser à ceux qui pourraient nous aider de la surmonter. A mon avis, ce sont ceux qui étudient les pratiques de recherche en sciences naturelles, en les observant de près, de la façon « ethnographique ». Une des spécialistes reconnues dans ce domaine est Karin Knorr Cetina, professeur de l’Université de Bielefeld en Allemagne. En étudiant les pratiques de recherche dans la physique expérimentale des particules et dans la biologie moléculaire, elle est venue à la conclusion que ces pratiques ne sont pas une pure exécution de certains standards de raisonnement établis par la philosophie et qu’elles ne peuvent pas être présentées comme un clair et austère progrès des vérifications (ou falsifications, ou capacités d’explication), mais plutôt comme des activités assez désordonnées des différentes expérimentations [Knorr Cetina, 1991, p. 107]. Elle nous indique le trait principal de ces pratiques : les chercheurs et les objets étudiés ensemble constituent un système comportemental où les objets ne sont pas des receveurs passifs mais réactants actifs, qui résistent aux actions des chercheurs [p. 120]. Bruno Latour, qui, comme Knorr Cetina, a une expérience très riche des études des pratiques des sciences naturelles, confirme également ce trait principal. Pour lui, l’objectivité de la recherche scientifique provient non pas du contrôle, de l’impartialité ou du désintéressement, mais d’une organisation de la situation expérimentale de telle sorte que les objets d’étude soient capables de « contester » ce qui est dit par les chercheurs à leur sujet [Latour, 2000, p. 114]. C’est cette résistance des objets d’étude aux chercheurs qui est la source de la compréhension des phénomènes étudiés. Latour critique les méthodologies des sciences sociales qui ignorent ce plus important trait de la recherche scientifique [3]. Dans ses recommandations aux chercheurs en sciences sociales il insiste sur la prise en compte de ce trait principal de la recherche scientifique [4]. Ce trait principal des sciences naturelles – l’organisation de la résistance des objets d’études aux chercheurs et l’obtention des connaissances à propos de ces objets à partir de cette résistance – est et a toujours été inaliénable dès leur naissance [5]. Cette organisation était toujours le noyau de la culture des communautés des chercheurs engagés dans ces sciences. Ce n’est pas le cas pour les communautés des économistes, d’où proviennent leurs échecs de la compréhension et de la prévision des phénomènes économiques.
La plupart des économistes pensent qu’ils utilisent dans leurs recherches la méthode de Newton. Je vais essayer de montrer que ce n’est pas le cas, car la résistance, trait principal des sciences naturelles indiqué ci-dessus, est ignoré dans ces recherches. La méthode de Newton peut être présentée comme la séquence de trois étapes : 1. la simplification du phénomène par l’expérimentation, de telle façon qu’il soit caractérisé par un petit nombre de variables quantitatives qui peuvent être mesurées précisément ; 2. l’élaboration mathématique des liaisons entre ces variables ; 3. l’expérimentation complémentaire orientée vers la vérification de l’applicabilité de ces liaisons élaborées pour d’autres domaines en essayant de les réduire à leur forme la plus générale ; dans le cas de phénomènes plus complexes, cela peut révéler l’existence de causes supplémentaires qui doivent alors être eux-mêmes l’objet d’un traitement quantitatif, et si la nature de ces causes supplémentaires reste obscure, cela peut nécessiter l’élaboration d’un appareil mathématique mieux adapté pour traiter ces causes. [Burtt, 2003, p. 221-222]. Ce qu’il faut souligner, c’est que pour Newton la recherche commence avec l’expérimentation et finit par l’expérimentation [6]. Burtt soulignait que la première étape a été pratiquement négligée par les logiciens qui prétendaient suivre Newton [p. 221]. Apparemment, c’est J.S. Mill qui est à l’origine de cette négligence que j’appelle « la maladie de Mill ». La discipline économique a été contaminée par cette maladie depuis son institutionnalisation dans la deuxième partie du XIXe siècle, et la profession d’économiste n’arrive toujours pas à se guérir de cette maladie jusqu’à nos jours.
La maladie de Mill provoque chez les économistes la croyance très profonde en la « théorie des lunettes » [7]. C’est Milton Friedman qui a exprimé cette théorie de la façon la plus explicite : « Une théorie est la manière dont nous percevons les ‘faits’, et nous ne pouvons pas percevoir les ‘faits’ sans une théorie » [1953, p. 34] [8]]. La « théorie des lunettes » provient partiellement de la spécificité des sciences naturelles. Par exemple, Galilée a étudié le mouvement des planètes dans l’espace en utilisant déjà la théorie existante de l’espace : la géométrie. Ilya Prigogine donne les explications suivantes : « Le dialogue expérimental avec la nature, que la science moderne se découvre capable de mener de façon systématique, ne suppose pas une observation passive, mais une pratique. Il s’agit de manipuler, de mettre en scène la réalité physique jusqu’à lui conférer une proximité maximale par rapport à une description théorique. Il s’agit de préparer le phénomène étudié, de le purifier, de l’isoler jusqu’à ce qu’il ressemble à une situation idéale, physiquement irréalisable mais intelligible par excellence puisqu’elle incarne l’hypothèse théorique qui guide la manipulation. Les relations entre expérience et théorie proviennent donc du fait que l’expérimentation soumet les processus naturels à une interrogation qui ne prend sens qu’en référence à une hypothèse concernant les principes auxquels ces processus sont soumis, et à un ensemble de présupposés concernant des comportements qu’il serait absurde d’attribuer à la nature. (…) Le dialogue expérimental constitue une démarche fort particulière. L’expérimentation interroge la nature mais à la manière d’un juge, au nom des principes postulés. La réponse de la nature est enregistrée avec la plus grande précision, mais sa pertinence est évaluée en référence à l’idéalisation hypothétique qui guide l’expérience : tout le reste est bavardage, effets secondaires négligeables. » [Prigogine et Stengers, 1986, p. 76-78]. La nécessité de ce type de procédé provient du fait que la nature est muette. Voilà pourquoi on ne peut l’interroger qu’en utilisant la langue théorique développée par les chercheurs. Par contre, les objets des sciences sociales en général, et économiques en particulier, sont les êtres humains qui ne sont pas muets, et dont les chercheurs sont capables de comprendre la langue. Toutes les pratiques sociales sont inévitablement verbalisées, et le chercheur doit se plonger dans cette verbalisation, c’est-à-dire qu’il doit étudier les règles écrites (par exemple les lois) et apprendre à partir de contacts directs avec les acteurs les règles non écrites (règles informelles). Ce qu’il doit également faire, c’est étudier les croyances qui se trouvent derrière ces règles formelles et informelles. On peut aussi apprendre ces croyances à partir de l’étude des sources écrites (les ouvrages des idéologues et les discours publiés des acteurs politico-économiques) et des interviews, des observations participantes et/ou des recherches-actions. Suivant la méthodologie constructiviste l’obtention de l’information à propos des règles et des croyances qui les soutiennent, ou autrement dit de la « connaissance » sociale des acteurs, est essentielle pour la compréhension de la réalité économique car les sources de ses régularités sont ces règles et croyances. La présentation des résultats de la recherche dans le cadre de cette méthodologie, qui tire son origine des pratiques de recherche des écoles de Schmoller et de Commons, prend la forme d’une description riche (thick description) comprenant la description des faits (les pratiques de l’application des règles et des discours qui les légitiment), accompagnée par l’analyse [9].
La vision du monde de Newton est plutôt statique, déterministe et mécaniste : « La théorie newtonienne, et sa foi dans l’approche rationaliste et mécaniciste pour résoudre toutes les énigmes humaines, est rapidement adoptée par les classes moyennes bourgeoises du XVIIIe siècle : c’est le siècle des lumières » [Forti A. et al., 1996, p. 15]. La
méthodologie de Newton a donné des résultats extraordinaires dans le développement des technologies parce que cette vision était suffisante pour le développement de systèmes relativement simples. Cette méthodologie devient inadéquate dès que l’on veut étudier des systèmes plus complexes : « L’étonnante avancée des sciences naturelles pendant les deux derniers siècles est due surtout au succès de leurs applications pratiques. La science s’est toujours associée davantage à la technologie, toujours moins soucieuse de comprendre la véritable nature profonde de notre être […] Il est certain que si nous voulons survivre dans un monde en changements constants et rapides, il nous faut connaître les paradigmes de la nouvelle science et abandonner les certitudes de Newton et de ses épigones » [p. 17,19].
Schmoller a pris très au sérieux le schéma de Newton, mais il l’a transformé à partir des spécificités de la recherche socio-économique. Dans ses ouvrages méthodologiques, Schmoller a fait plusieurs références à Wilhelm Dilthey, et on peut dire que sa méthodologie est très influencée par l’approche interprétative/herméneutique. Actuellement, les courants
importants de la sociologie et de l’anthropologie sociale sont fondés sur cette approche. Bruno Latour s’exprime à propos du travail des sociologues/anthropologues de la façon suivante : « Notre business à nous, ce sont les descriptions. Tous les autres font du trafic de clichés. Enquêtes, sondages, travail de terrain, archives, documentaires, tous les moyens sont bons - on y va, on écoute, on apprend, on pratique, on devient compétent, on modifie nos conceptions. C’est vraiment très simple : ça s’appelle le travail de terrain. Un travail de terrain produit toujours de nombreuses descriptions nouvelles [...] Je dirais que si votre description a besoin d’une explication, c’est que ce n’est pas une bonne description, voilà tout. Seules les mauvaises descriptions ont besoin d’une explication [...] Dans notre discipline, le texte n’est pas une histoire, une belle histoire, c’est l’équivalent fonctionnel du laboratoire. C’est là où on fait des tests, des expériences, et des simulations » [Latour, 2006, p. 213, 214, 217]. De cette façon, le travail de terrain dans la recherche socio-économique est équivalent à la première étape de la recherche chez Newton.
En opposition à Newton, la méthodologie en provenance de Schmoller refuse dans cette première étape de réduire les phénomènes à leurs plus simples éléments, mais on observe chaque situation dans sa totalité. La principale caractéristique du travail de terrain est le contact direct du chercheur avec les acteurs. Même si la simplification par l’expérience dans le cadre de la première étape de la recherche a lieu, elle prend une autre forme que chez Newton ; celle du choix des acteurs qui voudront bien répondre sincèrement aux questions posées par le chercheur et de l’ambiance dans laquelle ces questions seront posées. Le succès de cette étape dépend de l’existence de relations de confiance entre l’acteur et le chercheur. La deuxième étape de la recherche socio-économique suivant la méthodologie de Schmoller est la description du phénomène étudié à partir de l’enquête réalisée. Schmoller a anticipé la notion de description riche (thick description) proposée par Clifford Geertz [1973] ; Schmoller indiquait qu’« observer des phénomènes économiques c’est rechercher les motifs des actions économiques qui s’y rapportent, et leurs résultats, leur marche et leur effet » [1902, p. 269]. Cette description joue le même rôle que le modèle mathématique dans le schéma de Newton. Elle donne la possibilité de faire le travail d’analyse pour comprendre le phénomène en question et même pour prévoir son développement ultérieur. Comme le dit Latour, elle sert de laboratoire. Dans la troisième étape, la méthodologie en provenance de Schmoller et Commons, après la description initiale réalisée, prévoit la continuation du travail de terrain dans d’autres endroits pour vérifier l’applicabilité plus générale de la compréhension obtenue lors de la deuxième étape. Cette compréhension peut être corrigée grâce à ce travail de terrain additionnel. Une autre forme de cette troisième étape pratiquée par Commons est l’application de la recherche-action. Dans ce cas, les chercheurs, ensemble avec les acteurs, essaient de faire des changements dans le domaine étudié. Michel Wieviorka caractérise cette forme de travail de la façon suivante : « Le chercheur, ici, intervient à des fins de changement, il entend en même temps produire un savoir et contribuer à transformer la situation et les relations entre acteurs. Sa recherche est effectuée dans des situations réelles, au sein d’un groupe concret, dans une entreprise par exemple, avec l’idée que la recherche et l’action, la production de connaissances et le changement concret relèvent d’une seule et même activité pratique » [2008, p. 106]. La recherche-action peut être non seulement à la troisième étape de la recherche, mais également lors de la première étape. La méthodologie de Schmoller et Commons peut être caractérisée comme une méthodologie expérimentale [10].
Les économistes ont totalement déformé le schéma de Newton. Cette déformation a été très bien exprimée par un groupe de professeurs français d’économie dans leur réponse à la lettre ouverte des étudiants normaliens (le Monde du 17 juin 2000) qui protestaient contre les pratiques de l’enseignement de l’économie dans les universités françaises, réponse dans laquelle la triade de Newton est remplacée par une autre triade dite « de la démarche scientifique traditionnelle » :
« Il nous semble en effet important que l´économie garde une méthode conforme à la démarche scientifique traditionnelle, laquelle peut se décrire par un enchaînement en trois temps du raisonnement :
- l´identification et la définition précise des concepts et des comportements qui caractérisent l´activité économique (consommation, production, investissement...) et l’énoncé des hypothèses de base relatives à ces comportements ;
- la formulation de théories ayant comme mode d´expression la formalisation de liens fonctionnels entre les éléments précédemment identifiés ;
- la vérification de ces théories par l´expérience. Jusqu´à preuve du contraire [11], en économie cette expérience ne peut être constituée que par la confrontation à l’histoire quantifiée par la statistique et l’économétrie. » (« Contre-appel pour préserver la scientificité de l´économie » paru dans Le Monde de l’Economie daté du mardi 31 octobre 2000).
Comme on le voit, ils ne commencent pas, comme Newton le faisait, par l’expérimentation, mais comme le suggérait Mill, par la définition de concepts. De cette façon, la « résistance » sous forme de vérification dans leur troisième étape ne provient pas de l’objet réel, mais d’un objet imaginaire d’où proviennent les mondes imaginaires des théories économiques enseignées aux étudiants et contre lesquelles ils se révoltaient. Cette substitution de l’objet réel par un objet imaginaire dévalorise totalement la vérification de la troisième étape. Cette vérification peut prouver tout et son contraire. Bien sûr les auteurs de ce contre-appel sont des économistes orthodoxes, mais beaucoup d’économistes hétérodoxes basent leurs recherches sur une triade qui ne diffère pas beaucoup de celle-là, avec la seule différence que les modèles quantitatifs sont remplacés par les raisonnements qualitatifs. Les deux courants croient profondément dans la « théorie des lunettes » et oublient souvent totalement dans leurs recherches la troisième étape. Même si les hétérodoxes basent leurs recherches sur les observations, ces observations sont réalisées « de trop loin » et les institutions sont vues dans ces recherches comme l’arrière-plan de l’économie. C’est pour cela qu’ils ont besoin de « lunettes théoriques » pour « voir la réalité ».
La méthodologie constructiviste de Schmoller et Commons prévoit de faire des observations « de près » (« ethnographique »), et comme nos « objets » parlent, les chercheurs qui suivent cette méthodologie n’ont pas besoin de « lunettes théoriques ». La soit disant « démarche scientifique traditionnelle » en provenance du siècle des Lumières peut être comparée avec la méthodologie constructiviste dans le tableau suivant :
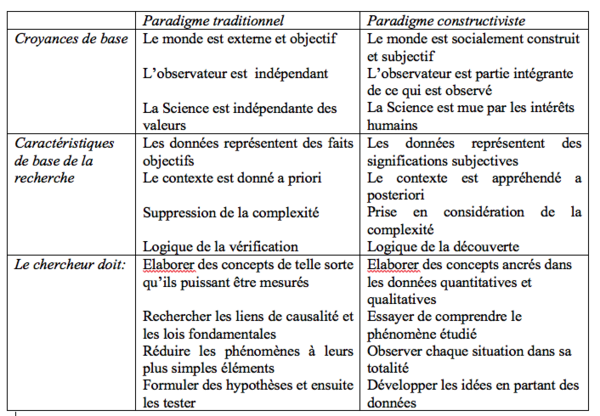
J’aimerais seulement faire un commentaire sur la ligne de ce tableau concernant l’élaboration des concepts. Actuellement, il y a une abondante littérature à propos de la théorisation ancrée (Grounded Theory) [Bryant et Charmaz, 2007]. Mais la question se pose de savoir si l’utilisation de notions spéciales créées à l’intérieur de la communauté des économistes est absolument nécessaire dans la recherche économique ? A mon avis, non ; on peut s’en passer. Très souvent, la création et l’utilisation des notions n’avancent pas la compréhension et créent des obstacles pour le dialogue en dehors de la communauté des économistes. Je pense que souvent ces obstacles sont créés à dessein pour donner une image de scientificité.
L’institution des sciences naturelles versus l’institution des sciences économiques
Les Lumières nous ont laissé l’héritage de la représentation totalement faussée de la recherche scientifique. Le dualisme cartésien, qui est à l’origine de cette représentation, sépare l’objet du sujet, le fait de la valeur, la théorie de la pratique, la réflexion de l’action, le raisonnement du l’observation, la déduction de l’induction ([Bush, 1993, p. 65], (Mini, 1994, p. 39] . Suivant cette tradition dualiste, les doctrines mutuellement exclues et opposées, telles que l’empirisme et le rationalisme ou le matérialisme et l’idéalisme, étaient élaborées. En dépit de toutes les différences entre ces doctrines, elles partagent la même représentation de la recherche scientifique présentée ci-dessous sur la Fig. 1.
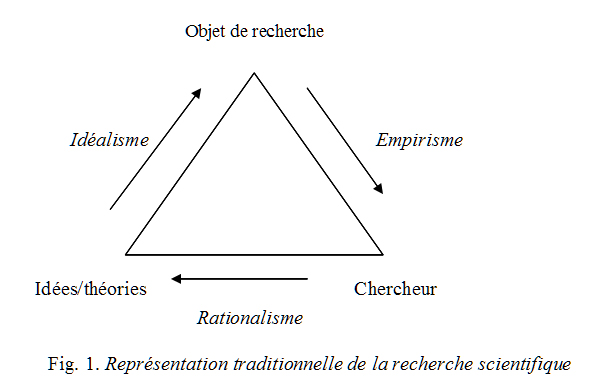
Cette représentation est basée sur la séparation nette de l’objet de recherche et du chercheur, ainsi que sur l’individualisme du processus de la recherche scientifique. Suivant les doctrines, trois éléments de cette représentation - objet de recherche, chercheur et idées/théories – sont liés différemment. L’empirisme considère les liens entre ces éléments de la façon suivante : objet de recherche → chercheur → idées/théories. Le rationalisme voit les liens entre ces éléments différemment : chercheur → idées/théories → objet de recherche, d’où provient la théorie des lunettes. Le positivisme de Comte hésitait entre ces deux visions, ce qui a permis à John S. Mill à annoncer que l’économie politique ne doit être rien d’autre qu’une science abstraite. L’idéalisme a proposé les suivantes liaisons entre les éléments : idées/théories → objet de recherche → chercheur, et le matérialisme a tourné la direction des flèches dans le sens inverse. Les partisans de ces différentes doctrines en sciences sociales, qui partagent cette représentation traditionnelle de la recherche scientifique en provenance des Lumières, sont condamnés à la stérilité cognitive car elle oriente leur attention dans les fausses directions de constructions d’hypothèses et de théories a priori, de vérifications ou de falsifications, au lieu de l’organisation de situations expérimentales où les objets d’études pourraient résister aux idées et aux théories des chercheurs à leur sujet. La représentation de la recherche scientifique en provenance des Lumières réduit ladite méthode scientifique à la méthode hypothético-déductive qui fait l’accent sur la vérification (testing) [12]]. La vérification dans le cadre de la représentation traditionnelle de la recherche scientifique n’ajoute pas beaucoup du réalisme à la recherche, car la « vérification » des constructions purement mentales coupées du mouillage dans la réalité prouve tout et rien [13].
La Figure 2 ci-dessous reflète la représentation constructiviste de la recherche scientifique. L’objet de recherche et le chercheur avec ses « instruments » ne sont pas séparés, mais ils constituent ensemble la situation expérimentale. Cette représentation prévoit que le destin des idées et des théories, qui sont construites sur la base des observations et des expériences par le chercheur, n’est pas déterminé exclusivement par les vérifications et/ou falsifications de la communauté des chercheurs mais par une communauté plus large d’ évaluateurs. En plus des membres de la communauté scientifique, cette communauté comprend des administrateurs, des politiques et des segments concernés du public.
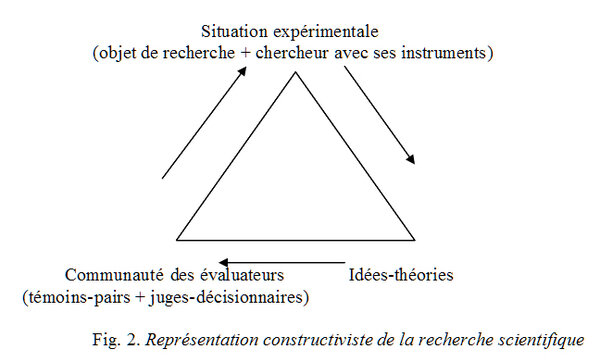
Les évaluateurs peuvent être divisés en deux catégories : les témoins et les juges. La différence entre ces deux catégories consiste dans leurs rôles respectifs dans la procédure des évaluations : les premiers expriment juste leur opinion à propos des idées et des théories évaluées et les seconds, prenant ou ne prenant pas en considération ces opinions, prennent les décisions concernant le destin des idées et des théories et de l’avenir de la situation expérimentale elle-même. La plupart des membres de la communauté scientifique, sauf ceux qui détiennent le pouvoir dans cette communauté, rentre dans la catégorie des témoins. La représentation constructiviste de la recherche scientifique ne conduit pas vers le relativisme et ne contredit pas à l’objectivité de la recherche si la situation expérimentale est construite de telle façon que l’objet d’étude soit capable de « résister » aux idées et aux théories exprimées par le chercheur à son sujet. Si dans la représentation traditionnelle de la recherche scientifique le chercheur était seul dans la quête de la vérité comme d’une copie plus en moins exacte de la réalité, dans la représentation constructiviste c’est la communauté scientifique qui cherche à trouver un accord à propos des idées et des théories qui exigent encore une approbation par les membres influant de la communauté des évaluateurs. C’est l’institution de chaque discipline scientifique qui détermine les règles de cette évaluation. Le point de départ de ces règles dans les sciences naturelles est la « résistance » des objets d’étude aux idées et théories évaluées. Cela n’est pas le cas dans les sciences économiques. A l’heure actuelle, la majorité des économistes ne considèrent pas dans leurs recherches les acteurs comme leurs objets d’étude, qui sont porteurs des règles et des croyances à propos de ces règles. Dans la plupart des cas ils ignorent les détails des institutions, en les considérant au mieux comme un arrière-plan de l’économie, et ils concentrent leur attention sur les caractéristiques quantitatives ou/et qualitatives plus au moins synthétiques de l’économie. De cette façon, la source des régularités en économie (les règles et les croyances qui les soutiennent) n’est pas mise au centre de la recherche, d’où proviennent leurs maigres résultats.
La divergence institutionnelle radicale entre les sciences naturelles et les sciences économiques s’explique par les différences dans les processus historiques de leur institutionnalisation. L’institution de la science économique était née au sein de l’institution de l’université. Du XIIIe jusqu’au XIXe siècle, l’activité de l’université était basée sur l’idée que « tout le savoir accessible reposait sur un certain nombre de textes, d’« autorité » vénérables, héritées de l’Antiquité, et que tout progrès dans le savoir ne pouvait dériver que d’une exégèse plus approfondie de ces textes » [Charle et Verger, 2007, p. 10]. La véritable formation était obtenue en dehors de l’université et « le grade universitaire valait avant tout comme brevet d’appartenance sociale, geste d’allégeance à l’ordre politique imposé » [p. 56]. Même si le nombre important des penseurs sont passés par l’université, « c’est généralement hors de l’université qu’ils ont élaboré leurs œuvres majeures ou fait leurs découvertes » [p. 53]. Ce sont les sociétés savantes qui ont servi de berceaux de l’institution des sciences naturelles. Ces sociétés représentaient des formes organisationnelles alternatives aux universités. Les nouvelles sociétés savantes avaient pour but de fournir une forme organisationnelle nouvelle, adaptée à la nouvelle pratique de l’obtention des connaissances par l’expérimentation ; elles étaient tournées vers la production de connaissances nouvelles, et non pas vers le maintien et les commentaires de vieux textes. Ces sociétés savantes – et c’était central pour leur identité – essayaient de lier le progrès de la science aux affaires sociales et non pas exclusivement aux préoccupations savantes ou religieuses [Shapin, 1996, p. 133].
La liaison entre la science et l’université a été créée initialement en Allemagne au XIXe siècle par la réforme de Wilhelm Humboldt [14]. A la fin du XIXe siècle quand l’institutionnalisation de la science économique en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis a eu lieu, les programmes d’études des universités anglaises et américaines étaient dominés par l’enseignement basé sur les sources antiques et la Bible. C’était le facteur décisif de leur institutionnalisation comme de discipline enseignée aux universités suivant leurs traditions scholastiques. Au contraire, en Allemagne la science économique était institutionnalisée au sein de la nouvelle université de recherche dans laquelle l’approche expérimentale était hautement appréciée. Le nouvel Etat allemand était très intéressé dans l’unité nationale et la crise politique du capitalisme de la fin du XIXe siècle créait des dangers pour cette unité. La communauté des économistes allemands était encouragée et soutenue par l’Etat dans son engagement de contribuer à la solution de la « question sociale ». La première association professionnelle des économistes, Der Verein für Sozialpolitik, (l’Union pour la politique sociale) était créée en 1873 pour mobiliser la profession pour la solution de ce problème. Le fondateur de cette Union, Gustav Schmoller, peut être considéré comme le fondateur de la Nouvelle école historique allemande, qui se différenciait de l’ancienne école historique par cet engagement et l’approche expérimentale de recherche largement pratiquée sur la base organisationnelle de l’Union pour la politique sociale [15].
l’Union pour la politique sociale « était conçue comme un organisme tourné exclusivement vers la recherche de la question sociale pour fournir l’information générale dérivant de cette recherche scientifique, et avant tout, les informations pratiques visant à la réforme, à l’usage des partis politiques, du public, du législateur et des fonctionnaires de l’Etat, dont il était espéré qu’ils utiliseraient cette information ‘scientifique’ comme bases de leurs décisions, et de cette façon qu’ils ne seraient pas aveuglés par le brouillard de la ‘science économique partisane’ » [Grimmer-Solem, 2003, p.179]. L’activité de l’Union était basée sur l’idée que les sciences économiques et sociales doivent appliquer la même approche expérimentale que les sciences naturelles. Les membres de cette union croyaient également que la source des régularités sociales est l’existence de règles communes pour les acteurs, et que ces règles sont liées étroitement avec les croyances qui les légitiment (c’est-à-dire les croyances qui expliquent ces règles et les justifient). Ces règles et croyances ne peuvent pas être présentées quantitativement, et c’est pour cette raison que les méthodes utilisées par les économistes de cette école étaient qualitatives, méthodes actuellement utilisées activement en sciences humaines et sociales [Mucchielli, 1996]. L’accent dans ces méthodes est mis sur les descriptions, ce qui est tellement mal vu actuellement par les économistes. Ces derniers ne sont pas au courant des pratiques expérimentales des sciences naturelles dans lesquelles la description minutieuse du déroulement de l’expérience est une partie centrale de l’expérience. La différence de la science économique pratiquée par la Nouvelle école historique allemande de Schmoller avec certaines sciences naturelles réside dans le fait que cette description est plutôt quantitative et non pas qualitative, mais cela est dû à la différence des objets d’étude (naturels et sociaux). Nous verrons plus loin que l’absence de la compréhension profonde des règles et des croyances partagées comme seule source des régularités sociales menait la plupart des courants de la pensée économique à simuler dans les sciences naturelles leur apparence ontologique (leur caractère quantitatif) plutôt que leur approche épistémologique (leur caractère expérimental).
Grâce à l’Union pour la politique sociale dans la communauté des économistes allemands de l’époque, une bonne pratique professionnelle était identifiée avec la recherche empirique. Cette Union guidait et organisait la recherche économique par l’intermédiaire de comités en charge de l’élaboration des programmes de conférences annuelles. Ces conférences n’étaient pas de simples réunions des membres d’une profession partageant entre eux les résultats de leurs recherches (ce qui est le cas de la plupart des associations d’économistes actuelles). Ces conférences étaient des lieux de débats à propos d’études commanditées : « Avant les conférences, le comité exécutif de l’Union tenait des réunions pour nommer et voter les sujets qui seront discutés durant les conférences. Des ensembles de questions étaient alors soulevées, et des paramètres pour la recherche et le travail de terrain étaient établis (en cas d’enquêtes, des questionnaires détaillés étaient élaborés et diffusés) par un expert commandité, et progressivement, par un groupe d’experts. Les résultats de ces investigations et enquêtes devaient ensuite être compilés en études récapitulatives que l’on faisait circuler avant les conférences […] Après les conférences, les études commanditées étaient publiées dans une série de monographies de l’Union, Schriften des Verein für Sozialpolitik […] Pour avoir une idée de l’échelle des recherches effectuées par cette Union, en 1914 il fut publié quelques 140 volumes de ces monographies d’environ 350 pages chacune » [Grimmer-Solem, 2003, p. 69 -70]. Dans bien des cas, l’Union recevait un support financier des ministères pour la collecte des données [Tribe, 2002, p. 12]. Les résultats des investigations des économistes allemands affiliés à cette Union étaient publiés dans plusieurs revues académiques comme la revue de Schmoller, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich (Annales de législation, d’administration et d’économie dans l’Empire allemand) et la revue Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Annales d’économie nationale et de statistiques), dont les éditeurs en chef étaient Bruno Hildebrand et Johannes Conrad.
Les membres de cette Union n’étaient pas exclusivement des professeurs d’université, mais la profession d’économistes se définissait comme la profession des professeurs en économie des universités publiques. Les chaires d’économie existaient en Allemagne dès le XVIIIe siècle [16]. Les bénéficiaires de l’enseignement de l’économie étaient les étudiants en droit pour lesquels les cours d’économie étaient obligatoires. La spécialisation en économie pouvait être effectuée en doctorat. Le passage par un doctorat était une exigence formelle pour les futurs professeurs universitaires ainsi que pour certains types de fonctionnaires de l’administration publique, par exemple les employés des départements statistiques qui étaient employés à partir des années 1830. L’obtention d’un emploi pour les titulaires d’un doctorat en économie dépendait des contacts formels et informels, ce qui « a ajouté au pouvoir et à l’influence de professeurs comme Schmoller, capables d’attribuer des thèmes de doctorat à un nombre grandissant d’étudiants et d’attirer les fonds publics pour la réalisation de ces recherches » [Tribe, 2002, p. 4]. Les professeurs d’économie dans les universités allemandes étaient des fonctionnaires de l’état, et les décisions concernant leur sélection étaient prises par le ministère de l’éducation. Néanmoins les membres influents de l’Union pouvaient influencer cette sélection [17]. La place de l’enseignement économique dans l’université allemande à la fin du XIXe siècle se trouvait « sécurisée » par sa place dans le programme d’étude en droit [p. 2].
Cette nouvelle école allemande d’économie, sous la direction de Schmoller, a rompu totalement avec la méthodologie scholastique de la science économique en provenance de la philosophie morale et politique. La confrontation de la méthodologie de Schmoller, qui a suivi les traditions des sciences naturelles, avec la science économique qui a suivi la méthodologie de John S. Mill, était inévitable, et elle a pris la forme de la dispute des méthodes (Methodenstreit) entre Gustav Schmoller et Karl Menger. Cette dispute a démarré avec la publication par Schmoller [1883] de l’article critiquant le livre méthodologique de Menger [1883]. Dans cet article, il indiquait les divergences de sa méthodologie avec celle de Menger. Sa méthodologie apportait des réponses différentes de celles de Menger aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce que la science économique doit étudier ?
2. Quels types de résultats doit-elle obtenir ?
3. De quelle façon ces résultats doivent-ils être obtenus ?
4. Quelle est la différence entre les recherches théoriques (fondamentales) et les recherches appliquées ?
5. Quelles sont les liaisons de la science économique avec les autres sciences sociales et humaines ?
Suivant Menger, il faut étudier l’échange entre les agents économiques qui composent l’économie nationale. Schmoller était convaincu que les institutions font le squelette du corps économique, et c’est pourquoi les économistes doivent étudier en premier lieu les règles et les croyances légitimant ces règles pour comprendre la réalité socio-économique. Le fondateur de l’école autrichienne pensait que ce sont les lois économiques universelles qui doivent être cherchées comme résultats de la recherche économique. Le leader de la Nouvelle école historique allemande était sûr que l’économiste ne peut compter comprendre que des réalités particulières situées dans l’espace (pays) et dans le temps (époque), sans aucune prétention à l’universalité. Suivant Menger, l’économiste doit découvrir des lois universelles par la déduction, sur la base de constructions abstraites à partir de suppositions simplificatrices. La méthodologie de Schmoller préconisait au contraire que la compréhension de la réalité économique ne peut être obtenue qu’à partir des descriptions détaillées historiques du fonctionnement des organisations et des institutions économiques, de l’ensemble des règles que les acteurs suivent, ainsi que des systèmes religieux (idéologiques) dans lesquels les acteurs croient. Ces descriptions doivent servir de base pour l’analyse menant à la compréhension des phénomènes économiques. Menger estimait comme inadmissible le mélange des recherches théoriques et appliquées. Les recherches de Schmoller avaient une orientation très pratique pour la réalisation des réformes sociales en Allemagne. Enfin, la science économique de Menger était totalement autosuffisante : toutes les énonciations à propos de l’homme, des groupes et de la société étaient élaborées (postulées) à l’intérieur de la science économique, sans le recours aux autres sciences humaines et sociales. Schmoller a critiqué Menger pour le fait que ce dernier ne connaissait apparemment pas les grands succès de son temps dans les domaines de la psychologie, du droit, de l’éthique qui avaient déjà tant contribués à la découverte des mystères de la vie mentale et des phénomènes psychiques de masse, et il lui paraissait impossible pour les économistes de les ignorer. Schmoller identifiait surtout la psychologie et l’anthropologie comme les bases de toutes les autres sciences humaines. Selon lui, c’est sur la base de la psychologie et l’anthropologie, à travers les sciences de la culture et de l’organisation sociale, que l’on peut résoudre le problème de la compréhension de la liaison historique des états sociaux successifs. La dispute des méthodes à l’époque de l’institutionnalisation de la science économique concernait la question principale de cette institutionnalisation : quelle méthodologie (les règles de recherche) sera mise à la base de cette institution ? Nous pouvons dire à l’heure actuelle que Gustav Schmoller a suivi dans ses recherches trois exigences pour la recherche économique : les institutions ont leur importance, les idées ont leur importance et les détails ont également leur importance (institutions matter, ideas matter and details matter [18]).
La dispute des méthodes entre Gustav Schmoller et Carl Menger peut être considérée comme un renouvellement d’une dispute similaire qui avait eu lieu plus de deux siècles auparavant entre Robert Boyle, l’un des créateurs de la Société royale de Londres pour l’amélioration du savoir naturel (Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), créée en 1660, et Thomas Hobbes. Les activités de Verein für Sozialpolitik et de la Royal Society étaient en plusieurs aspects similaires : elles consistaient en la collecte des données dans le cadre de situations expérimentales, en l’élaboration de rapports détaillés et en l’évaluation collective des résultats obtenus ([Shapin and Schaffer, 1985], [Grimmer-Solem, 2003]). Boyle insistait sur l’importance des témoignages honnêtes à propos des expériences dans le processus de la recherche scientifique et sur l’absence d’idées préconçues, et spécialement d’apports théoriques dans l’organisation des expérimentations [Shapin and Schaffer, 1985, p. 68]. Il est peu connu maintenant que Hobbes n’était pas seulement un philosophe politique mais également un physicien (natural philosopher). Il critiquait le mode expérimental de production de la connaissance et insistait sur les méthodes rationalistes de l’obtention des connaissances. Menger avait la même opinion à ce sujet. Les deux procédaient à partir des définitions par la voie des déductions pour arriver aux conclusions. Pour Hobbes et Menger, c’est la géométrie qui servait de modèle pour la science, laquelle fournissait une connaissance irréfutable et incontestable [p. 100]. Au contraire, la Royal Society se proclamait elle-même comme ‘l’union des yeux et des mains’ [p. 78]. Hobbes pensait que la connaissance des faits pouvait être utile dans l’obtention des connaissances, mais cela ne donnait pas la certitude et le consentement dans la communauté des savants [p. 102]. Boyle a gagné la dispute et Schmoller a perdu. On peut se poser la question de savoir pourquoi ? La devise de la Royal Society, Nullius in Verba (la démonstration par les faits et non pas par les paroles), est devenue la règle de base de l’institution des sciences naturelles, le plus important élément de la culture scientifique. Dès le départ, l’activité des chercheurs qui suivaient cette règle n’était pas en contradiction avec les intérêts des groupes détenant le pouvoir, et plus tard, ces groupes se sont même intéressés à l’application de cette règle compte tenu des résultats pratiques profitables obtenus et escomptés. Par contre, les groupes au pouvoir au XIXe siècle (à cette époque c’étaient déjà les hommes d’affaires) s’opposaient à l’application de l’approche expérimentale dans la science économique car ils voyaient pour eux dans cette application le danger de fournir, sur la base de cette recherche, des éléments supplémentaires pour la critique du capitalisme contemporain [19]. A contrario, ils étaient très intéressés dans la production et l’enseignement de constructions théoriques abstraites qui justifiaient le laissez-faire [Coats, 1993]. Ce type de constructions correspondait bien aux traditions scholastiques des universités. Dans le cadre de ces traditions, les mathématiques étaient considérées comme le sommet de l’approche scientifique.
La Royal Economic Society créée en Angleterre en 1890 par Alfred Marshall était d’une nature absolument différente de l’Union pour la politique sociale allemande (Verein für Sozialpolitik) : son principal objectif était la publication d’une revue. Les quelques économistes anglais, comme William Cunningham [1894], qui voulaient suivre l’exemple allemand, furent frappés d’ostracisme. Ni l’Etat britannique ni la communauté des affaires n’étaient intéressés dans la recherche économique empirique. Les approches allemande et britannique se trouvèrent confrontées aux Etats-Unis. L’American Economic Association, créée en 1885 par Richard Ely, fervent partisan de l’approche allemande, s’est finalement transformée dans une association similaire à la Royal Economic Society. La continuation et le très brillant développement aux Etats-Unis de l’institutionnalisme du Wisconsin [Rutherford, 2006], suivant la tradition de la science économique née en Allemagne, étaient dus à un extraordinaire concours de circonstances : l’arrivée de Richard Ely, et de son étudiant John Commons, dans le Wisconsin où la volonté politique du gouverneur Robert La Follette, un des leaders du mouvement progressiste soutenu par le Président Théodore Roosevelt, avait créé des conditions institutionnelles très favorables pour la recherche économique expérimentale par les chercheurs de l’université du Wisconsin ([Commons, 1964], [Ely, 1938], [Harter, 1962]).
A l’heure actuelle, la science économique (economics) et la (les) théorie(s) économique(s) sont considérées comme synonymes. Faire de l’économie signifie créer ou améliorer des théories économiques, et enseigner l’économie signifie transférer des théories économiques aux étudiants. L’héritage de Schmoller et Commons n’est pas leurs théories, qui peuvent être considérées comme obsolètes, mais leur vision constructiviste des réalités économiques et leur méthodologie expérimentale de recherche et d’enseignement. Leurs écoles ont obtenu des résultats pratiques très importants en utilisant cette méthodologie pour la résolution de ladite question sociale par le lancement des systèmes de sécurité sociale en Allemagne et aux Etats-Unis. Ce type de méthodologie peut être utilisé dans n’importe quel autre domaine socio-politico-économique, comme par exemple la régulation financière. L’institution de la science économique renouvelée doit être fondée sur cette vision et cette méthodologie. Le déclin et la disparition des traditions de Schmoller et Commons sont dues avant tout non pas à des raisons « scientifiques » (l’absence de « résultats scientifiques tangibles », et la « supériorité scientifique » de l’école néo-classique), mais aux intérêts des personnes avec le pouvoir qui désiraient que la discipline économique enseignée dans les universités soit la continuation de la philosophie politique et morale légitimant (expliquant et justifiant) l’ordre social établi.
La crise économique et politique de l’entre-deux guerres ne pouvait pas être sans influence sur la communauté des économistes allemands. La Verein für Sozialpolitik a été dissoute en 1936 avec l’arrivée au pouvoir des Nazis. Après la Deuxième Guerre Mondiale, la présence militaire de l’U.R.S.S. en Allemagne de l’Est et celle des Etats-Unis en Allemagne de l’Ouest ont prédéterminé le règne de l’économie politique marxiste-léniniste [Mittag, 1969] dans une partie de l’Allemagne et de l’économie néo-classique dans l’autre. Au moins à partir de la chute du mur de Berlin « l’économie néo-classique était et est toujours dominante en Allemagne […] Tout récemment encore on disait que ‘Schmoller était condamné et fustigé à jamais » [Peukert, 2002, p. 72].
Aux Etats-Unis à partir du milieu du XIXe siècle « les membres de l’école dite cléricale des économistes académiques […] travaillaient étroitement avec un groupe de puissants et riches hommes d’affaires. Leur objectif commun était l’installation du système de la science économique américaine prônant le ‘laissez-faire’ » [Furner, 1975, p. 37]. A la fin du XIXe et au début du XXe siècles, le contrôle extérieur de l’institutionnalisation de la profession d’économiste par la communauté des hommes d’affaires fut très fort aux Etats-Unis . Les attaques politiques sur les économistes progressistes « ont conduit ces derniers à restreindre leur activité académique sur des terrains intellectuels ‘sécurisés’ ». L’économie néo-classique, et surtout sous sa forme mathématique, était idéale pour servir un tel terrain. C’est la raison pour laquelle elle est devenue « une stratégie de recherche attractive pour les économistes américains, particulièrement pour les jeunes générations qui devaient se faire une position universitaire » [Fourcade, 2009, p. 79 – 80]. Les intérêts purement politiques et économiques qui étaient derrière ces attaques étaient camouflés par le discours fallacieux sur la nécessité de passer du plaidoyer (advocacy ) à l’objectivité. Ce passage signifiait en réalité le refus d’étudier objectivement la réalité afin de résoudre certains problèmes socio-politico-économiques brûlants en faveur de l’étude de constructions abstraites de mondes imaginaires légitimant le statu quo et évitant d’aborder des sujets dérangeants pour l’establishment [20]. Le financement sélectif [21] de la recherche économique de la part des universités, du gouvernement, de la communauté des affaires et des fondations caritatives jouait également un rôle important pour la diminution graduelle des courants de la pensée économique différents de l’économie néo-classique et considérés comme dérangeants [Goodwin, 1998, p. 54, 78 - 79]. Finalement, grâce à la grande interaction entre les économistes et les mathématiciens, l’évolution de la science économique fut plus influencée par les tendances intérieures du développement des mathématiques que par la réalité économique dynamique avec ses brûlants problèmes [Weintraub, 2002]. Durant les premières décennies du XXe siècle aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, l’institutionnalisation de la science économique étant achevée et plusieurs générations d’étudiants étant passées par cette institution telle qu’elle avait été créée, le contrôle extérieur de la profession n’était plus désormais nécessaire [Morgan et Rutherford, 1998]. Suivant Berger et Luckmann, cela signifiait que l’institutionnalisation avait réussi.
La science des mondes imaginaires versus la science des mondes réels
Dans leurs livres sur l’histoire de la pensée économique, Robert Heilbroner [1971] et Mark Blaug [1998] en proposent deux versions. La version originale américaine du livre de Heilbroner s’intitule The Wordly Philosophers (« Les philosophes de ce monde ») et traite les économistes de philosophes liés étroitement avec certains projets sociaux [22]. Par contre, le livre de Blaug, qui est considéré comme un classique de l’histoire de la pensée économique, dans sa version américaine s’appelle Economic Theory in Retrospect, et il considère les économistes comme des scientifiques similaires aux théoriciens en sciences naturelles. A mon avis, Heilbroner est plus perspicace et plus intellectuellement honnête que Blaug dans sa vision de la profession d’économiste, mais tous les deux ne voient la science économique que comme un ensemble de théories ; le premier voit les théories comme des constructions idéologiques qui influencent la vie des sociétés, et le second est convaincu – et comme démontré dans les précédentes sections de cet article, à tord - que les théories économiques sont des réflexions plus ou moins exactes de la réalité économique. Dans ces deux versions de l’histoire de la pensée économique, il n’y a pas de place pour les écoles de Schmoller et Commons, car elles ne rentrent pas dans le paradigme existant de la science économique [23].
Lorsque l’on dit que la science économique provient de la philosophie morale et politique, il faut se rendre compte que cette discipline à l’époque d’Adam Smith « était conçue de façon bien plus extensive qu’elle ne l’est de nos jours. La [philosophie] morale incluait la théologie, l’éthique, la jurisprudence et l’économie politique : il s’agissait donc aussi bien des aspirations les plus sublimes de l’homme à l’ordre et l’harmonie que des activités moins pures et harmonieuses visant à assurer par tous les moyens sa subsistance » [Heilbroner, 1971, p. 40]. Adam Smith lui-même enseignait cette discipline à l’Université de Glasgow dans les années 1760. Nous pouvons juger le contenu de cette discipline sur la base du manuel de William Paley (1743 – 1805), « Principes de philosophie morale et politique » (Principles of Moral and Political Philosophy) publié en traduction française en 1817. Ce livre fut l’un des textes philosophiques les plus influents de la fin de l’époque des Lumières en Grande-Bretagne. On y fait référence dans plusieurs débats au Parlement d’Angleterre et au Congrès américain, et il demeura le texte de référence au programme de l’Université de Cambridge durant toute l’époque victorienne. Il fut publié en 1785 et connut 15 rééditions durant la seule vie de l’auteur [24]. Ce manuel est orienté vers la pratique ; il contient principalement des raisonnements orientés vers la justification des différents types de règles nécessaires à la vie dans la société britannique de cette époque. Parmi ces règles se trouvent celles qui concerne la propriété, différents types de contrats (contrats de vente mobilières ou immobilières, contrat de travail), « la conduite envers les domestiques et les inférieurs », « le devoir de la soumission au gouvernement civil », « la liberté civile », « l’administration de la justice », différentes formes de gouvernement, la constitution britannique, l’agriculture et le commerce comme servant à la subsistance de la population. Les raisonnements justifiant ces règles représentent de multiples constructions déductives assises sur l’hypothèse de l’existence de Dieu. Paley admet que « le fondement de tout l’édifice » de son ouvrage est la réponse positive à la question : « Y aura-t-il réellement, après cette vie, une distribution de punitions et de récompenses ? » [Paley, 1817, tome I, p.62]. Par exemple, ces raisonnements à propos du devoir de la soumission au gouvernement civil s’appuient sur l’épître de St-Paul au Romains. Parmi les six livres de ce manuel, un est directement consacré aux « devoirs envers Dieu ». Paley a consacré spécialement le livre « Théologie naturelle » [25] (publié en 1802) à la démonstration de l’hypothèse de l’existence de Dieu. Comme beaucoup d’autres professeurs universitaires de l’époque, il faisait partie du clergé (Paley était archidiacre de Carlisle). Son livre « Les évidences du christianisme » (Evidences of Christianity) publié en 1794 est devenu lui aussi rapidement un classique qui restait inclus dans le syllabus de l’Université de Cambridge jusque dans les années 1920.
Adam Smith a suivi l’habitude intellectuelle des philosophes de l’époque de mettre Dieu au centre de leurs systèmes déductifs. La différence avec Paley consiste dans le remplacement dans son texte de « La Richesse des nations » du mot « Dieu » par le mot « Nature » [Waterman, 2004, p. 90, 91] [26]. Cette substitution lui permet de présenter le monde social comme analogue au monde naturel avec ses lois naturelles [27]. Il n’a pas essayé de chercher la source des régularités sociales, car pour lui cette source était la même que celle des régularités de la nature pour Newton, c’est-à-dire Dieu. Par contre, Schmoller a indiqué que les règles et les croyances qui les soutiennent sont les sources de ces régularités est. Plus récemment, le constructivisme social a expliqué la nature de ces régularités par les processus de l’accoutumance, de la typification liée avec l’attribution du sens à chaque activité particulière, et finalement par l’institutionnalisation des règles devenues habitudes. Newton n’a pas cherché la source des régularités dans la nature, parce que pour lui c’était Dieu, et même à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas dire si la recherche de cette source est sensée à cause de l’infini de la nature. Au contraire, la source des régularités sociales est expliquée par le constructivisme social de façon très claire et convaincante. Smith a appliqué le discours de Newton avec ses lois naturelles, sans appliquer sa méthodologie en provenance de la Royal Society et, par ce moyen rhétorique, il a apporté à ses constructions « semi-théologiques » l’autorité des sciences naturelles, qui était déjà à son époque très élevée. Les économistes qui ont suivi Smith ont substitué le mot « nature » par le mot « marché », et nous obtenons la construction qui domine actuellement la perception du monde, qui s’appelle le néolibéralisme. Schmoller et Tarde comprenaient très bien la nature théiste des constructions de Smith [28].
John S. Mill vivait déjà à l’époque de la disparition de Dieu dans le discours philosophique. N’étant pas croyant, il a décidé dans sa jeunesse, sous l’influence de l’ami de son père, Bentham, de consacrer sa vie à une religion civile [29]] : l’utilitarisme, d’où provient le caractère de son influence sur la direction du développement de la science économique. C’est lui qui, en prolongeant la tradition démarrée avec Adam Smith, a condamné à la stérilité la science économique par sa célèbre définition : « L’Economie Politique raisonne, et doit, nous soutenons cette thèse, nécessairement raisonner, à partir de suppositions, et non de faits » [Mill, 1994, p. 56].
Marx a suivi à la lettre dans le Capital la définition de Mill : « L’analyse des formes économiques ne peut, en outre, s’aider ni du microscope, ni d’aucun réactif chimique. Il faut les remplacer par la force d’abstraction » [Marx, 1993, p. 4]. Marx partageait avec ses adversaires idéologiques (l’école classique de l’économie politique) l’approche de la recherche basée sur les simplifications et les abstractions. De cette façon, il a contribué à l’établissement de la néfaste tradition de la discipline économique. Marx était pris dans les visions scholastiques de son temps en partageant avec Mill la conviction de l’impossibilité de l’approche expérimentale dans le domaine économique [idem]. Comme les autres représentants de l’école classique, il croyait profondément dans l’existence des « lois naturelles » dans le domaine économique. Le Capital de Marx est une œuvre dans une grande mesure scholastique, visant à « prouver » l’existence de l’exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie et non pas à chercher les rouages du fonctionnement du système pour les changer de façon constructive et non pas destructive. Dans le livre premier du Capital il ne s’intéresse pas du tout aux pratiques des échanges et de la fixation des prix. Pour lui, le prix n’est qu’une apparence, et il n’étudiait que l’essence : la valeur. Dans les premiers sept chapitres du livre, il raisonne en utilisant des exemples conventionnels, et il ne s’adresse pas du tout aux faits. C’est ici qu’il présente ces constructions déductives sur la base desquelles il justifie son message à propos de l’exploitation. Les chapitres 8 (« La journée de travail ») et 13 (« La machinerie et la grande industrie ») sont beaucoup plus volumineux que les autres grâce à la description des faits, mais ces derniers ne servent que d’illustrations des conclusions qui ont été déjà faites auparavant dans des chapitres avec les raisonnements abstraits. Le rôle des faits comme illustrations des constructions déductives abstraites continue d’être présent dans le reste de l’ouvrage.
Je me permets de citer ici un long passage du discours de rectorat de Schmoller prononcé à l’Université royale de Frédéric-Guillaume à Berlin le 15 octobre 1897, dans lequel il compare les écoles de Smith et de Marx comme étant ressorties de la philosophie du XVIIIe siècle : « L’économie politique devint une science autonome ; elle a donné dès lors naissance aux deux grandes théories ou écoles qui ont dominé la pensée et l’action de 1770 à nos jours : l’économie politique individualiste, et l’économie politique socialiste. Ce sont deux enfants de la même mère : l’ancienne théorie, la théorie individualiste abstraite de la nature des Physiocrates et d’Adam Smith à J.S. Mill et à K.H. Rau, et la théorie socialiste un peu plus moderne de la lutte de classe de William Thompson à Karl Marx, sont le produit du droit naturel, libéral et radical. Ces deux écoles croient pouvoir déduire de la nature humaine abstraite un système objectif complet de l’économie actuelle. Toutes deux exagèrent comme tout le XVIIIe siècle et la philosophie constructive de la première moitié du XIXe siècle, notre possibilité actuelle de connaître ; toutes deux veulent arriver d’un bond, sans l’étude des détails (mis en italique par VY), sans une base psychologique exacte, sans des études préalables complètes de droit et d’histoire économique, à la vérité économique ultime, et par elle dominer le monde, les hommes, les Etats ; toutes deux sont liées à la connaissance économique empirique de leur époque, elles cherchent à s’accommoder à ces données empiriques, mais toutes deux ne sont, chez leurs principaux représentants, que des idéologies, des systèmes fermés, qui posent directement un nouvel idéal de l’économie, de la vie sociale, de l’ensemble des institutions économiques et juridiques. Par leur méthode et leur contenu elles ne s’élèvent pas encore complètement au rang d’une véritable science [...] Le point faible des théories socialistes et des théories individualistes est dans leur conception d’une économie abstraite séparée de l’Etat et du droit, et dans ce fait qu’elles raisonnent sur elle. Toutes deux renferment une grande part d’idéalisme qui agissait sur la vie pratique et poussait à l’action les esprits les plus avancés ; mais c’était chez toutes deux un idéalisme qui dépassait le but, et qui conduisait directement à la révolution et au bouleversement [30] » [Schmoller, 1902, p. 228]. Schmoller a bien vu que ces deux écoles ne sont que des philosophies et non pas des sciences qui suivent la tradition des sciences naturelles. [31]]
En opposition à Smith et Marx, Schmoller pensait que les « lois naturelles » de la vie économique n’existent pas. En croyant aux lois naturelles, Marx ne comprenait pas la source des régularités dans la vie sociale : les règles (les institutions) et les croyances derrière ces règles. Gustav Schmoller était apparemment le premier qui ait compris que les économistes doivent étudier les règles et les croyances des acteurs pour comprendre le système économique et prévoir les résultats de son fonctionnement (comme par exemple la crise actuelle). Voila comment il résume la différence entre son école et ses prédécesseurs : « La théorie économique (Volkswirtschaftslehre) actuelle en est venue à une conception historique et éthique de l’Etat et de la société, toute différente de celle qu’avaient formulée le rationalisme et le matérialisme. Elle n’est plus une simple théorie du marché et de l’échange, une espèce d’économie politique des affaires, qui menaçait de devenir une arme de classe pour les possédants ; elle est redevenue une grande science politique et morale, qui étudie la production des biens, mais aussi leur répartition, les phénomènes de l’échange, mais aussi les institutions économiques, qui a fait à nouveau de l’homme le centre de la science, et non plus les biens et le capital. » [Schmoller, 1902, p. 238]
Les fondateurs de l’Union pour la politique sociale étaient frustrés par le mode de raisonnement de l’économie classique qui « leur semblait totalement en désaccord avec le climat scientifique positiviste et matérialiste de l’époque, quand les sciences naturelles allaient de succès en succès en travaillant empiriquement » [Grimmer-Solem, 2003, p.123]. Contrairement à la plupart des professeurs universitaires en économie, les fondateurs de l’Union pour la politique sociale, Gustav Schmoller et Georg Knapp, avaient reçu une bonne formation en sciences naturelles : Schmoller avait étudié à l’université de Tübingen la chimie, la physique, la mécanique et la technologie ; Knapp avait étudié la physique et la chimie au laboratoire de Liebig [p. 133]. La traduction en allemand du System of Logic de Mill fut publiée en 1865, et Schmoller, comme beaucoup d’autres, a remarqué l’inconsistance du traitement par Mill des sciences sociales qui excluait l’application à ces dernières de l’approche expérimentale : « En rejetant cette inconsistance qu’il ne voyait pas servir la science mais la propre opinion de Mill à propos de ce qui constituait la nature humaine et la loi naturelle, Schmoller cherchait à la place à mener les recherches en science économique de la même façon que le faisaient les chercheurs en sciences naturelles » [p. 133, 134]. Il croyait que « les sciences économiques et sociales ont la même épistémologie que les sciences naturelles » [p. 160]. Selon Schmoller et ses collègues, « les principales sources des régularités sociales étaient la morale, l’éthique et les institutions communes » [ibid]. C’est pour cette raison qu’ils contestaient l’existence de lois sociales universelles, en invitant les économistes à chercher les régularités sociales en se limitant dans l’espace et dans le temps. L’épistémologie commune de la science économique avec les sciences naturelles n’impliquait pas une ontologie commune : les régularités de la nature sont immuables et ne sont pas la création des êtres humains, alors que les régularités sociales sont une pure création des êtres humains. Remarquons que Mill prônait le contraire, c’est-à-dire que les sciences sociales devaient être similaires aux sciences naturelles du point de vue ontologique, mais qu’elles devaient être totalement différentes du point de vue épistémologique.
Un siècle avant l’apparition du constructivisme social, Schmoller a compris l’importance de l’accoutumance dans le processus du changement institutionnel. C’est pour cette raison qu’il ne voyait des réformes efficaces possibles que si elles étaient graduelles, s’inscrivant dans un processus d’adaptation institutionnelle par étapes [p. 161], et ancrées dans des habitudes profondes partagées. C’est pour cette raison également qu’il insistait sur l’importance de la recherche historique qui pouvait révéler ces habitudes profondes partagées. Les économistes de l’école classique insistent sur le fait que ce sont les intérêts des gens qui guident leurs actions. Du point de vue de Schmoller et de ses collègues, « les institutions ont toujours modelé les intérêts individuels pour protéger la société, et de cette façon elles ont rendu possible les interactions économiques socialisées, et dans l’analyse économique la morale et le droit peuvent être considérés comme des facteurs causaux » [ibid]. [32] La préparation de reformes se traduit dans l’élaboration de nouvelles lois, et pour la Nouvelle école historique allemande, la « recherche des éléments moraux communs pour construire de nouvelles lois et institutions conduit naturellement aux investigations historiques sur ce qui formait la sphère morale commune et l’action économique qui avait été éthiquement contrainte et modelée, c’est-à-dire les coutumes, les normes, les conventions, les règles et régulations, les lois, les organisations, les organes corporatifs et autres institutions, et pas le moins important, l’Etat » [p. 160, 161). Sur la base de ses investigations historiques, Schmoller est venu à la conclusion que « l’Etat et sa bureaucratie peuvent défendre l’intérêt général et servir de forces pour les améliorations sociales, (et que) les institutions en économie apportent une plus grande certitude et un plus grand ordre dans les relations de marché dans lesquelles elles injectent un ensemble de normes morales et éthiques » [p. 168].
Si Schmoller et ses collègues ont bien saisi le trait principal de l’approche des sciences naturelles, à savoir la nécessité de la « résistance » de l’objet d’étude au chercheur, les fondateurs de la théorie économique néoclassique, Stanley Jevons et Léon Walras, ignoraient totalement ce trait. En analysant le mystère de la « découverte » simultanée dans les années 1870 par ces deux dernières personnes [33] de l’économie néoclassique, Philip Mirowski est venu à la conclusion que cette simultanéité est due au fait de l’infiltration de la thermodynamique dans les manuels dans les années 1860 [1989, p. 217]. Suivant Mirowski, ces deux personnes ont mécaniquement réinterprété les constructions mathématiques de cette physique en termes de biens, de prix et d’utilités. Son analyse montre que le départ de l’économie néoclassique n’était pas très glorieux. Il doute que Jevons comprenait bien le sens physique de ces constructions mathématiques [p. 218]. En ce qui concerne Walras, en arrivant à Lausanne en 1870, il n’avait pas de connaissances des mathématiques en dehors de la géométrie analytique élémentaire, mais déjà un an plus tard il proposait à la publication son Traité d’économie politique rédigé sur la base de son cours. C’est un ingénieur et professeur de mécanique de l’Académie de Lausanne, Antoine Paul Piccard, qui lui a fourni un mémo sur les mathématiques de l’optimisation que Walras a utilisé pour des « objectifs métaphoriques » [p. 258]. Mirowski exprime l’idée que la formulation de la théorie néo-classique dans les années 1870 était l’appropriation métaphorique systématique de la structure analytique de la physique du milieu du XIXe siècle. L’économie néoclassique est ainsi vue non comme une “découverte”, mais comme l’imposition arbitraire sur la réalité sociale d’un modèle emprunté d’un domaine de connaissances étranger à celle-ci [Carlson, 1997]. Jevons et Walras ont ouvert la tradition de l’attirance des mathématiciens et physiciens « ratés » par la discipline de l’économie. Une des raisons principales de pourquoi les constructions de Jevons et Walras ont été mises au centre de l’enseignement de cette discipline est très simple : elles remplissaient les fonctions de justification du laissez-faire (le caractère harmonieux et juste de l’ordre social basé sur ce principe), mieux même que l’économie politique classique attaquée sur son terrain de la théorie de la valeur travail par le marxisme.
François Simiand a indiqué depuis longtemps que l’économie mathématique n’est rien d’autre qu’une construction idéologique [2006, p. 87 – 114]. Cette construction idéologique sous forme mathématique était mise à la base de l’institution anglo-saxon de la discipline économique par le créateur de cette institution, Alfred Marshall. La biographie de ce dernier, écrite par son célèbre élève John Maynard Keynes [1963], nous donne la possibilité de comprendre comment son environnement social l’encourageait de trouver dans l’économie politique la justification de l’état actuel des couches pauvres de la population d’Angleterre, et comment les circonstances de sa vie et le caractère non-héroïque de sa personnalité (il n’était pas prêt de s’engager dans « les études directes de la vie et du travail [qui] n’auraient pas rapporté beaucoup de fruits pendant plusieurs années ») l’ont poussé à abandonner ses plans initiaux de suivre dans ses recherches la méthodologie de l’école historique allemande [34]. Marshall a continué la tradition de l’économie politique, en se basant sur la méthodologie de Mill, de la légitimation « scientifique » de l’ordre social désiré ou établi. Ce type de science économique était le bienvenu pour les hommes d’affaires américains qui, de plus en plus, remplaçaient à cette époque le clergé dans les conseils d’administration des universités [35]. En dépit que Keynes ait ironisé à propos du changement de plan de son maître à étudier la vie économique en contactant les acteurs en faveur de l’élaboration d’un traité économique exclusivement de sa tête, lui-même n’a pas évité la tentation d’écrire un pareil traité. Comme l’a souligné Schumpeter, la définition des notions fondamentales de la Théorie générale de Keynes (propension à consommer, attitude envers la liquidité, efficacité marginale du capital) n’a été précédée par aucune recherche empirique [Schumpeter, 1983, p. 74]. Keynes, élève de Marshall, est également touché par la méthodologie de Mill, et le mot peut-être le plus souvent utilisé dans le texte de sa Théorie générale est « supposons ».
Le trait principal des œuvres de Smith, Ricardo, Marx et Keynes était la construction de systèmes déductifs orientés vers la justification de certains messages. C’est grâce à ces messages qu’ils sont restés dans l’histoire. Par contre l’histoire socio-politico-économique accompagnée par les disputes entre les différentes écoles de la pensée économique a bien montré la faible valeur cognitive de leurs constructions déductives. Le message de Smith était le suivant : « il faut laisser jouer le marché », « moins le gouvernement gouverne et meilleur il est » [Heilbroner, 1971, p. 65] et son système déductif, qu’il a construit pour justifier cette message, était basé sur la notion de la valeur travail. Ricardo utilisait cette notion en développant la notion de la rente pour justifier son message : « les intérêts des propriétaires fonciers sont toujours opposés à l’intérêt de toutes les autres classes sociales de la communauté » [p. 78]. Marx a inventé la notion de la survaleur (plus-value) pour « prouver » l’existence de l’exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie qui est la composante principale de son message. En ce qui concerne la théorie du multiplicateur de Keynes, elle n’a pas véritablement expliqué la crise des années trente, mais elle servait de justification pour la politique économique des gouvernements de la régulation du capitalisme profondément instable [Cohen, 2009, p. 127]. Le message de Schmoller à propos de la régulation du capitalisme était déjà oublié, et le message de Keynes était reçu comme une révélation. Quand Keynes est venu à Washington en 1934, il a vu que « le gouvernement [américain] lui-même devint subitement un investisseur économique important », « ainsi quand la Théorie générale parut en 1936, elle apportait moins un nouveau programme d’action radicale qu’une défense de l’action déjà entreprise » [Heilbroner, 1971, p. 261]. Jevons, Walras, Marshall et Samuelson n’avaient pas leurs propres messages, mais dans leurs œuvres, ils habillaient les messages de leurs grands prédécesseurs dans les nouveaux vêtements mathématiques.
C’est le manuel de Samuelson « Economics » publié initialement en 1948 qui a fait la synthèse de la théorie microéconomie néoclassique et de la théorie macroéconomique keynésienne et qui a joué après guerre un rôle très important dans le placement de l’économie néoclassique au centre de l’enseignement économique supérieur. Il confesse dans une interview qu’il est devenu économiste un peu par hasard, essentiellement parce que faire l’analyse économique dans le cadre du paradigme de Marshall était pour lui intéressant et facile [Szenberg, Gottesman and Rarattan, 2005, p. 33]. Il disait que c’était aussi facile que “de pêcher dans un lac vierge du Canada. Vous lancez votre hameçon et il en ressort théorème après théorème” [Samuelson and Barnett, 2007, p. 154]. La méthode de travail de Samuelson était la même que celle de Jevons et Walras : reproduire l’application des méthodes mathématiques utilisées en physique pour l’économie. Samuelson n’était pas physicien, mais il “avait connu plusieurs mathématiciens et physiciens mondialement reconnus” et avait reçu “des allusions essentielles” pour son travail d’un thermodynamicien [p. 155]. Sa méthode de travail était une vraie caricature de la méthode de Newton [36].
A mon avis, c’est la relative facilité de la version donnée par Samuelson des activités d’économiste qui se concrétise dans la préparation d’articles pour les revues professionnelles de cette science et dans l’enseignement de ce type de science économique qui furent des causes importantes de la victoire finale des courants de la pensée économique sur l’institutionnalisme constructiviste en économie. La version de l’institutionnalisme constructiviste de l’enseignement économique, par l’implication des étudiants dans la recherche des problèmes socio-économico-politiques brûlants en évolution constante, exige de la part des professeurs beaucoup plus d’efforts que la présentation d’une année sur l’autre de constructions mathématiques assez simples sans beaucoup de changements, et la supervision de travaux dirigés des étudiants consistant à la solution d’exemples numériques illustrant ces constructions [37]. Les diplômés universitaires avec un bon bagage mathématique, qui cherchent à valoriser leurs compétences mathématiques qui n’ont pas forcément l’ambition de consacrer leur vie à la compréhension profonde des phénomènes de la vie économique contemporaine et d’être de cette façon utiles à la société, peuvent être très attirés par la profession d’économiste académique dans sa forme néoclassique ou ramifiée. Du fait que, au début de l’institutionnalisation de la science économique, les représentants de la profession qui essayèrent de faire des recherches empiriques concernant les problèmes brûlants de la société étaient persécutés par les forces puissantes extérieures à la profession, cette dernière est devenue non attractive pour les personnes socialement orientées. En conséquence, les « fonctionnaires » devinrent la majorité dans la profession des économistes académiques, et ils pouvaient ainsi contrôler la pureté néoclassique sans recourir envers les dissidents à des sanctions punitives de l’extérieur de la profession.
Comme indiqué précédemment, l’institution anglo-saxonne de la science économique créée dans le cadre des universités, très touchée par son histoire médiévale et subordonnée au nouvel establishment capitaliste, a conduit cette discipline à devenir l’incarnation de l’idéologie favorisant les intérêts de cet establishment. Le courant dominant de la science économique actuelle continue à remplir cette même fonction. Robert Heilbroner était très lucide à ce sujet [38]. De cette façon les économistes ne sont pas vraiment des chercheurs similaires à ceux des sciences naturelles, ils sont plutôt les théologiens [39] d’une certaine religion civile [40]. C’est contre cette religion qu’Alain Caillé se révolte en caractérisant de la façon brillante la situation actuelle : « Le monde moderne est dans une large mesure la réalisation du rêve (the dream come true), de la prophétie et de la prédiction de la science économique. Jusqu’au cauchemar parfois. Et cela devient chaque jour plus vrai, à l’échelle de la planète, où plus rien d’autre ne semble doté de la réalité que l’enrichissement personnel et matériel. Face à elles, tout – toute valeur, toute croyance, toute action menée pour elle-même, pour le plaisir, toute existence qui n’est pas vouée à la recherche de l’utilité – tout semble illusoire, inopérant, n’en valant pas la peine, superflu, irréel » [2007, p. 7].
Il est bien exact que le monde moderne est la réalisation de la prophétie et de la prédiction de la science économique. Le présent article est tout à fait en accord avec ce jugement, mais j’insiste pour dire que cette science économique n’est pas une science orientée vers la compréhension, mais une théologie de la religion séculière qui a vraiment conquis le monde. Le monde actuel ressemble de plus en plus à la réalisation de cette prophétie parce que de plus en plus de personnes croient en cette religion, et donc perçoivent leur environnement humain et agissent selon ces croyances. Il est bien sûr nécessaire de lutter contre cette religion, et l’une des façons de le faire est d’élaborer et de propager des croyances alternatives. Cependant, ce n’est pas la tâche des scientifiques/chercheurs/investigateurs de la réalité socio-économico-politique, mais celle des personnes qui s’engagent dans la philosophie politique/sociale/morale. Le chercheur peut être utile au philosophe en lui fournissant la compréhension de ce qui est. Le philosophe peut assister le chercheur sur le choix des domaines à investiguer. Mais tous les deux ne peuvent se substituer au politique qui, à partir des éléments fournis par ces derniers, devra prendre les décisions. Confondre ces trois fonctions est très dommageable pour la société. Le remplacement du chercheur par le philosophe mène à l’absence de la compréhension du réel. L’imposition de certains choix politiques au nom de la science mène à la dévalorisation des politiques [Amable et Palombarini, 2005, p. 270 – 271].
Si en Occident après guerre, c’est l’économie néoclassique qui jouait le rôle de théologie de la religion de l’argent et du marché, à l’Est, c’est l’économie politique marxiste qui servait de théologie d’une vraie religion séculière d’Etat. C’est bien sûr l’Union Soviétique qui servait de modèle pour les autres pays socialistes. L’institution de la science économique soviétique, comme également des autres sciences sociales, était un élément important de l’institution soviétique d’Etat et se trouvait sous le contrôle direct du Comité Central, des comités provinciaux et de districts du Parti Communiste, et sous la surveillance minutieuse du KGB. La science économique soviétique d’après guerre se transforme sous la direction de Staline dans une forme de théologie séculière. C’est le marxisme-léninisme qui servait en URSS de religion séculière. La liaison entre le communisme russe et la tradition chrétienne orthodoxe a facilité l’introduction de cette nouvelle religion en Union Soviétique [41]. La tradition de la subordination de l’église orthodoxe russe à l’Etat a facilité également l’introduction de cette religion. Le communisme – « le futur radieux de l’humanité » - a pris la place de Dieu dans cette religion. Le rôle de l’église comme institution était joué par le Parti Communiste. Le « prophète » était Marx, assisté par Engels ; les « pères fondateurs » étaient Lénine et Staline, et les « textes sacrés » étaient leurs œuvres. Les réunions idéologiques de différents types, y compris les réunions du Parti aux différents échelons, jouaient le rôle de « messes ». La philosophie marxiste-léniniste (matérialisme dialectique et historique), l’économie politique et le communisme scientifique figuraient dans tous les cursus universitaires du pays. Il peut paraître surprenant de constater avec quelle vitesse, après le début de la réorientation de la Russie vers le capitalisme, les économistes russes eux aussi ont réorienté leurs cours d’économie politique marxiste vers l’économie néoclassique [Suspitsyna, 2005].
Nous pouvons donc dire maintenant que Schmoller avait parfaitement raison dans son évaluation de « l’économie politique individualiste et l’économie politique socialiste », mais il ne pouvait probablement pas prévoir comme conséquences les ravages des dérives de ces deux écoles de la science économique des mondes imaginaires.
La théologie marxiste pratiquée en URSS a également influencé la philosophie et la science économique en Occident, le plus souvent au travers des partis communistes européens. En France après la guerre, une tranche importante de la population partageait également cette religion marxiste. Après l’affaiblissement, puis le démantèlement de l’URSS, cette religion a perdu une grande partie de son influence et la science économique d’orientation marxiste a plus ou moins disparue des universités françaises [Pouch 2001]. Les anciens économistes marxistes en France et en Russie sont attirés par l’institutionnalisme, soit dans sa forme néo-institutionnaliste comme ramification de l’économie néoclassique, soit par l’institutionnalisme de Veblen, la négligence duquel envers la recherche empirique est bien connue, mais jamais par l’institutionnalisme de Schmoller-Commons. Et c’est bien compréhensible, car dans ces deux cas, ils restent toujours dans le cadre du paradigme issu des Lumières auquel ils sont habitués. Certains parmi eux ont été attirés par le keynésianisme qui ne les fait toujours pas sortir de ce paradigme. Si les adeptes de ces courants basent leurs constructions sur certaines observations de la réalité, ces observations sont toujours faites de loin et non de près (observations ethnographiques) comme le faisaient les écoles de Schmoller et Commons.
Les tout derniers courants de la science économique comme l’économie comportementale [Wilkinson, 2008] et l’économie expérimentale [Eber et Willinger, 2005] ne nous font toujours pas sortir des mondes imaginaires.
Le pluralisme, la crise et la sortie des mondes imaginaires
J’ai emprunté le terme de « mondes imaginaires » à la lettre ouverte des étudiants normaliens [le Monde du 17 juin 2000] qui ont lancé le mouvement protestataire contre l’enseignement supérieur de l’économie. Cette lettre concernait trois points : 1. Sortons des mondes imaginaires ; 2. Non à l’usage incontrôlé des mathématiques ; 3. Pour un pluralisme des approches en économie. Dix ans sont passés depuis la publication de cette lettre qui a fait beaucoup de bruit à l’époque. Le ministre de l’éducation nationale a confié à Jean-Paul Fitoussi la préparation d’un rapport intitulé « l’Enseignement supérieur des sciences économiques en question ». Ce rapport [Fitoussi, 2001] n’avait aucune intention de sortir cette science du paradigme en provenance des Lumières.
Le premier point de la lettre était très prometteur : « La plupart d’entre nous a choisi la filière économique afin d’acquérir une compréhension approfondie des phénomènes économiques auxquels le citoyen d’aujourd’hui est confronté. Or, l’enseignement tel qu’il est dispensé - c’est-à-dire dans la plupart des cas celui de la théorie néo-classique ou d’approches dérivées - ne répond généralement pas à cette attente. En effet, si la théorie se détache légitimement des contingences dans un premier temps, elle effectue en revanche rarement le nécessaire retour aux faits : la partie empirique (histoire des faits, fonctionnement des institutions, étude des comportements et des stratégies des agents...) est quasiment inexistante. Par ailleurs, ce décalage de l’enseignement par rapport aux réalités concrètes pose nécessairement un problème d’adaptation pour ceux qui voudraient se rendre utiles auprès des acteurs économiques et sociaux » [p. 183 – 184]. C’est à mon sens l’approche de Schmoller-Commons qui pouvait le mieux répondre à ces demandes. Pourtant, les étudiants – comme les enseignants d’ailleurs - ne connaissaient apparemment pas le sens profond de cette approche.
Nous pouvons constater à l’heure actuelle que c’est sur le troisième point que le mouvement dans son évolution a mis l’accent, comme si le premier point serait résolu automatiquement lorsque le troisième serait réalisé. Le mouvement s’est internationalisé et c’est Edward Fullbrook, en lançant la revue électronique Real-world Economics Review, qui est devenu de facto son porte parole. Par cette revue et les publications qu’il édite, il exprime nettement l’idée que la réforme de l’enseignement supérieur en économie et de l’institution de la science économique elle-même, se réduit au remplacement de la dominance de l’économie néo-classique par le pluralisme des écoles présentes dans l’enseignement [Fullbrook, 2008]. Mes contacts personnels avec quelques anciens leaders de ce mouvement ont montré qu’ils partagent la position de Fullbrook, et qu’ils sont plutôt hostiles à l’approche constructiviste exposée et défendue dans le présent article. A mon avis, cela montre une fois de plus combien la science économique est bien institutionnalisée dans le cadre du paradigme en provenance des Lumières : les personnes passées par la préparation et la soutenance d’une thèse en économie ne peuvent apparemment plus être réceptives à l’approche constructiviste. C’est dans le même esprit du pluralisme comme principe du changement de la situation dans la profession d’économiste académique en France que Nicolas Postel et Richard Sobel ont créé l’Association d’économie politique (hétérodoxe) institutionnaliste [Labrousse et Lamarche, 2009] suivant le manifeste lancé par Alain Caillé [Caillé et alii, 2007]. A mon sens, le pluralisme des mondes imaginaires, même si le « degré d’imagination » varie d’une école hétérodoxe à l’autre, ne résoudra pas le problème de l’incapacité de la profession d’économiste d’apporter à la société la compréhension de la réalité économique et de prévoir les phénomènes comme la crise actuelle.
A l’époque de Schmoller, la question du pluralisme dans l’enseignement économique universitaire se posait déjà, même s’il n’y avait pas autant de courants que maintenant. Voila comment il s’est exprimé à ce sujet : « Et l’on pourra certainement admettre en pratique que lorsqu’il existera dans le domaine des sciences d’Etat et des disciplines voisines des points de vue différents extrêmement opposés, on doit donner à tous des moyens égaux pour s’affirmer, tant qu’ils s’appuieront entièrement sur le terrain du savoir acquis et des meilleures méthodes scientifiques et tant que leurs représentants offriront par leur caractère la garantie que leur conviction n’est pas le produit de leur passion, de leur intérêt de classe, de l’égoïsme et de leur besoin de parvenir, mais d’une conception honnête du bien-être général. Nous avons ainsi le critérium qui, selon moi, nous permettra de voir si cette opinion, si souvent exprimée de nos jours, que toutes les écoles doivent être représentées également dans les universités est justifiée. Ce serait aller contre le progrès que de mettre sur le même pied des écoles disparues et des méthodes surannées, et des écoles nouvelles et des méthodes plus parfaites : c’est ainsi qu’un pur disciple de Smith tout comme un pur disciple de Marx ne peuvent prétendre aujourd’hui être traités sur le même pied que d’autres. Ceux qui ne se tiennent pas sur le terrain de la recherche moderne, des méthodes savantes d’aujourd’hui, ne peuvent pas être des professeurs utiles. De même ceux qui sont des représentants des intérêts économiques de classe. Il est tout naturel qu’ils soient directeurs de journaux, qu’ils soient choisis comme chefs de parti des classes organisées et de leurs associations. Là on comprend, et personne ne saurait leur en faire un reproche, qu’ils défendent des intérêts de classe ; on comprend qu’aussi longtemps qu’ils sont au service de ces intérêts, ils confondent si souvent ces intérêts avec le bien-être et l’intérêt général. Mais ils ne sauraient occuper une chaire » [Schmoller, 1902, p. 240, 241]. Pour Schmoller, il était absolument inacceptable d’introduire à l’université la discipline économique basée sur « le rationalisme abstrait, qui voulait expliquer tous les phénomènes au moyen de quelques prémisses hâtivement formulées et en déduire un idéal qui convint à tous les lieux et à tous les temps » [p. 236]. Par « le terrain de la recherche moderne, des méthodes savantes d’aujourd’hui », Schmoller désignait l’approche expérimentale et les méthodes qualitatives : « On s’est mis alors à la recherche méthodique, à l’étude du détail, dans les recherches sur l’histoire économique, la psychologie économique, dans l’examen des questions qui se rattachent au marché, à l’argent, au crédit, aux rapports sociaux [...] On s’est convaincu qu’une longue série d’observations, des matériaux solidement acquis étaient nécessaires, qu’on ne pourrait arriver à établir des lois scientifiques et porter des jugements certains qu’après avoir au préalable constitué toute une vaste littérature descriptive [...] On vit de mieux en mieux qu’on fait plus avancer la science par des monographies que par des traités. On comprit que ce n’est que par la collaboration organisée de centaines et de milliers de personnes, comme cela se fait pour la statistique, pour les enquêtes, pour les publications des sociétés savantes, par exemple de l’Union pour la politique sociale, que nous pourrons nous orienter un peu dans le dédale des faits sociaux » [p. 236, 237]. La maitrise et la pratique de l’approche expérimentale et des méthodes qualitatives était absolument nécessaire pour devenir membre de la communauté d’économistes, c’est-à-dire être admis comme professeurs dans les universités allemandes [42]].
Ce n’est pas la multiplicité des théories, qui ne sont peut-être rien d’autres que la multiplicité de mondes imaginaires, qui a permis à la douzaine de personnes qui ont prévu la crise actuelle de le faire, mais leur connaissance détaillée des pratiques dans les domaines de la finance et de l’immobilier. Je me permets de reproduire ici un extrait de la réponse de Paul Jorion (qui fait partie de ceux qui ont prévu la crise) à l’invitation de signer le manifeste « Vers une économie politique institutionnaliste » publié dans la Revue du MAUSS (n° 30, second semestre 2007) : « Ce ne serait pas une mauvaise chose en effet pour ceux qui sont ‘ailleurs’, qu’ils serrent les rangs s’ils veulent gagner un peu de pouvoir dans l’université et dans la recherche. Mais le fait-même qu’il faille faire des appels du pied après tant d’années de cohabitation acrimonieuse entre eux me rappelle qu’il est bien tard car cela fait quoi ? vingt ans ? trente ans ? que les « institutionnalistes » sont là, penchés au bord d’un nouveau paradigme, paralysés et incapables de faire le saut ! La crise dans laquelle nous sommes aujourd’hui plongés était prévisible et je ne leur ferai pas l’insulte de penser qu’ils ne l’ont pas vu venir mais qu’ont-ils dit ? Je les ai vus, pour ma part, muets comme des carpes ! » [43] Quels institutionnalistes visaient Paul Jorion par cette déclaration ? Au moins trois courants se réclament en France d’être institutionnalistes : la nouvelle économie institutionnelle, la théorie de la régulation et l’économie des conventions. En ce qui concerne la nouvelle économie institutionnelle, il est difficile de la considérer comme « penchée au bord d’un nouveau paradigme », car elle reste totalement à l’intérieur du courant mainstream ayant beaucoup en commun avec l’économie néo-classique ([Brousseau et Glachant, 2008] [44], [Ménard et Shirley, 2005]). L’individualisme méthodologique et la confusion entre le registre normatif et l’analyse positive de la réalité qui caractérise l’économie des conventions [Amable et Palombarini, 2005, p. 34] retiennent également ce courant bien loin « du bord d’un nouveau paradigme ».
Il ne reste qu’une seule école française, celle des régulationistes, qui peut être vraiment considérée de cette façon. Gérard Kébabdjian a indiqué deux postulats de base de la théorie de la régulation : le rejet de l’individualisme méthodologique et le rejet du déterminisme économique, et donc du fonctionnalisme. Selon lui, cette théorie adhère, au moins de façon apparente, à un institutionnalisme « constructiviste » [45]. L’histoire dramatique de l’évolution de cette dernière école [Vidal, 2001] nous montre les énormes difficultés des membres de la profession pour sortir du paradigme des Lumières. La naissance de cette école est liée à la déception des jeunes chercheurs travaillant dans divers services d’étude de l’Administration économique à propos de la modélisation mathématique macroéconomique à la Lawrence Klein. Leur formation et leur environnement social professionnel les poussaient à chercher la sortie de l’impasse cognitive de la modélisation mathématique dans le changement de « lunettes théoriques » en faveur du marxisme ([Aglietta, 1976], [Boyer et Mistral, 1978]). Apparemment, c’est le poids politique du Parti Communiste entre 1945 et 1980 qui a grandement contribué à l’importance du marxisme dans la vie intellectuelle, sociale et politique en France [Vidal, 2001, p. 23], et qui était déterminant dans le choix des « lunettes ». Les régulationistes ne peuvent pas être accusés de ne pas s’intéresser aux crises du capitalisme ; cela était au contraire toujours au centre de leurs préoccupations. Leur intérêt pour les finances était un atout réel pour l’étude de ces crises. J’ai l’impression que les années précédant le début de la dernière crise globale qui est toujours là, les fondateurs de l’école régulationiste se sont vraiment rapprochés du « bord du nouveau paradigme ». Ils se sont plongés de plus en plus dans les détails des enjeux de la comptabilité et des logiques financières [Aglietta et Rebérioux, 2004] ainsi que des innovations financières majeures (la déréglementation, la globalisation et la sophistication des nouveaux instruments) comme étant au cœur des crises financières contemporaines [ Boyer, Dehove et Plihon, 2004]. Pourtant ils n’ont pas prévu l’arrivée de la crise actuelle ; la question se pose de savoir pourquoi. Pour moi, c’est parce que le niveau des détails étudiés des règles n’était pas suffisant ; leur observation était trop lointaine et il aurait fallu observer les détails de plus près. Ces auteurs ont souvent vu les institutions comme un arrière plan de l’économie, et non comme son premier plan, d’où leurs essais de détecter les crises financières à partir de l’analyse des données quantitatives des crises précédentes [p. 341 – 374], et non pas de l’analyse détaillée des règles actuelles en vigueur et des croyances qui les soutiennent.
C’est ce qu’a fait Paul Jorion et quelques autres qui ont prévu la crise. L’analyse de Jorion était très simple ; elle était basée sur sa connaissance des règles d’octroi aux Etats-Unis des crédits immobiliers pour les familles à revenus modestes (subprimes), et des règles de la titrisation des prêts hypothécaires (mortgage-backed securities). Elle était basée également sur la connaissance de la mentalité des Américains, en provenance du calvinisme, qu’il qualifiait de fondamentaliste (« le marché a toujours raison »), et sur le suivi attentif des discours du directeur de la Réserve Fédérale des Etats-Unis, Alan Greenspan. Ses connaissances lui ont permis non seulement de prévoir l’arrivée de la crise, mais d’en prévoir le mécanisme de son déroulement [Jorion, 2007, p. 241- 244]. Paul Jorion apprenait ces détails en travaillant dans la compagnie américaine Country Wide, la première compagnie du monde spécialisée dans le crédit à la consommation. Les sociologues appellent cette méthode de recherche « l’observation participante ». Apparemment, Michel Aglietta, lui aussi utilise cette méthode en travaillant comme consultant chez Groupama Asset Management. Les deux ne respectent pas la tradition établie de la discipline économique qui se fonde sur des simplifications. Les membres de la profession détestent les détails. Une partie importante des textes de ces deux auteurs sont des descriptions. Leurs analyses partent de ces descriptions. La plupart des économistes détestent les descriptions, surtout lorsqu’elles sont détaillées, et ils les considèrent comme absolument inadmissibles dans les textes dits « scientifiques ». C’est pour cela que les économistes sont impuissants à comprendre et prévoir quoi que ce soit. Les économistes sont obsédés par l’utilisation des notions/concepts créés à l’intérieur de leur communauté. La plupart de ces notions sont des notions a priori dont la création n’est basée sur aucune recherche s’appuyant sur les faits. Dans les ouvrages de Jorion consacrés à la crise actuelle [46]] et dans les livres récents d’Aglietta [47]], ces auteurs ne sont pas gênés par la nécessité de se baser sur des notions/concepts a priori ; leur analyse est ancrée dans leurs descriptions.
La majorité des économistes sont convaincus que, sans ce type de notions, aucune recherche n’est possible, car ces notions servent de « lunettes » pour voir la réalité économique. Mais en vérité, elles créent des obstacles pour la compréhension de cette réalité. C’est l’institution de la science économique (les règles de fonctionnement de la profession et les croyances de la communauté des économistes identifiant la science avec les théories et les modèles abstraits) qui est coupable d’entraîner les chercheurs dans cette impasse. Les personnes qui refusent d’accepter ces règles et qui rejettent ces croyances ne sont pas acceptées ou quittent la profession. A ce propos, l’évolution professionnelle de Michel Aglietta, qui a approché le paradigme constructiviste avec ses composantes ontologique et épistémologique à la fin de sa carrière, me semble révélatrice.
L’histoire professionnelle de Robert Shiller, professeur en économie à l’Université de Yale, qui fait partie des personnes qui ont prévu la crise, nous montre d’une part les contraintes de la profession qui poussent les jeunes économistes dans les mondes imaginaires, et d’autre part pour les gens ayant la volonté de comprendre la réalité économique, la possibilité de sortir de ces mondes. Shiller a réussi à prévoir la crise non pas grâce à son appartenance à la profession d’économiste, mais en dépit de celle-ci. Dans son interview publiée en 2007 dans le livre « Inside the Economist’s Mind. Conversations with Eminent Economists » [Samuelson et Barnett, 2007, p. 228-260], il indique beaucoup d’éléments sur sa façon de travailler qui recoupent la méthodologie de Schmoller. Il s’agit de l’application des résultats de la psychologie et de la méthode anthropologique des enquêtes (Schmoller soulignait en son temps l’importance de l’utilisation des résultats de la psychologie et de l’anthropologie pour les économistes), et de l’importance de l’étude des idées. Le début de sa carrière est traditionnel. Sa thèse de doctorat soutenue en 1972 était très néo-classique et mathématique. Toutefois, Shiller était toujours attiré par la recherche sur la base des données envers lesquelles il avait une attitude créative. Au départ, il mettait en doute l’hypothèse de la rationalité du comportement des acteurs et de la mesurabilité des variables économiques
[p. 237-238]. Son mariage avec une psychologue l’a influencé profondément, car sous l’influence de son épouse, il a d’une part obtenu des connaissances en psychologie et d’autre part, en conversant à propos de leurs travaux respectifs, sa vision de la recherche en économie a évoluée [p. 239]. A partir de la fin des années 1980, il a commencé à faire des enquêtes auprès des acteurs économiques, ce qui était reçu de façon très sceptique de la part de la communauté des économistes. Il admet lui-même que ce type de recherche « n’avait pas grand sens du point de vue de sa carrière », mais lui et son épouse croyaient réellement dans la nécessité de faire ce type de recherche. Il trouvait que « les économistes, dans leurs modèles d’optimisation, attribuent implicitement aux gens des pensées qui ne sont pas réellement les leurs ». Il pensait que les économistes doivent réorienter leurs recherches vers l’analyse de ce qui disent les gens à propos de ce qu’ils pensent. Il confesse : « J’avais bien conscience que cette recherche n’optimiserait pas ma carrière. Mais quand j’ai commencé cette recherche, j’avais déjà un poste permanent, et je pensais que ce poste permanent me permettrait de ne pas faire ce que faisaient les autres » [p. 242]. De cette façon, Shiller est venu au paradigme constructiviste et son livre « L’Exubérance Irrationnelle », dans lequel il a prévu la crise, est l’aboutissement de son travail au sein de ce paradigme. Dans l’introduction de cet ouvrage, il souligne la nécessité de la recherche empirique détaillée [Shiller, 2005, p. xxi], et à la lecture de ce livre, on comprend bien que ce sont ses enquêtes, et non pas l’application de théories économiques de telle ou telle école, qui lui ont permis de comprendre le mécanisme de la création des « bulles ».
Un élément central de la réforme de l’institution de la science économique est la réforme de l’enseignement supérieur en économie. Je pense que cet enseignement doit se concentrer non pas sur la transmission aux étudiants des théories économiques, mais sur l’enseignement d’une méthodologie de recherche permettant de comprendre et de faire des prévisions des phénomènes économiques comme l’ont fait Robert Shiller, Paul Jorion et quelques autres à propos de l’arrivée de la crise actuelle. Je constate que cette méthodologie est celle qui était utilisée par l’école de Schmoller et celle de Commons. Cette méthodologie doit être enseignée en classe et sur le terrain. L’enseignement pratique de cette méthodologie doit représenter l’implication des étudiants dans la recherche des professeurs sur le terrain. De cette façon, les étudiants obtiendront non seulement la connaissance de cette méthodologie, mais également la compréhension des réalités économiques. John Commons nous fournit un modèle de ce type d’enseignement et de recherche : « Il était en contact, d’une part avec les ouvriers, et d’autre part avec les dirigeants d’industrie. Il frayait avec toutes classes de personnes. Il présentait dans le cadre de ses cours à ses étudiants des personnes [...], qui étaient considérés comme de très dangereux radicaux. Pour lui, ces personnes n’étaient simplement que des types humains, avec qui ses étudiants devaient faire connaissance face à face. D’autre part, il était simplement impatient de faire connaître à ses étudiants des capitalistes et des capitaines d’industrie. Il pouvait admirer un leader syndicaliste ; il pouvait comprendre le simple travailleur et il avait une grande admiration pour les grands capitaines d’industrie. Afin de comprendre leur point de vue, il est devenu membre de la Commission Industrielle de l’état du Wisconsin en prenant un congé à l’Université » [Ely, 1938, p. 187, 188].
La profession d’économistes en trois dimensions et la réforme de l’institution de la science économique
Ce qui précède me permet de proposer dans une première dimension une classification des économistes académiques du point de vue de leur méthodologie : « philosophes/ mathématiciens », « économétriciens/statisticiens » et « anthropologues/ historiens ». Ce qui unit les « philosophes » et « mathématiciens » c’est leur approche a priori. Dans la plupart des cas les « économétriciens/statisticiens » sont liés avec les « mathématiciens » en utilisant leurs modèles pour donner des explications et faire des prévisions sur la base des données purement quantitatives. Les « philosophes » sont fiers d’être héritiers des grands penseurs du passé qui ont influencé l’histoire de l’humanité par leurs projets socio-politico-économiques.Les capacités de la compréhension des phénomènes actuels par les « philosophes » sont limitées à cause de leur attachement à l’utilisation des « lunettes » de leur maîtres qui ne sont pas forcement adaptées pour l’analyse de ces phénomènes, et leur négligence envers les données détaillées qualitatives et quantitatives concernant ces phénomènes. Les « philosophes » et les « mathématiciens » partagent l’aspiration des Lumières envers les simplifications, et ont une sorte de mépris envers les descriptions en général mais surtout envers les descriptions détaillées. Les « mathématiciens » et les « économétriciens/ statisticiens » sont convaincus qu’ils suivent l’exemple des sciences naturelles ; pourtant, comme on l’a vu, ils suivent cet exemple de façon très superficielle en simulant leur caractère quantitatif mais ignorant leur trait principal : la « résistance » de l’objet d’étude au chercheur dans l’expérimentation. A présent, un nombre important de « philosophes/mathématiciens » et même d’« économétriciens/statisticiens » reconnaissent l’importance des institutions ; pourtant ils les considèrent comme un arrière plan de l’économie et non pas comme un premier plan. Les « philosophes/mathématiciens » sont moins inclinés à étudier les institutions existantes qu’à dire quelles institutions il faut introduire. Les économistes « anthropologues/historiens » ont totalement rompu avec l’héritage des Lumières dans la représentation de l’activité scientifique. Ils utilisent les interviews, l’observation participante, la recherche action et différents types d’analyses des données qualitatives et quantitatives, contemporaines et historiques, pour comprendre les phénomènes socio-politico-économiques. Leurs efforts pour comprendre ces phénomènes sont orientés vers l’étude des détails des règles que suivent les acteurs, et des croyances de ces acteurs qui légitiment (expliquent et justifient) ces règles. Le succès de leurs efforts provient du fait que les sources des régularités socio-économiques sont ces règles et croyances. A l’heure actuelle, la profession d’économiste est dominée par les « mathématiciens ». Les « économétriciens/statisticiens » sont bienvenus dans la profession s’ils s’engagent dans les utilisations et les vérifications/falsifications des théories/modèles des « mathématiciens ». Les « philosophes » sont tolérés dans la profession, surtout s’ils occupent la niche de l’histoire de la pensée économique. Par contre, l’apparition des ouvrages des économistes qui se révèlent par ces ouvrages comme « anthropologues/historiens » est rare et peut être considérée comme exceptionnelle [48].
Les économistes se considèrent comme scientifiques, pourtant ils se comportent souvent plutôt comme des ingénieurs [Mankiw, 2006]. Cela nous donne la deuxième dimension de la classification des économistes. L’activité normative de l’économiste peut prendre trois formes d’ingénierie sociale : 1) de l’économiste-ingénieur-philosophe ; 2) de l’économiste-ingénieur-mathématicien ; et 3) de l’économiste-ingénieur-anthropologue/ historien. Smith et Marx rentrent dans la première catégorie. Jevons, Walras, Samuelson et les spécialistes contemporains des produits financiers ([Mackenzie, 2006], ([Mackenzie, Minuesa et Siu, 2007]) représentent les économistes-ingénieurs de la deuxième catégorie. Keynes occupe une position entre les deux premières catégories. Enfin Schmoller et Commons jouaient le rôle des économistes ingénieurs de la troisième catégorie. Le danger de la construction des règles par les économistes-ingénieurs des deux premières catégories consiste dans le fait que leurs constructions sont soit totalement a priori, soit basées sur des observations assez lointaines qui ne fournirent pas les connaissances détaillées des règles et croyances en place. Les essais de réalisation de ces constructions soit provoque des résultats inattendus, soit sont rejetés ou déformés à cause de la « dépendance du sentier » (path dependency) inévitable en provenance des processus de l’accoutumance qui précèdent obligatoirement l’institutionnalisation. C’est l’économiste-ingénieur-anthropologue/historien qui a plus de chances de réussir avec les règles qu’il propose, grâce à la continuité et la gradualité des changements qu’il sollicite. Robert Shiller a évolué de l’économiste-mathématicien [1991] vers l’économiste-anthropologue/historien [2005] et l’économiste-ingénieur-anthropologue/historien [2008], en passant par l’économiste-ingénieur-mathématicien [1993] et l’économiste-ingénieur-philosophe [2003]. Sa qualité d’économiste-anthropologue/historien était accompagnée de façon très bénéfique par sa qualité de psychologue. Dans ses deux qualités, Shiller, sans le savoir, suivaient à la lettre les idées méthodologiques de Schmoller.
Du point de vue de leurs valeurs professionnelles, dans la troisième dimension de notre classification, on peut distinguer : les économistes « artistes », les économistes « fonctionnaires », les économistes « marchands », et les économistes « investigateurs altruistes ». Les « artistes » apprécient beaucoup la beauté de leurs produits académiques. Ce sont les économistes-mathématiciens qui insistent souvent sur cette valeur. Comme Paul Krugman le faisait remarquer, « la profession de la discipline économique s’est égarée parce que les économistes, en tant que groupe, ont pris faussement pour vérité la beauté habillée dans des impressionnantes apparences mathématiques » [New York Times, le 6 septembre 2009, ma traduction]. Les « fonctionnaires » pensent que la profession d’économiste académique est une profession comme toutes les autres, et que, faire leur travail comme il faut, signifie répondre aux attentes de leurs employeurs, clients et collègues. Le fait que la profession d’économistes est devenue la profession de fonctionnaires est une des causes de pourquoi les économistes n’ont pas prévu la crise. Un professeur de London School of Economics expliquait pourquoi personne ne pouvait prévoir la crise par le fait que tout le monde faisait le travail pour lequel ils étaient payés, sans se poser la question à propos de l’utilité sociale de ce qu’ils faisaient [49]]. Les économistes « marchands » sont convaincus que l’économiste académique doit répondre aux attentes du « marché » académique, c’est-à-dire suivre attentivement les directions de la production académique à la mode, qui permettent d’obtenir des financements, d’être bienvenus dans les revues professionnelles, aux conférences et séminaires, et qui doivent orienter leur production académique afin de mieux la « vendre ». Enfin pour les « investigateurs altruistes », l’étude des réalités économiques afin de les comprendre représente la valeur suprême, et ils considèrent les récompenses matérielles pour cette activité comme secondaires. A mon avis, Schmoller et Commons étaient des « investigateurs altruistes ». Schmoller travaillait dans l’université créée par Humboldt et Fichte, et partageait certainement la vision de Fichte de la profession de savant comme une vocation. Pour ce dernier, le savant est « appelé à rendre témoignage à la vérité » ; il doit « tout faire, tout oser et tout souffrir pour elle », même s’il « doit être poursuivi et haï » et « même mourir à son service » [Fichte, 1994, p. 78]. Un élève de Commons, Edwin E. Witte, qu’on appelle souvent « le père du système de la sécurité sociale américaine » témoignait à propos de son maître : « Il invitait ses étudiants à consacrer leurs vies à l’amélioration de notre mode de vie démocratique et de notre économie de la libre entreprise, pour lesquels il développait en eux non seulement une profonde admiration, mais aussi le sentiment que l’idée américaine est celle du progrès continu. Comme cela est fréquent chez les jeunes gens, beaucoup des étudiants de Commons n’étaient pas satisfaits des choses telles qu’elles étaient. Mais ils sortaient de ses cours en effet comme des hommes qui voulaient améliorer ce qu’ils pensaient être erroné, mais sans détruire notre structure politique, économique et sociale. Commons leur enseignait qu’ils doivent connaître à fond les faits et faire des propositions réalisables visant des améliorations. Il leur disait non seulement d’étudier tout ce qui était écrit sur un sujet donné, et de raisonner logiquement sur cela, mais de faire leurs propres observations, et de penser plutôt en terme de remèdes qu’en terme de critiques, et d’apprendre à partir des personnes directement concernées » [Harter, 1962, p. 77].
La plupart des économistes actuels sont des « artistes », « fonctionnaires » ou des « marchands », et des « philosophes/mathématiciens » accompagnés d’« économétriciens/ statisticiens ». Leur objectif principal est d’être reconnus et d’avoir des succès au sein de leur communauté professionnelle, et non pas de comprendre les phénomènes économiques, et de cette façon d’être utiles à la société. Un phénomène comme celui de la crise actuelle pouvait être prévu par des « anthropologues/historiens » qui étudient les détails de la réalité, et non pas par des « philosophes/mathématiciens » qui étudient des mondes imaginaires qui ne ressemblent que de très loin à la réalité. Dans les conditions institutionnelles actuelles, un économiste « anthropologue/historien » doit être inévitablement un « investigateur altruiste ».
Actuellement, la recherche économique est considérée comme la création ou l’interprétation de théories a priori et l’enseignement économique comme l’acquisition de connaissance de ces théories. Les théories des orthodoxes sont une sorte de « fables » [50] qui plongent les étudiants dans les mondes imaginaires. A l’heure actuelle, la plupart des économistes hétérodoxes, partisans de la réforme de l’enseignement supérieur économique, voient la sortie de ces mondes imaginaires dans le pluralisme. A mon sens, la discipline économique pluraliste ne sortira forcement pas des mondes imaginaires, mais plongera la discipline encore plus profondément dans la tradition de l’université médiévale, où la seule source des connaissances étaient les textes de référence. A vrai dire, les hétérodoxes n’ont pas besoin d’une réforme radicale de la discipline ; pour eux le changement désiré concerne juste les rapports de force dans le cadre de l’institution existante de la science économique, dont tous les éléments, tels que les programmes d’études, la politique des revues professionnelles, les critères de recrutement et de licenciement des enseignants-chercheurs, l’allocation de fonds de recherche, sont orientés vers la vision de la profession comme la production, le perfectionnement et l’enseignement des théories. De mon point de vue, la réforme de la recherche et de l’enseignement économique doit être radicale et basée sur l’idée humboldtienne de l’université de recherche où la science est considérée non pas comme l’ensemble des connaissances qu’il faut transmettre aux étudiants par les professeurs, mais comme un processus d’obtention des connaissances à propos du monde réel, processus mené ensemble par les enseignants-chercheurs et les étudiants. Dans ce cas, la profession tournera inévitablement vers l’application de la méthodologie de Schmoller-Commons. L’institution de la science économique radicalement réformée doit favoriser les économistes « investigateurs altruistes » qui travaillent comme « anthropologues/historiens ».
L’objectif de mon article était de monter qu’une autre science économique est possible, que cette science a déjà existé, qu’elle était très productive du point de vue des résultats pratiques, et qu’il faudrait maintenant restaurer cette tradition sur la base des techniques développées au sein de certains courants sociologiques et anthropologiques. Mon article peut être considéré comme un appel pour que cette absurdité que l’on nomme la « science économique » actuelle finisse - qu’elle soit du courant mainstream ou du courant hétérodoxe sans distinction -, et au lieu de produire des catastrophes [51], qu’une autre science économique produise des résultats positifs pour les nations, voire pour l’humanité toute entière, tout d’abord par la compréhension des réalités socio-politico-économiques et par la prévision de l’apparition de crises comme celle que nous subissons actuellement.
Mon message est le suivant : afin de restaurer sur une grande échelle la tradition de Gustav Schmoller et de John Commons, une réforme radicale de l’institution de la discipline économique est nécessaire. Les exemples des institutions allemande et américaine de la discipline économique qui favorisaient les « investigateurs altruistes » travaillant comme des « anthropologues/historiens » pourraient être utiles pour concevoir cette réforme. Le nœud de l’institution allemande était l’Union pour la politique sociale (Verein für Sozialpolitik) de Schmoller. Elle servait d’une part d’intermédiaire entre les chercheurs et l’Etat qui finançait leurs recherches, et d’autre part de structure qui organisait ces recherches. Les comités de l’union concernée formulaient les problèmes de recherches et commandaient directement ces recherches aux chercheurs individuels ou aux groupes de chercheurs membres de cette union. Leur principale méthode de recherche était l’enquête. Les associations professionnelles actuelles des économistes ne remplissent pas ces fonctions et n’en sont de toute façon pas capables. L’institution américaine de la discipline économique, dans le cadre de laquelle John Commons et ses élèves travaillaient, était fondée sur la liaison étroite de l’administration publique (en l’occurrence le gouverneur de l’Etat du Wisconsin) avec l’université de cet état. Leur principale méthode de recherche était la recherche action. La faculté des sciences économiques était devenue un laboratoire qui faisait des recherches et élaborait des propositions (y compris sous forme de projets d’actes législatifs) sur la réforme du système économique de cet état. L’influence de cette institution a eu ensuite des répercussions pratiques à l’échelon national américain. Je pence que la réforme de l’institution de la science économique doit suivre parmi d’autres ces deux voies.
Pour finir, je veux souligner que de façon similaire à la crise économique actuelle [52], la crise de la discipline économique provient de la crise morale. Les économistes académiques ont oublié leur rôle social, qui est de fournir à la société la compréhension des phénomènes socio-économiques. Ils ont perdu le sens de leur responsabilité. A mon avis, tous ceux qui partagent cette responsabilité doivent s’unir, suivant peut-être comme modèle l’Union pour la politique sociale, dans une association ayant pour objectif de contribuer au développement de la régulation financière, économique et sociale par les états, et à l’échelle mondiale, par les organismes internationaux.
Bibliographie
Aglietta M., 1976, Régulation et crise du capitalisme, Editions Calmann-Lévy, Paris.
Aglietta M. et A. Rebérioux, 2004, Dérives du capitalisme financier, Albin Michel, Paris.
Aglietta et Berrebi, 2007, Désordres dans le capitalisme mondial, Odile Jacob, Paris.
Aglietta et Rigot, 2009, Crise et rénovation de la finance, Odile Jacob, Paris.
Aglietta M., S. Khanniche et S. Rigot, 2010, Les hedge funds. Entrepreneurs ou requins de la finance ? Perrin, Paris.
Amable B. et S. Palombarini, 2005, L’économie politique n’est pas une science morale, Raison d’Agir, Paris.
Baker D. et M. Weisbrot, 1999, Social Security. The Phony Crisis. The University of Chicago Press, Chicago and London.
Bateman B.W., 1998, “Clearing the Ground : The Demise of the Social Gospel Movement and the Rise of Neoclassicism in American Economics” in [Morgan and Rutherford, 1998], p. 29 –52.
Berger P. et T. Luckmann, 1991, The Social Construction of Reality, Penguin Books, London.
Bewley T.F., 1999, Why Wages Don’t Fall during a Recession, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.
Blaug M., 1994, « Why I am not a Constructivist. Confession of an Unrepentant Popperian », in Backhouse R. E. (sous la direction de), New Directions in Economic Methodology, Routledge, Londres. p. 111 – 139.
Blaug M., 1998, La pensée économique, Economica, Paris.
Boyer R. et J. Mistral, 1978, Accumulation, inflation, crises, Presse universitaires de France, Paris.
Boyer R., M. Dehove et D. Plihon, 2004, Les crises financières, La documentation française, Paris.
Brennan G. et J. Buchanan, 1985, The Reason of Rules : Constitutional Political Economy, Cambridge University Press, New York.
Brousseau E. et J.-M. Glachant (sous la direction de), 2008, New Institutional Economics : A Guidebook, Cambridge University Press, New York.
Bryant A. et K. Charmaz, 2007, The Sage Handbook of Grounded Theory, Sage Publications, Thousand Oaks.
Burtt E., 2003, The Metaphysical Foundations of Modern Science, Dover Publications, New York.
Bush P.D., 1993, “The Methodology of Institutional Economics : A Pragmatic Instrumentalist Perspective”, in Tool M. R. (sous la direction de). Institutional Economics : Theory, Method, Policy, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London, p. 59 – 118.
Caillé A., 2007, « Présentation », La Revue du M.A.U.S.S. n° 30 : Vers une autre science économique (et donc un autre monde), (Second semestre 2007), La Découverte, Paris,
p. 5 – 28.
Caillé A. et alii, 2007, « Un quasi-manifeste institutionnaliste, suivi de Vers une économie politique institutionnaliste ? », La Revue du M.A.U.S.S. n° 30 : Vers une autre science économique (et donc un autre monde), (Second semestre 2007), La Découverte, Paris,
p. 33 – 48.
Carlson M.J., 1997, “Mirowski’s Thesis and the « Integrability Problem » in Neoclassical Economics”, Journal of Economic Issues, Vol. 31, N° 3, September, p. 741 - 760.
Charle Ch. et J. Verger, 2007, Histoire des universités. PUF, Paris.
Coats A.W., 1993, The Sociology and Professionalization of Economics. British and American economic essays. Volume II, Routledge, London and New York.
Cohen D., 2009, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète à l’économie), Albin Michel, Paris.
Combemale P., 2007, « L’hétérodoxie encore : continuer le combat, mais lequel ? », La Revue du M.A.U.S.S. n° 30 : Vers une autre science économique (et donc un autre monde) (Second sem. 2007), La Découverte, Paris, p. 56 – 67.
Commons J.R., 1964, Myself. The Autobiography of John R. Commons, The University of Wisconsin Press, Madison.
Comte A., 1996, Philosophie des Sciences, Gallimard, Paris.
Cunningham W., 1894, “Why had Roscher so little influence in England ?”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, November, p. 317 – 334.
Davis D.B., D.W. Hands and U. Maki (sous la direction de), 1998, The Handbook of Economic Methodology, Edward Elgar, Cheltenham.
Degnbol-Martinussen J., 2001, Policies, Institutions and Industrial Development. Coping with Liberalisation and International Competition in India, Sage Publications, New Delhi.
Denis H.,1966, Histoire de la pensée économique, Presses Universitaires de France, Paris.
Ely R.T., 1938, Ground under our Feet, Macmillan, New York.
Fichte J.G., 1994, La destination du savant, Vrin, Paris.
Fitoussi J.-P., 2001, L’Enseignement supérieur des sciences économiques en question, Fayard, Paris.
Forti A. et al., 1996, La mort de Newton. Maisonneuve et Larose, Paris.
Fourcade M., 2009, Economists and Societies. Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Friedman M., 1953, “Methodology of Positive Economics”, in Milton Friedman, Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago, p. 3 - 43.
Fullbrook E. (sous la direction de), 2008, Pluralist Economics, Zed Books, London & New-York.
Furner M.O., 1975, Advocacy & Objectivity : A Crisis in the Professionalization of American Social Science 1865-1905. University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky.
Galbraith J.K. (fils), The Predator State. How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too, 2008, Free Press, New York.
Geertz C., 1973, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York.
Gide Ch. et Ch. Rist, 2000, Histoire des doctrines économiques, Editions Dalloz – Sirey, Paris.
Goodwin C.D., 1998, “The Patrons of Economics in a Time of Transformation” in [Morgan and Rutherford, 1998], p. 53 – 81.
Gribbin J., 2003, Science. A History. 1543 – 2001. Penguin Books. London.
Grimmer-Solem E., 2003, The Rise of Historical Economics and Social Reform in Germany 1864 – 1894, Clarendon Press, Oxford.
Guerrien B., 2003, “Is there anything worth keeping in standard microeconomics ?”, in Fullbrook E. (sous la direction de), The Crisis in Economics, The post-autistic economics movement : the first 600 days, Routledge, London.
Hall P. A., 1992, “The movement from Keynesianism to monetarism : Institutional analysis and British economic policy in the 1970s”, in Steimo S., Thelen K. and F. Longstreth (sous la direction de), Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
Harter L.G., 1962, John R. Commons : His Assault on Laissez-Faire, Oregon State University Press, Corvallis.
Hay C., 2006, « Constructivist Institutionalism », in Rhodes R.A.W., Binder S.A. et B.A. Rockman (sous la direction de), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press, New York, p. 56 – 74.
Heilbroner R. L., 1971, Les grands économistes, Editions du Seuil, Paris.
Heilbroner R. L., 2004, “Economics as Universal Science”, Social Research, Vol. 71, N° 3, p. 615 – 632.
Hodgson, G.M., 1988, Economics and Institutions, Polity Press, Cambridge.
Hudson M., 2003, Super Imperialism. The Origins and Fundamentals of U.S. World Dominance, Pluto Press, London and New York.
Humboldt (von) W., 1979, « Sur l’organisation interne et externe des établissements scientifiques supérieurs à Berlin (1809 ou 1810) » in Philosophies de l’université. L’idéalisme allemand et la question de l’Université, Payot, Paris, p. 319 – 329. Jorion P., 2007, Vers la crise du capitalisme américain ? La Découverte, Paris.
Jorion P., 2008a, L’implosion. La finance contre l’économie. Ce que révèle et annonce la « crise des subprimes », Fayard, Paris.
Jorion P., 2008b, La crise. Des subprimes au séisme financier planétaire, Fayard, Paris.
Keynes J.M., 1963, Essays in Biography, W.W. Norton and Company, Inc., New York.
Knorr Cetina K., 1991, “Epistemic Cultures : Forms of Reason in Science”, History of Political Economy, No 1, v. 23, p. 105 – 122.
Labrousse A. et T. Lamarche, 2009, “Vers une association d’économie politique hétérodoxe ? Entretien avec Nicolas Postel et Richard Sobel », Revue de la régulation, Numéro 5 (1er semestre).
Latour B., 2000, “When things strike back : a possible contribution of ‘science studies’ to the social sciences”. British Journal of Sociology. Vol. 51, N° 1. pp. 107-123.
Latour B., 2006, Changer de société. Refaire de la sociologie, La Découverte, Paris.
Le Moigne J.-L., 2001, « Pourquoi je suis un constructiviste non repentant », La Revue du M.A.U.S.S. n° 17 : Chassez le naturel… Écologisme, naturalisme et constructivisme (Premier semestre 2001), La Découverte, Paris, p. 197-223.
MacKenzie D., 2006, An Engine, Not a Camera. How Financial Models Shape Markets, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.
MacKenzie D., 2007, Do Economists Make Markets ? Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Mankiw N. G., 2006, « The Macroeconomist as Scientist and Engineer, » Journal of Economic Perspectives, vol. 20(4), p. 29-46, Fall.
Marx K., 1993, Le Capital, Livre I, Presses universitaires de France, Paris.
Ménard C. and M.M. Shirley (sous la direction de), 2005, Handbook of New Institutional Economics, Springer, Dordrecht.
Menger C. (1883), Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere, Dunker u. Humblot, Leipzig.
Mill J.S., 1994, « On the definition and method of political economy » (1836). in D.M. Hausman (sous la direction de) The Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge University Press, Cambridge.
Mill J.S., 2008, Autobiography of John Stuart Mill (1873). Arc Manor, Rockville, Maryland.
Mini P., 1994, “Cartesianism in Economics”, in Hodgson, G.M., W.J. Samuels and M. R. Tool (sous la direction de), The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, in two volumes, Edward Elgar, Aldershot, pp. 38 – 42.
Mirowski Ph., 1989, More Heat than Light. Economics as Social Physics : Physics as Nature’s Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
Mittag G. (Leiter des Kollektivs), 1969, Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung in der DDR, Dietz Verlag, Berlin.
Morgan M.S. and M. Rutherford (sous la direction de), 1998, From Interwar Pluralism to Postwar Neoclassicism, Duke University Press, Durham and London.
Mucchielli A., (sous la direction de), 1996, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Armand Colin, Paris.
Nelson R.H., 2001, Economics as Religion. From Samuelson to Chicago and Beyond, The Pennsylvania State University Press, University Park.
North D.C., 2005, Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Paley W., 1817, Principes de philosophie morale et politique, Tomes 1 et 2, Treuttel et Wurtz, Paris. Reproduit en 2007 en deux volumes par Elibron Classics.
Paley W., 2009, Théologie Naturelle : Ou, Preuves de l’existence et des Attributs de la Divinité, Tirées des Apparences de la Nature, University of Michigan Library, Ann Arbor, Michigan.
Peukert H., 2001, “The Schmoller Renaissance”, History of Political Economy, Vol. 33, N° 1, Spring, p. 71-116.
Postel N., 2007, « Hétérodoxie et institution », La Revue du M.A.U.S.S. n° 30 : Vers une autre science économique (et donc un autre monde) (Second sem. 2007), La Découverte, Paris, p. 68 – 101.
Pouch T., 2001, Les économistes français et le marxisme. Apogée et déclin d’un discours critique (1959 – 2000), Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Prigogine I. et I. Stengers, 1986, La nouvelle alliance. Métamorphose de la science, Gallimard, Paris.
Reich R.B., 2007, Supercapitalism. The transformation of Business, Democracy, and Everyday Life, Albert A. Knopf, New York.
Rhodes R.A.W., Binder S.A. et B.A. Rockman (sous la direction de), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press, New York.
Rubinstein A., 2006, “Dilemmas of an Economic Theorist”. Econometrica, Vol. 74, No. 4 (July), p. 865–883.
Rutherford M., 2006, « Wisconsin Institutionalism : John R. Commons and his Students ». Labor History, 47 (May), p. 161 – 188.
Samuelson P.A. et W.A. Barnett, 2007, Inside the Economist’s Mind. Conversations with Eminent Economists, Blackwell, Oxford.
Schmoller G. 1883, « Zur Methodologie der Staats- und Sozial-Wissenschaften » in [Schmoller, 1998, S. 159 – 184].
Schmoller G., 1902, Politique sociale et économie politique, V. Giard & E. Brière. Paris. (Le texte du livre est accessible sur http://classiques.uqac.ca , les pages dans les références sont indiquées suivant cette version électronique)
Schmoller G., 1998, Historisch-ethnische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft, Metropolis-Verlag, Marburg.
Schumpeter J.A., 1983, Histoire de l’analyse économique, I – L’âge des fondateurs, Gallimard, Paris.
Secada J. Cartesian Metaphysics. The Scholastic Origins of Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge.
Simiand F., 2006, Critique sociologique de l’économie. Textes présentés par Jean-Christophe Marcel et Pholippe Steiner, Presses Universitaires de France, Paris.
Shapin S. et S. Schaffer, 1985, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Shapin S., 1996, The Scientific Revolution. The University of Chicago Press. Chicago and London.
Shiller R.J., 1991, Market Volatility, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.
Shiller R.J., 1993, Macro Markets. Creating Institutions for Managing Society’s Largest Economic Risks, Oxford University Press, New York.
Shiller R.J., 2003, The New Financial Order, Risk in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Shiller R.J., 2005, Irrational Exuberance, Second Edition, Broadway Books, New York.
Shiller R.J., 2008, The Subprime Solution. How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Suspitsyna T., 2005, Adaptation of Western Economics by Russian Universities. Intercultural Travel of an Academic Field, Routledge, New York.
Szenberg M. , Gottesman A. et L. Rarattan, 2005, Paul Samuelson. On being an Economist, Jorge Pinto Books, Inc., New York.
Tarde G., 1902, Psychologie économique, en deux volumes, Félix Alcan, Paris. (Le texte du livre est accessible sur http://classiques.uqac.ca )
Tribe K., 2002, Historical Schools of Economics : German and English. .Keele Economics Research Paper No 2, Keele University.
Usunier J.-C., Easterby-Smith M. et R. Thore, 2000, Introduction à la recherche en gestion, Economica, Paris.
Vidal J.-F., 2001, “Birth and Growth of the Regulation School in the French Intellectual Context (1970 – 1986)”, in Labrousse A. et J.-D. Weisz (sous la direction de), Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism versus French Regulation School, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Waterman A. M. C., 2004, Political Economy and Christian Theology since the Enlightenment. Essays in Intellectual History, Palgrave Macmillan, New York.
Weintraub E.R., 2002, How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press, Durham and London.
Wieviorka M., 2008, Neuf Leçons de Sociologie, Robert Laffont, Paris.
Wilkinson N., 2008, An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave-Macmillan, New York.
Willinger M. et N. Eber, 2005, L’économie expérimentale, La Découverte, Paris.
Yefimov V., 1981, “Gaming-simulation of the Functioning of Economic Systems”, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 2, N° 2, p.187 - 200.
Yefimov V., 2003, Economie institutionnelle des transformations agraires en Russie. l’Harmattan. Paris.
