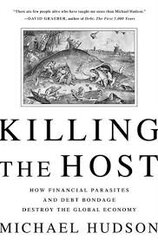
Tuer l’hôte : comment l’économie de prédation détruit l’économie de production
Introduction autobiographique
Dans ce court texte autobiographique passionnant qui est l’introduction de son ouvrage « Killing the Host : How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Economy », Michael Hudson explique la genèse picaresque d’une œuvre qui passe de la traduction avortée de Trotski à la traduction avortée de Lukacs, de son amitié avec Minsky à son travail d’analyste financier à Wall Street et des think-tanks politiques aux découvertes historiques, économiques et anthropologiques qui l’ont amenées à devenir chercheur à Harvard. Cet extrait est la genèse de l’œuvre qui restera peut-être dans l’histoire des idées comme la critique la plus lucide et la plus implacable du néolibéralisme.
Traduction : Thibault Mirabel et Christophe Petit
Je ne voulais pas être économiste. A l’Université de Chicago, je n’ai jamais suivi de cours d’économie ni approché une école de commerce. Mon intérêt portait sur la musique et l’histoire de la culture. Quand je suis parti à New York en 1961, c’était pour entrer dans l’édition. J’avais travaillé comme assistant de Jerry Kaplan au Free Press de Chicago et je pensais m’installer à mon compte lorsque le critique littéraire hongrois George Lukacs m’attribua les droits en langue anglaise sur ses écrits. Puis, en 1962, à la mort de Natalia Sedova, la veuve de Léon Trotsky, Max Schachman, exécuteur testamentaire de sa succession, me confia les droits sur les écrits et les archives de Trotsky. Mais je n’ai pu intéresser aucune maison d’édition à soutenir leur publication. Mon avenir s’est avéré ne pas être dans la publication des travaux d’autrui.
En une seule soirée, ma vie bascula. Mon meilleur ami de Chicago avait insisté pour que je rencontre Terence McCarthy, le père de l’un de ses camarades de classe. Terence était un ancien économiste de General Electric et l’auteur du « Plan Forgash ». Nommé en l’honneur du sénateur de Floride Morris Forgash, il proposait une Banque mondiale pour l’accélération économique assortie d’une politique alternative pour la Banque mondiale - prêts en monnaie nationale pour la réforme agraire et une plus grande autosuffisance en nourriture au lieu des cultures d’exportation.
Lors de cette première soirée avec lui, je fus transpercé par deux idées qui sont devenues le travail de ma vie. La première était sa description presque poétique du flux de fonds au travers du système économique. Il expliquait pourquoi la plupart des crises financières apparaissent historiquement en automne au moment où les récoltes sont exportées. Des changements dans le niveau de l’eau du Midwest ou des perturbations climatiques dans d’autres pays provoquaient des sécheresses périodiques, qui entraînaient de mauvaises récoltes et des pertes pour le système bancaire, obligeant les banques à demander le paiement des emprunts. La finance, les ressources naturelles et l’industrie faisaient partie d’un système interconnecté, à l’instar de l’astronomie - et pour moi une part esthétique de beauté. Mais contrairement aux cycles astronomiques, les mathématiques de l’intérêt composé conduisent inévitablement les économies à un effondrement de la dette, car le système financier se développe plus rapidement que l’économie sous-jacente, la surchargeant de dettes et les crises deviennent de plus en plus graves. Les économies se déchirent alors par des ruptures dans les chaînes de paiement.
C’est ce soir là que j’ai décidé de devenir économiste. Peu après, je m’inscrivis en études supérieures et cherchait du travail à Wall Street, ce qui était le seul moyen pratique de voir comment les économies fonctionnaient réellement. Au cours des vingt années suivantes, Terence et moi avons parlé environ une heure par jour de l’actualité économique. Il avait traduit Une histoire de doctrines économiques : des physiocrates à Adam Smith, la première version anglaise de la Théorie de la Survaleur de Marx - qui était elle-même la première véritable histoire de la pensée économique. Pour commencer, il m’invita à lire tous les livres de sa bibliographie - les physiocrates, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, etc.
Les sujets qui m’intéressaient le plus - et le sujet de ce livre - n’étaient pas enseignés à l’Université de New York, où j’ai obtenu mon diplôme d’études supérieures en économie. En fait, ils ne sont enseignés dans aucun département universitaire : la dynamique de la dette et la manière dont les prêts bancaires gonflent les prix de la terre et les chiffres de la comptabilité du revenu national ainsi que la part croissante absorbée par l’extraction de la rente dans les secteurs de la finance, des assurances et de l’immobilier (FIRE sector) [1]. Il n’y avait qu’un moyen d’apprendre à analyser ces sujets : travailler pour les banques. Dans les années 1960, il n’était pas évident que ces tendances deviendraient une grande bulle financière. Mais la dynamique était là et j’eus la chance d’être embauché pour les cartographier.
Mon premier travail était aussi banal que possible : économiste pour la Savings Bank Trust Company. Ce fonds d’épargne, qui n’existe plus, avait été créé à l’époque par les 127 banques d’épargne de New York (aujourd’hui également éteintes, saisies, privatisées et vidées par des banquiers commerciaux). Je fus embauché pour décrire comment l’épargne accumulait des intérêts et était convertie en de nouveaux prêts hypothécaires. Mes graphiques illustrant cette hausse de l’épargne ressemblaient à la « Vague » d’Hokusai, mais avec un pouls qui atteignait son pic avec la régularité d’un cardiogramme tous les trois mois, le jour où les dividendes trimestriels étaient crédités.
L’épargne accumulée fut prêtée aux acheteurs de maison, contribuant à alimenter l’inflation du logement de l’après Seconde Guerre Mondiale. Cela était perçu comme un moteur apparemment sans fin de prospérité, dotant la classe moyenne d’une valeur nette croissante. Plus les banques prêtent, plus les prix des biens immobiliers achetés à crédit augmentent. Et plus les prix montent, plus les banques sont enclines à prêter - tant que d’autres personnes se rejoignent ce qui ressemble à une machine de création de richesse à mouvement perpétuel.
Le processus ne fonctionne que tant que les revenus augmentent. Peu de gens s’aperçoivent que la plus grande partie de la croissance des revenus sert à payer le logement. Ils ont le sentiment d’épargner et de s’enrichir en payant pour un investissement en croissance. C’est du moins ce qui a fonctionné pendant soixante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.
Mais les bulles éclatent toujours, car elles sont financées par une dette qui croît exponentiellement à la manière d’une chaîne de lettres. Le service de la dette hypothécaire absorbe de plus en plus la valeur locative de l’immobilier et le revenu des propriétaires augmente à mesure que les nouveaux acheteurs contractent davantage de dettes pour acheter des maisons dont les prix augmentent.
Le suivi de la hausse de l’épargne et de la hausse des prix du logement financée par la dette s’est avéré le meilleur moyen de comprendre comment la plupart des « richesses virtuelles » ont été créés (ou ont au moins gonflées) au cours des dernières décennies. Pourtant, bien que l’actif le plus important de l’économie soit l’immobilier - et qu’il soit à la fois l’actif principal et la plus grande dette de la plupart des familles - l’analyse de la valorisation de la rente foncière n’apparaissait même pas dans les cours que je suivais en vue de mon doctorat en économie.
Lorsque j’ai terminé mes études en 1964, je rejoignis le département de recherche de la Chase Manhattan en tant qu’économiste de la balance des paiements. Cela s’est avéré être une expérience très instructive, car la seule façon d’apprendre sur le sujet était de travailler pour une agence de statistique bancaire ou gouvernementale. Ma première tâche consistait à prévoir la balance des paiements de l’Argentine, du Brésil et du Chili. Le point de départ était les recettes d’exportation et les autres recettes en devises, qui servaient à mesurer le montant des recettes pouvant être versées au titre du service de la dette pour les nouveaux emprunts contractés auprès de banques américaines.
Tout comme les prêteurs hypothécaires considèrent les revenus locatifs comme un flux devant être converti en paiement d’intérêts, les banques internationales considèrent les recettes en devises des pays étrangers comme des revenus potentiels à convertir en prêts et à payer en intérêts. L’objectif implicite des services de marketing des banques - et des créanciers en général - est d’attacher l’ensemble du surplus économique au paiement du service de la dette.
J’ai vite constaté que les pays d’Amérique latine analysés étaient pleinement « prêtés ». Il n’existait plus d’afflux en devises fortes à extraire en tant qu’intérêts sur de nouveaux emprunts ou émissions d’obligations. En fait, il y avait une fuite de capitaux. Ces pays ne pourraient payer ce qu’ils devaient déjà que si leurs banques (ou le FMI) leur prêtaient l’argent nécessaire pour faire face au flux croissant des charges d’intérêts. C’est ainsi que les prêts aux gouvernements souverains ont été reconduits dans les années 1970.
Leurs dettes extérieures se sont accrues au taux d’intérêt composé, une croissance exponentielle qui jetait les bases du krach survenu en 1982, lorsque le Mexique annonça qu’il ne pourrait pas payer. À cet égard, les prêts aux gouvernements des pays du tiers monde préfigurent la bulle immobilière qui allait s’effondrer en 2008. Sauf que les dettes du tiers monde furent amorties dans les années 1980 (via les obligations Brady), contrairement aux dettes hypothécaires.
Mon expérience d’apprentissage la plus importante à la Chase fut de développer un format de comptabilité pour analyser la balance des paiements de l’industrie pétrolière américaine. Les dirigeants de Standard Oil m’ont aidé à saisir le contraste entre les statistiques économiques et la réalité. Ils m’expliquèrent comment l’utilisation de « pavillons de complaisance » au Libéria et au Panama leur permettait d’éviter de payer des impôts sur le revenu, que ce soit dans les pays producteurs ou consommateurs, en leur donnant l’illusion de ne réaliser aucun profit. La clé était le « prix de transfert ». Les filiales d’expédition de ces centres d’évasion fiscale achetaient du pétrole brut à bas prix dans les succursales du Proche-Orient ou du Venezuela où le pétrole était produit. Ces centres maritimes et bancaires - qui ne percevaient aucun impôt sur les bénéfices - vendaient ensuite ce pétrole à des prix majorés à des raffineries situées en Europe ou ailleurs. Les prix de transfert étaient fixés suffisamment haut pour ne laisser aucun profit à déclarer.
En termes de balance des paiements, chaque dollar dépensé par l’industrie pétrolière à l’étranger était restitué à l’économie américaine en seulement 18 mois. Mon rapport fut placé sur le bureau de chaque sénateur et membre du Congrès américain et permit à l’industrie pétrolière d’être exemptée des contrôles de balance des paiements imposés par le Président Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam.
Ma dernière tâche à la Chase fit partie du problème du dollar. On me demanda d’estimer le volume de l’épargne criminelle cachée en Suisse et dans d’autres planques. Le département d’État avait demandé à la Chase et à d’autres banques d’établir des branches caribéennes pour attirer l’argent des trafiquants de drogue, des contrebandiers et de leurs proches sous forme d’actifs en dollars afin de soutenir le dollar face à l’escalade des dépenses militaires à l’étranger. Le Congrès aida en suspendant la retenue d’impôt de 15% sur les intérêts des obligations du Trésor. Mes calculs montrèrent que les facteurs les plus importants pour déterminer les taux de change n’étaient ni les échanges commerciaux ni les investissements directs, mais les « erreurs et omissions », un euphémisme pour « flux de capitaux spéculatifs » (hot money). Personne n’est plus « liquide » ou « brûlant » que les trafiquants de drogue et les fonctionnaires détournant les recettes d’exportation de leur pays. Le Trésor américain et le Département d’État cherchaient à constituer un refuge sûr pour leurs recettes, en tant que moyen désespéré de compenser le coût des dépenses militaires des États-Unis pour leur balance des paiements.
En 1968, j’élargis mon analyse des flux de paiement pour couvrir l’ensemble de l’économie américaine, en travaillant sur un projet d’un an pour le cabinet comptable (maintenant disparu) Arthur Andersen. Mes graphiques révélèrent que le déficit des paiements des États-Unis était pleinement militaire dans les années 1960. Le secteur privé - le commerce extérieur et les investissements - était exactement équilibré année après année, et « l’aide étrangère » dégageait en réalité un excédent en dollars (et était tenue de le faire conformément au droit américain).
Ma monographie me valut une invitation à prendre la parole devant la faculté d’économie de la New School en 1969, où il s’avérait qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour enseigner le commerce et les finances internationales. On m’a offert le travail immédiatement après ma conférence. N’ayant jamais suivi de cours sur ce sujet à NYU, je pensais que l’enseignement serait le meilleur moyen de savoir ce que la théorie académique en disait.
J’ai vite découvert que, de toutes les sous-disciplines de l’économie, la théorie du commerce international était la plus sotte. Les navires de guerre et les dépenses militaires n’apparaissent pas dans cette théorie, pas plus que les très importantes « erreurs et omissions », la fuite des capitaux, la contrebande ou les prix de transfert fictifs en vue de l’évasion fiscale. Ces élisions sont nécessaires pour orienter la théorie du commerce vers la conclusion perverse et destructrice selon laquelle tout pays peut payer n’importe quel montant de dette, simplement en abaissant suffisamment les salaires pour payer les créanciers. Tout ce qui semble être nécessaire est une dévaluation suffisante (principalement le coût de la main-d’œuvre locale) ou une réduction des salaires par des « réformes » du marché du travail et des programmes d’austérité. Cette théorie s’est avérée fausse partout où elle a été appliquée, mais elle reste l’essence même de l’orthodoxie du FMI.
La théorie monétaire académique est encore pire. L’Ecole de Chicago de Milton Friedman ne relie l’offre de monnaie qu’aux prix des produits de base et des salaires, et non aux prix des actifs immobiliers, des actions et des obligations. Il prétend que l’argent et le crédit sont prêtés aux entreprises pour investir dans des biens d’équipement et pour créer de l’emploi, et non pour acheter de l’immobilier, des actions et des obligations. Il y a peu d’effort pour prendre en compte le service de la dette qui doit être payé sur ce crédit, en détournant les dépenses des biens de consommation et des biens d’équipement tangibles. J’ai donc trouvé que la théorie académique était l’inverse de la façon dont le monde fonctionne réellement. Aucun de mes professeurs n’avait assez d’expérience de travail dans le secteur bancaire ou à Wall Street pour le remarquer.
J’ai passé trois ans à la New School à analyser les raisons pour lesquelles l’économie mondiale se polarise plutôt qu’elle ne converge. Je trouvais que les théories économiques « mercantilistes » du XVIIIe siècle étaient déjà en avance sur le courant mainstream actuel. Je vis également à quel point les premiers économistes avaient clairement reconnu les problèmes des gouvernements (ou autres) qui comptaient sur les créanciers pour obtenir des conseils en matière de politique. Comme Adam Smith l’expliquait,
« un créancier du public, considéré simplement comme tel, n’a aucun intérêt dans le bon état d’une partie d’un terrain, ni dans la bonne gestion d’une partie du stock de capital. (...) Il n’a aucune inspection de celui-ci. Il ne peut pas s’en soucier. Dans certains cas, sa perte peut lui être inconnue et ne peut l’affecter directement. »
L’intérêt des porteurs d’obligations est uniquement de dégager le plus d’argent possible le plus rapidement possible sans se préoccuper de la dévastation sociale qu’ils provoquent. Pourtant, ils ont réussi à faire passer l’idée que les nations souveraines ainsi que les individus ont l’obligation morale de payer leurs dettes, voir d’agir pour le compte de créanciers au lieu de leurs populations nationales.
Mon avertissement que les pays du tiers-monde ne pourraient pas payer leurs dettes perturba le président du département, Robert Heilbroner. Trouvant l’idée impensable, il se plaignit du fait que mon angle d’étude sur les frais généraux détournait les étudiants de la principale forme d’exploitation, à savoir le travail salarié de ses employeurs. Même les professeurs marxistes qu’il embaucha ne prêtèrent pas beaucoup d’attention aux intérêts, à l’endettement ou à l’extraction de rente.
Je constatais une aversion similaire de la gauche face aux problèmes d’endettement lorsque je fus invité à des réunions à l’Institute for Policy Studies de Washington. Lorsque j’exprimais mon intérêt pour préparer le terrain en vue de l’annulation des dettes du tiers monde, le co-directeur d’IPS, Marcus Raskin, déclara qu’il pensait qu’ils étaient trop loin du mur pour qu’ils puissent en revenir. (Il fallut une autre décennie, jusqu’en 1982, pour que le Mexique déclenche la « bombe de la dette » de l’Amérique latine en annonçant son incapacité de payer susmentionnée.)
En 1972, j’ai publié mon premier ouvrage majeur, Super Imperialism : The Economic Strategy of American Empire, expliquant en quoi le fait de retirer le dollar américain de l’or en 1971 ne laissait que la dette du Trésor américain comme base des réserves mondiales. Le déficit de la balance des paiements imputable aux dépenses militaires étrangères injectait des dollars à l’étranger. Ces derniers finirent entre les mains des banques centrales qui les recyclèrent aux États-Unis en achetant des titres du Trésor, qui à leur tour financèrent le déficit budgétaire intérieur. Cela donne à l’économie américaine un avantage financier unique et gratuit. Il est apparemment capable d’autofinancer ses déficits à l’infini. Le déficit de la balance des paiements finit par financer le déficit du budget intérieur pendant de nombreuses années. Le système financier international post-or obligeait les pays étrangers à financer les dépenses militaires américaines, qu’ils les soutiennent ou non.
Certains de mes amis de Wall Street m’aidèrent à sortir du monde universitaire pour rejoindre le think-tank d’Herman Kahn à l’Institut Hudson. Le ministère de la Défense passa un important contrat avec l’Institut, me demandant d’expliquer comment les États-Unis pouvaient se comporter en passager clandestin. Je commençais aussi à écrire un bulletin d’information du marché pour une maison de courtage à Montréal, Wall Street semblant plus intéressée par mon analyse des flux de fonds que la gauche. En 1979, j’écrivais Global Fracture : The New International Economic Order, dans lequel je prédisais comment la domination unilatérale des États-Unis conduirait à une scission géopolitique sur le plan financier, à l’instar des chapitres internationaux du présent ouvrage, qui décrivent les tensions fracturant l’économie mondiale actuelle.
Plus tard dans la décennie, je devins conseiller auprès de l’Institut des Nations Unies pour la formation et le développement (UNITAR). Ici, mon objectif était aussi de prévenir que les économies du tiers monde ne pourraient pas payer leurs dettes extérieures. La plupart de ces prêts furent contractés pour subventionner la dépendance au commerce et non pour restructurer les économies afin de leur permettre de payer. Les programmes d’austérité « d’ajustement structurel » du FMI - du type actuellement en vigueur dans la zone euro - aggravent la situation de la dette en augmentant les taux d’intérêt et les impôts sur le travail, en réduisant les retraites et les dépenses de sécurité sociale et en vendant les infrastructures publiques (en particulier les banques, les droits sur l’eau et les minéraux, les communications et les transports) aux monopoleurs à la recherche de rentes. Ce type d ’« ajustement » renforce la guerre des classes dans le business, à l’échelle internationale.
La clé de voûte du projet UNITAR fut une réunion tenue à Mexico en 1980 par son ancien président, Luis Echeverria. Un combat éclata suite à mon insistance sur le fait que les débiteurs du tiers monde seraient bientôt en défaut de paiement. Bien que les banquiers de Wall Street voient généralement les signes avant coureurs, leurs lobbyistes insistent pour que toutes les dettes puissent être payées, de sorte qu’ils puissent reprocher aux pays de ne pas « se serrer la ceinture ». Les banques ont intérêt à nier les problèmes évidents de paiement des « transferts de capitaux » en monnaie forte.
Mon expérience avec ce type d’économies subventionnées par les banques qui ont infecté les agences publiques m’incita à commencer à compiler un historique de la façon dont les sociétés, à travers les âges, gèrent leurs problèmes d’endettement. Il me fallut environ un an pour esquisser l’histoire des crises de la dette en remontant à la Grèce et la Rome classiques, ainsi qu’au contexte biblique de l’année jubilaire. Mais ensuite, je découvrais une préhistoire de pratiques d’endettement remontant à Sumer au troisième millénaire avant JC. Le matériel était largement dispersé dans la littérature, aucune histoire de cette genèse formatrice de la civilisation économique occidentale n’ayant été écrite.
Après des années d’étude, ce ne fut qu’en 1984 que je pus reconstituer comment la dette portant intérêt vit le jour - dans les temples et les palais, et non pas entre particuliers. La plupart des dettes étaient dues à ces grandes institutions publiques ou à leurs collecteurs, ce qui explique pourquoi les dirigeants pouvaient annuler des dettes aussi souvent : ils annulaient des dettes afin d’éviter toute perturbation de leurs économies. J’ai montré mes découvertes à certains de mes collègues universitaires. Je finis par être invité à devenir chercheur en histoire économique babylonienne au Peabody Museum de Harvard (son département d’anthropologie et d’archéologie).
Pendant ce temps, je continuais à faire du consulting pour des clients financiers. En 1999, Scudder, Stevens & Clark m’engagèrent pour contribuer à la création du premier fonds d’obligations souveraines au monde. On m’a dit que dans la mesure où j’étais connu comme « Professeur Fatalisme » s’agissant des dettes du tiers monde, si ses directeurs généraux pouvaient me convaincre que ces pays continueraient à payer leurs dettes pendant au moins cinq ans, la firme créerait un fonds à liquidation automatique de cette durée. Ce fonds est devenu le premier fonds souverain - un fonds offshore enregistré dans les Antilles néerlandaises et négocié à la Bourse de Londres.
Les nouveaux prêts à l’Amérique latine avaient cessé, laissant les pays débiteurs tellement désespérés pour des fonds que les obligations en dollars argentins et brésiliens rapportaient 45% des intérêts annuels et les tessobonos à moyen terme mexicains plus de 22%. Cependant, les tentatives de vente des actions du fonds à des investisseurs américains et européens échouèrent. Les actions furent vendues à Buenos Aires et à San Paolo, principalement aux élites qui détenaient les obligations à haut rendement en dollars de leur pays dans des comptes offshore. Cela nous montra que les gestionnaires financiers continueraient en effet à payer les dettes extérieures de leurs gouvernements tant qu’ils se paieraient eux-mêmes en tant que « détenteurs d’obligations yankees » à l’étranger. Le fonds Scudder atteignit le deuxième taux de rendement le plus élevé au monde en 1990.
Au cours de ces années, je proposais aux éditeurs grand public d’écrire un livre mettant en garde contre le krach de la bulle. Ils me firent savoir que c’était comme dire aux gens que le bon sexe cesserait prématurément. Ne pourrais-je pas donner une bonne nouvelle contre ces sombres prévisions et dire aux lecteurs comment ils pourraient s’enrichir lors du prochain crash ? J’en conclus que la majorité du public ne s’intéresse à comprendre un grand crash uniquement après son déclenchement, et non pendant la phase préparatoire au cours de laquelle de bons rendements doivent être obtenus. Être le Professeur Fatalisme au sujet de la dette était comme être un antifasciste prématuré.
Je décidais donc de me concentrer sur mes recherches historiques et, en mars 1990, je présentais mon premier article résumant trois conclusions aussi radicales d’un point de vue anthropologique que tout ce que j’avais écrit en économie. L’économie traditionnelle était encore sous l’emprise d’une idéologie individualiste « autrichienne » spéculant sur le fait que l’imposition d’intérêts était un phénomène universel datant d’individus paléolithiques faisant progresser des bovins, des semences ou de l’argent vers d’autres individus. Mais j’ai trouvé que les premiers et de loin les principaux créanciers étaient les temples et les palais de la Mésopotamie de l’âge du bronze, et non des particuliers agissant seuls. L’imposition d’un taux d’intérêt fixe semble s’être répandue de la Mésopotamie à la Grèce classique et à Rome vers le VIIIe siècle av. JC. Le taux d’intérêt dans chaque région n’était pas basé sur la productivité, mais était déterminé par simple simplicité de calcul dans le système local d’arithmétique fractionnaire : 1/60e par mois en Mésopotamie, puis 1/10e par an en Grèce, et 1/12e à Rome.
Aujourd’hui, ces idées sont acceptées dans les disciplines assyriologiques et archéologiques. En 2012, le livre de David Graeber La dette, 5 000 ans d’histoire joignait les divers volets de ma reconstruction de l’évolution précoce de la dette et de son annulation fréquente. Au début des années 1990, j’avais essayé d’écrire mon propre résumé, mais j’étais incapable de convaincre les éditeurs que la tradition des annulations de dette biblique au Proche-Orient était fermement ancrée. Il y a deux décennies, les historiens de l’économie et même de nombreux chercheurs bibliques pensaient que l’année du jubilé n’était qu’une création littéraire, une évasion utopique de la réalité. J’ai dû faire face à un mur de dissonance cognitive à la pensée que cette pratique était attestée par des proclamations de plus en plus détaillées de table rase.
Chaque région avait son propre mot pour de telles proclamations : en sumérien amargi, ce qui signifie un retour à la condition de « mère »(ama), un monde en équilibre ; en babylonien Misharum , ainsi que l’andurarum, emprunté par la Judée comme deror, et le shudutu hurrien. La pierre de Rosette, en Égypte, se réfère à cette tradition d’amnistie pour les dettes et pour libérer les exilés et les prisonniers. Au lieu du caractère sacré de la dette, ce qui était sacré était l’annulation régulière des dettes agraires et la libération des serviteurs afin de préserver l’équilibre social. Ces amnisties ne sont pas déstabilisantes mais essentielles pour préserver la stabilité sociale et économique.
Pour obtenir le soutien des professions d’assyriologie et d’archéologie, Harvard et certaines fondations de donateurs m’aidèrent à créer l’Institut pour l’étude des tendances économiques à long terme (ISLET). Notre plan était de tenir une série de réunions tous les deux ou trois ans afin de retracer les origines de l’entreprise économique et sa privatisation, son régime foncier, sa dette et son argent. Notre première réunion eut lieu à New York en 1984 sur la privatisation dans le Proche-Orient ancien et l’antiquité classique. Aujourd’hui, deux décennies plus tard, nous avons publié cinq volumes réécrivant les débuts de l’histoire économique de la civilisation occidentale. En raison de leur contraste avec les règles actuelles en faveur des créanciers - et du succès d’une économie mixte privée/publique -, je cite fréquemment dans ce livre la manière dont les sociétés antérieures ont résolu leurs problèmes d’endettement, contrairement à la manière dont le monde actuel laisse les dettes se polariser et énerver les économies.
Au milieu des années 1990, Hyman Minsky et ses collaborateurs élaborèrent une théorie financière plus réaliste, d’abord au Levy Institute du Bard College, puis à l’Université du Missouri à Kansas City (UMKC). Je devins chercheur associé au Levy, spécialisé dans l’immobilier et la finance, et rejoignit rapidement Randy Wray, Stephanie Kelton et d’autres qui furent invités à mettre en place un programme d’études sur la Théorie Monétaire Moderne (UMKC). Au cours des vingt dernières années, notre objectif était de montrer les mesures nécessaires pour éviter le chômage et le vaste transfert de propriété des débiteurs aux créanciers qui déchirent aujourd’hui les économies.
J’ai présenté mon modèle financier de base à Kansas City en 2004, avec un graphique que j’ai recopié dans mon article faisant la couverture de mai 2006 du Harper’s Magazine. Le Financial Times reproduisit le graphique en me faisant passer pour un des huit économistes à avoir prédit le krach de 2008. Mais mon objectif n’était pas simplement de le prédire. Tout le monde sauf les économistes l’a vu venir. Mon graphique expliquait la dynamique financière exponentielle qui rend les collisions inévitables. Par la suite, j’écrivis une série d’éditoriaux pour le Financial Times portant sur la Lettonie et l’Islande en tant que répétition générale pour le reste de l’Europe et les États-Unis.
La force handicapante de la dette était clairement reconnue aux XVIIIe et XIXe siècles (pour ne pas mentionner l’âge du bronze d’il y a quatre mille ans). Cela conduisit les économistes pro-créanciers à exclure l’histoire de la pensée économique des programme d’économie. L’économie mainstream est devenue, par la censure, pro-créancière, pro-austérité (c’est-à-dire anti-travail) et antigouvernementale (sauf pour insister sur la nécessité d’un renflouement des contribuables des plus grandes banques et épargnants). Pourtant, cette vision s’est répandue dans la politique du Congrès, les universités et les médias pour diffuser une fausse carte du fonctionnement des économies. La plupart des gens voient donc la réalité telle qu’elle est écrite - et déformée - par les 1%. C’est une parodie de la réalité.
Jaillissant de l’idéologie ostensible du libre marché, le courant mainstream des créanciers rejette ce que les réformateurs économiques classiques ont réellement écrit. Il ne reste plus qu’à choisir entre une planification centralisée par une bureaucratie publique ou une planification encore plus centralisée par la bureaucratie financière de Wall Street. Le juste milieu d’une économie mixte publique / privée a été presque oublié - dénoncé comme « socialiste ». Pourtant, toutes les économies prospères de l’histoire étaient des économies mixtes.
Pour aider à remédier à la situation, ce livre explique comment la montée en puissance de l’épargne et de la dette a été politisée pour contrôler les gouvernements. L’ampleur de la dette tend à augmenter jusqu’à ce qu’un krach financier, une guerre ou une décision politique de réduction de la dette se produisent. Le problème ne concerne pas simplement la dette, mais les économies réalisées du côté « actifs » du bilan (principalement détenues par le 1%). La plupart de ces économies sont prêtées pour devenir les dettes des 99%.
En ce qui concerne la dynamique financière dans le secteur des entreprises, les « actionnaires activistes » et les commanditaires d’entreprises subventionnent actuellement l’industrie de la financiarisation de manière à réduire au lieu de promouvoir la formation de capital et d’emploi. Le crédit est de plus en plus prédateur au lieu de permettre aux débiteurs personnels, aux entreprises et aux gouvernements de gagner de l’argent.
Cette structure de la dette correspond à ce que les économistes classiques définissaient comme improductif, favorisant les revenus de prédation (rente économique) et les gains spéculatifs par rapport aux bénéfices réalisés en employant du travail pour produire des biens et des services. Je commence donc par examiner comment les Lumières et les premiers économistes du marché libre ont passé deux siècles à empêcher précisément le type de domination du rentier qui étouffe les économies actuelles et renverse les démocraties pour créer des oligarchies financières.
Afin de préparer le terrain à cette discussion, il est nécessaire d’expliquer que ce qui est à l’œuvre est une stratégie orwellienne de supercherie rhétorique visant à représenter la finance et les autres secteurs rentiers comme faisant partie de l’économie et ne lui étant pas extérieure. C’est précisément la stratégie que les parasites de la nature utilisent pour tromper leurs hôtes, à savoir faire croire qu’ils ne sont pas des cavaliers solitaires, mais font partie de leur propre corps et méritent une protection minutieuse.
