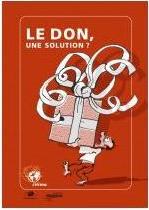
Cet article est tiré de Le don, une solution ?, Ritimo, Cap Humanitaires, Peuples Solidaires, Ed.Ritimo, juillet 2006. Cet ouvrage est un guide réalisé par Ritimo, réseau d’information spécialisé sur la solidarité internationale et le développement, en partenariat avec Cap Humanitaire (devenu depuis Cap Solidarités), association sensibilisant le public à la problématique du don de matériel et la Fédération Peuples Solidaires regroupant plus de 70 associations locales agissant contre les causes du mal développement. Il est possible de le commander sur les sites des associations
Nous avons une connaissance de plus en plus étendue de ce qui se passe sur la planète, nous ne pouvons plus ignorer l’existence de famines, de populations victimes de raz-de-marée ou de conflits armés et nous constatons chaque jour l’existence d’inégalités révoltantes. Cela provoque des émotions bien naturelles et nous conduit à vouloir aider les autres. Une pratique apparemment évidente est de donner : donner des couvertures, des médicaments, des livres, donner ce que l’on a et qui – on l’imagine – sera utile à l’autre. Ce « réflexe » est à l’origine de nombreuses collectes et de convois dits « humanitaires ».
Les paradoxes du don
À travers l’aide que l’on apporte se révèle l’image que nous avons des victimes, des pauvres et des autres en général, la réflexion sur les inégalités à l’échelle mondiale et nos façons d’envisager des solutions. Expressions de la citoyenneté, de la générosité, ou conscience d’une responsabilité collective mondiale, les dons cherchent à restaurer l’égalité entre les Hommes mise à mal par les injustices ou le sort. Mais, comme le dit la sagesse populaire, l’enfer est pavé de bonnes intentions : même avec les meilleures motivations, on peut ne pas rendre service. Aider n’est pas une chose aisée, et aider des personnes éloignées géographiquement et culturellement encore moins. D’autant que les représentations que nous nous en faisons sont souvent biaisées par l’histoire (colonisation, décolonisation) et une forte méconnaissance des cultures, des histoires et des situations concrètes.
Comment être solidaire sans nuire ? La solidarité internationale a déjà une longue histoire, on peut s’inspirer de ses succès et éviter de reproduire ses erreurs. Quoiqu’il en soit, à défaut de guérir, on peut chercher à ne pas nuire. Identifier les besoins, prévoir les embûches logistiques, et agir avec le souci de l’autonomie de celui que l’on veut aider… Sans prétendre répondre à tout, ce guide explore les différentes formes du don et, à travers de nombreux exemples, cherche à savoir s’il est approprié ou non. Il permet de se poser les questions nécessaires pour tenter d’apporter une aide de qualité.
Donner de la nourriture ?
L’aide alimentaire est sûrement la plus ancienne des formes de solidarité. Qui pourrait en effet laisser son « prochain » mourir de faim s’il a de quoi le nourrir ? Aujourd’hui comme hier, les images de personnes qui ont faim restent parmi les plus choquantes. Plus de 850 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim et plus encore souffrent de malnutrition, alors qu’ici nos étalages débordent de produits alimentaires venant de tous les coins du monde. Une situation inacceptable à bien des égards. Pour y répondre, depuis les années 70, des programmes internationaux d’aide alimentaire se sont multipliés, mais ils sont loin de résoudre le problème. Leur efficacité est même très controversée. Quant à l’aide d’urgence, elle est une des plus délicates qui soit et ne s’improvise pas. Elle doit s’accompagner de nombreuses précautions, c’est pourquoi il est tout à fait déconseillé de collecter des aliments pour les envoyer dans un pays qui connaît une crise alimentaire, le remède pouvant être pire que le mal. D’autres alternatives existent pour lutter contre la faim.
« On peut être le deuxième exportateur de produits alimentaires et laisser mourir de faim des millions de personnes sur son territoire. C’est le paradoxe brésilien. »
Il y a assez de nourriture sur la planète !
Il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète, mais les inégalités, la pauvreté, les guerres empêchent d’y accéder. 75% des personnes qui ont faim sur la planète sont des paysans ! Des paysans qui n’ont pas accès à la terre ou qui sont appauvris par la libéralisation des marchés et la concurrence de l’agriculture intensive ou des grands propriétaires. On constate ainsi d’étonnantes situations comme celle du Brésil ou de l’Inde où des personnes souffrent de la faim alors que ces pays exportent des produits agricoles destinés au Nord. Il s’agit d’abord d’un problème de répartition des ressources, c’est pourquoi l’aide alimentaire peut être perçue comme une hypocrisie, voire une offense. Mgr Fragoso, en pleine famine dans le Nordeste brésilien, refusait l’aide européenne, qui pour lui n’était qu’un cache-misère d’une économie internationale, première responsable de cette aberration : « Si les pays qui nous exploitent et accaparent nos matières premières, ne nous laissant que des miettes, proposent de nous aider avec un programme alimentaire, c’est une injure et une offense à notre dignité. »
De nombreux clichés alimentent une générosité inadaptée, comme ceux de la fatalité, de la désertification, de pays victimes de catastrophes climatiques et de guerres tribales insensées… Connaître les causes de la faim est le premier pas d’une solidarité responsable et efficace.
Quand le don devient une arme
Très tôt dans l’histoire, la nourriture a été l’objet de tractations et de négociations non désintéressées entre les nations. Ainsi, affamer l’ennemi est une stratégie des plus classiques : depuis le siège de Troie dans la Grèce antique, jusqu’à ceux de Sarajevo ou de Kaboul, empêcher les populations de se nourrir est une arme très souvent utilisée. Aujourd’hui encore des embargos alimentaires sont utilisés pour faire fléchir des gouvernements, malgré les effets désastreux sur les populations civiles (Irak, Cuba…). Donner de la nourriture peut également être une arme car, contrairement à ce que l’on imagine, le don de nourriture n’est pas toujours généreux. Pendant la guerre froide, les grandes puissances ont fourni de l’aide alimentaire de façon stratégique aux camps qu’elles soutenaient.
Aujourd’hui, l’aide alimentaire peut, par exemple, soutenir les intérêts commerciaux d’entreprises agro-alimentaires. Ainsi la Zambie a subi de nombreuses pressions pour la forcer à accepter l’aide alimentaire états-unienne qu’elle refusait (ne voulant pas d’un maïs qui risquait d’être génétiquement modifié).
« Comme c’est l’Afrique, c’est loin, c’est la guerre, c’est exotique, tout élément de rationalité, d’analyse un peu lucide est abandonné au profit de grands discours sentimentaux. » Rony Brauman
Les politiques agricoles en cause
Depuis l’après-guerre, les politiques agricoles européennes comme états-uniennes ont des conséquences désastreuses. En effet, pour écouler leurs surplus agricoles, générés par l’agriculture intensive, les états les donnent ou les vendent à bas prix aux pays en développement. Cette solution pour s’en débarrasser semblait être en même temps une solution facile au problème de la faim. En réalité, cette apparente bonne action participe à la déstructuration des agricultures locales et à l’appauvrissement des paysans, car cette aide donnée ou vendue à bas prix sur les marchés fait concurrence aux productions locales.
Concurrence déloyale Lors de la grande sécheresse de 1974, des milliers de tonnes d’aide alimentaireont été déversées sur la Somalie alors que la vraie phase d’urgence était terminée et que les paysans essayaient avec peine de commercialiser leurs produits.
De nombreux effets pervers
En cas de crises alimentaires, l’importation d’aliments est parfois inévitable, mais elle doit rester exceptionnelle et nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs pour ne pas créer d’autres dégâts. Détournée au profit de forces armées, inadaptée aux conditions de vie et aux habitudes alimentaires, l’aide alimentaire est en effet loin d’être une panacée. Elle peut même être considérée comme un des principaux obstacles au développement. Pour beaucoup d’associations, il faut donc tout faire pour l’éviter.
République démocratique du Congo
En RDC, « les haricots fournis par l’aide alimentaire américaine se sont révélés difficiles à cuisiner, avec des temps de cuisson bien plus longs que les haricots locaux, surchargeant de travail les femmes et impliquant des temps de déplacements dans des zones non sécurisées pour aller chercher du bois. »
Une aide extrêmement technique
Pour que l’aide alimentaire soit réussie, il faut de nombreuses conditions qui sont rarement réunies. En situation d’urgence, les donateurs répondent trop souvent par « le geste du don » sans prendre en compte la réalité du terrain. Or, même en situation de crise, l’aide doit être particulièrement réfléchie. Il est essentiel de vérifier les disponibilités locales ou régionales. Il n’est pas souhaitable en effet d’importer du blé des Etats-Unis en Asie s’il y a du riz dans un pays voisin, ou du riz au Sahel s’il y a du mil dans une région proche. Très technique et coûteuse, l’aide alimentaire ne peut être réalisée que par des organismes spécialisés. Elle nécessite une logistique très importante (ponts aériens, camions, etc.) d’où la nécessité de ne transporter que ce qui est le plus adapté aux besoins. « Il faut tout faire pour raccourcir le plus possible les périodes durant lesquelles l’aide alimentaire est nécessaire, afin d’éviter la création de phénomènes de dépendance, de limiter l’intégration de l’aide au sein des stratégies de survie des populations. »
Les collectes en France ne sont pas destinées au Sud
À quoi servent les boîtes de sucre ou de riz qu’on laisse tous les ans à la sortie du supermarché ? Elles sont destinées à la Banque Alimentaire, créée en 1984, pour apporter de l’aide aux personnes qui souffrent de faim ou de malnutrition en France. Ces collectes alimentent notamment des épiceries sociales où les plus démunis peuvent s’approvisionner en denrées de base.
Quand le Sahel nourrit le Sahel
En Afrique sahélienne, près de 200 millions de personnes souffrent de la faim. Or, contrairement à ce que ces chiffres pourraient laisser supposer, le Sahel produit assez de nourriture pour nourrir sa population. De 1996 à 2000, la couverture des besoins alimentaires était de 89 % au Niger, 101 % au Mali et 105 % au Burkina Faso. Ces pays pourraient donc assurer presque entièrement la production d’aliments nécessaires à leurs populations. Mais le problème n’est pas qu’un problème de production, c’est aussi un problème de distribution.
Ainsi, il existe au Sahel des disparités régionales importantes avec des zones excédentaires et des zones déficitaires. Dans certaines zones, les stocks céréaliers se perdent, tandis que dans d’autres, les populations dépendent de l’aide alimentaire. Ceci à cause du manque d’échanges entre les régions (manque de moyens de communication et de formation des populations). Partant de ce constat, plusieurs associations, comme Afrique Verte ou l’Association des organisations professionnelles paysannes du Mali (AOPP) aident les groupements paysans à s’organiser pour mieux s’approvisionner et vendre leur production. Elle favorise la mise en place de relations commerciales « équitables » entre les différentes régions. Cela permet d’améliorer la sécurité alimentaire dans la zone mais aussi de redonner une dignité aux paysans, qui peuvent vivre de leur travail et ne plus dépendre de l’aide alimentaire.
Favoriser les agricultures vivrières au Sud
Les associations de solidarité internationale qui travaillent sur le long terme ne font pas de dons de nourriture. Elles privilégient la lutte contre la grande pauvreté et l’autonomie des populations ; l’appui aux communautés paysannes par le micro-crédit par exemple, pour créer de petites infrastructures de commercialisation, diversifier les cultures vivrières, acquérir des semences, des outils etc. ; l’appui à des mouvements paysans dans leurs luttes politiques pour des réformes agraires, l’accès à la terre, et la mise en place d’un système commercial international plus juste et plus durable (informations, pression sur les gouvernements lors de négociations internationales…).
Du riz pour la somalie
En 1992, lors de la guerre civile en Somalie, les ministres J. Lang et B. Kouchner ont appelé les écoles à collecter du riz pour venir en aide aux populations de ce pays. L’opération ultramédiatique « du riz pour la Somalie », a abouti à la collecte de milliers de tonnes de riz et réjoui enfants, médias et participants… Mais, suite à l’opération, les associations spécialisées ont dénoncé une aide inefficace (des riz aux temps de cuissons variés, détournement sur place etc.), et bien plus coûteuse qu’une aide financière directe. Depuis, on ne collecte plus de nourriture auprès des particuliers pour le Sud.
Quelques pistes pour faire autre chose
- Donner de l’argent pour financer des projets intégrés défendant la sécurité et la souveraineté alimentaires.
- Acheter les produits du commerce équitable pour que les producteurs du Sud puissent vivre de leur travail.
- Acheter des produits d’une agriculture durable pour soutenir cette forme d’agriculture plutôt que l’agriculture industrielle, exportatrice de produits à bas prix dans les pays du Sud.
- Participer à des campagnes contre la libéralisation du commerce des produits agricoles ou pour une nouvelle Politique Agricole Commune solidaire et durable.
Comment identifier les besoins ?
Trop souvent une ignorance des besoins réels entraîne des projets et des dons inadaptés. Avant toute collecte ou tout projet d’aide matérielle il faut se demander si le matériel correspond aux besoins et s’il est compatible avec les conditions de vie locales. À quoi bon envoyer un ordinateur si le village n’est pas relié au réseau électrique ou si personne ne l’utilise ? L’identification précise des besoins est indispensable, mais elle n’est pas aisée. On peut être allé sur place, avoir vu, juger avec ses propres critères et se tromper. Il faut notamment réussir à distinguer les besoins réels de besoins supposés. Cela prend du temps pour s’informer, rencontrer la population, les organisations locales et les organisations de solidarité déjà présentes. Du temps aussi pour se départir de ses certitudes et des stéréotypes qui les accompagnent très souvent.
Répondre à une demande
De nombreux projets de solidarité ne fonctionnent pas parce que les populations n’en sont pas à l’initiative. Pour avoir un impact positif, un projet doit répondre à une demande. Mais, il y a demande et demande. Beaucoup de petits projets sont réalisés sur la base d’une demande qui n’est qu’apparente. « Je suis allée au Sénégal, on m’a demandé des livres », « j’ai rencontré des gens, ils m’ont demandé de les aider ». Dans certains cas, la demande n’est pas formulée clairement. Dans le cas de livres par exemple, une organisation paysanne peut avoir besoin d’ouvrages techniques pour fabriquer du compost mais va se limiter à demander des livres. Si l’organisation du Nord ne creuse pas plus, elle pourra envoyer des choses totalement inutiles. Le plus souvent, la demande s’adapte tout simplement à l’offre escomptée. « L’on sait bien, (…) que si l’on demande simplement un budget pour mettre en place, par nous-mêmes, une gestion financière fiable du centre de santé, on n’aura rien ; alors que si on dit à l’ONG de nous envoyer des médicaments, on aura un colis dans les semaines qui suivent ». Les populations savent par expérience que les ONG du Nord préfèrent donner du matériel que de l’argent. D’un autre côté, les donateurs refusent souvent la critique, partant de l’idée que les bénéficiaires devraient déjà être bien contents de ce qu’on leur donne. Enfin, ceux qui reçoivent se sentent le plus souvent obligés de donner des gages de satisfaction pour ne pas froisser, et dans l’espoir d’obtenir une autre fois quelque chose d’utile. Autant d’éléments qui peuvent fausser le dialogue et rendre difficile la mise en place d’une vraie relation. Pour faire émerger une demande construite et adaptée, il est important de se mettre à l’écoute, de prendre le temps de comprendre ce que l’autre souhaite, sans imposer ses vues.
« Pourquoi a-t-on envoyé des tonnes de médicaments de marque en Asiedu Sud Est alors que cette région du globe produit la majeure partie
des génériques utilisés aujourd’hui dans les programmes humanitaires ? » Pharmaciens sans frontières
Les Dalles de N’djaména« C’étaient des gens d’une ONG américaine qui à force de passer sur le goudron de N’Djaména et des villages proches, voyaient des femmes sécher leurs gombos posés sur la route. Sans même causer aux femmes, ils sont allés faire des dalles de séchage derrière le village. Ils sont partis eux-mêmes construire les dalles. S’ils avaient seulement demandé aux femmes pourquoi elles faisaient sécher les légumes sur la route, elles auraient pu expliquer que cela leur permettait de surveiller le produit et de vendre en même temps des petites choses
à ceux qui passaient. J’ai trouvé que c’était vraiment se moquer des gens : on fait des choses sans leur demander (…). Jusqu’à aujourd’hui, les femmes n’utilisent jamais ces dalles-là. » Aminé Miantoloum, Association d’appui aux initiatives locales de développement, Tchad.
[…]
Donner des médicaments ?
L’accès aux soins et aux médicaments est loin d’être le même partout. Si 95 % des Norvégiens peuvent trouver à tout moment les médicaments essentiels, plus de 50 % des Géorgiens ou des Sierra Léonais n’ont pas cette possibilité. Entre 1,3 et 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès régulièrement aux médicaments essentiels pour cause de pénurie, de mauvaise distribution ou de prix trop élevés. L’état sanitaire de l’Afrique subsaharienne est le plus préoccupant. Le milieu rural où vit 75 % de la population est le plus touché car les revenus y sont trop faibles pour assumer les frais de santé et les infrastructures trop mauvaises pour évacuer les malades. Ces clivages s’accentuent : quand le Nord croule sous les médicaments (dont ceux qui ralentissent la chute de cheveux ou améliorent les performances sexuelles), au Sud on meurt de maladies devenues bénignes ou éradiquées ailleurs.
Un droit et des obstacles
La santé est reconnue par les Nations Unies comme
un droit. Dans la réalité, de nombreux obstacles fragilisent ce droit. Les conflits, épidémies, catastrophes naturelles ou industrielles ont évidemment des conséquences en matière de santé mais, le premier obstacle à la santé, c’est la pauvreté. La sous-alimentation, le manque d’eau potable fragilisent les populations et sont la cause de maladies dévastatrices (diarrhées, bilharziose, typhoïde…). Le manque de ressources des états rend difficile la mise en place de politiques de santé efficaces et la population doit souvent affronter seule les coûts des frais de santé. Par ailleurs, depuis 20 ans, l’épidémie du Sida touche de plein fouet les pays les plus démunis où les médicaments antirétroviraux restent hors d’accès pour la majorité des patients.
« Force est de constater que, près de 10 ans après la première parution des Principes directeurs applicables aux dons de médicaments, la qualité de l’aide humanitaire en ce qui concerne les dons de médicaments dans les situations d’urgence ne s’est pas améliorée. Elle s’est, au contraire, aggravée avec la multiplicité et la diversité des donateurs, surtout dans les crises très médiatisées. » Pharmaciens sans frontières
Albanie, 1999. 50 % des médicaments au moment de l’afflux des réfugiés kosovars étaient inadéquats ou inutiles et devaient être détruits. 4000 comprimés, 1200 flacons de perfusion, 16000 tubes de pommade étaient périmés avant d’arriver dans le pays. 2 millions de comprimés et 85 000 flacons pour injection étaient périmés avant la fin de l’année.
L’envoi de médicaments, une solution ?
Dans les pays où quantité de médicaments ne sont pas utilisés, quelquefois jetés avant d’être périmés, on peut se demander si ce qu’on n’utilise pas ne pourrait pas servir à d’autres. À partir de cette idée, se sont développées quantité d’associations qui collectent des médicaments et les envoient vers des pays du Sud. L’idée est séduisante, mais la réalité l’est moins, car le médicament n’est pas une marchandise anodine, et on ne peut s’improviser pharmacien sans risques.
Des dons qui coûtent cher !
Tous les pays n’ont pas les mêmes besoins sanitaires. Des médicaments courants dans les pays occidentaux peuvent s’avérer inutiles, voire dangereux ailleurs. De plus les médicaments donnés sont souvent inconnus des professionnels locaux. Il n’y a pas toujours de notice d’accompagnement et, lorsqu’elle existe, elle n’est pas forcément dans la langue du pays. Les emballages sont souvent inexistants et la date de péremption dépassée ou impossible à vérifier. Autant d’éléments qui rendent difficile voire impossible l’utilisation des dons. Ceux-ci sont souvent si inadaptés qu’une fois sur place, il faut les détruire, ce qui occasionne des frais importants. Les incinérateurs appropriés n’existent pas partout et, en construire coûte très cher. Éliminer les dons pharmaceutiques en Croatie et en Bosnie-Herzégovine a coûté plus de 4 millions de Dollars.
Enrayer l’afflux. Devant l’affluence de dons le Togo a pris des mesures pour enrayer l’afflux de médicaments et protéger son système de santé. Des sanctions pénales et financières sont prévues pour ceux qui ne respecteraient pas les modalités administratives du pays dans ce domaine.
[…]
Des dons qui alimentent les marchés illicites
Les dons, trop rarement faits en accord avec les services de santé locaux, n’ont pas toujours une destination bien assurée et vont alimenter des marchés parallèles. On trouve ces médicaments en petits tas, sur les marchés ou au coin des rues. Dans certains pays, ce marché noir peut représenter jusqu’à 60 % du volume de médicaments vendus. Non seulement cela fait concurrence aux médicaments nationaux, mais cela encourage l’automédication qui peut créer des résistances aux traitements. Par ailleurs, vendus sans contrôle, les produits ne respectent pas les normes de stockage pharmaceutique et peuvent s’avérer dangereux. Enfin, l’existence de marchés parallèles favorise la fabrication de produits contrefaits et de mauvaise qualité.
« Les médicaments de la rue, ça tue ! »
Dans la région de Kayes, à l’Ouest du Mali, arrivent quantités de médicaments envoyés par des associations d’immigrés, originaires de la région, qui pensent ainsi aider leurs compatriotes. Or, de nombreux villageois pensent que ces médicaments vendus dans de belles boîtes venues de France, sont plus efficaces que les génériques qui leur sont vendus par les centres de santé publique. Il arrive que les malades parcourent des kilomètres et dépensent leurs ressources pour se procurer ces « belles boîtes » qui correspondent pourtant rarement aux prescriptions du médecin et portent préjudice au fonctionnement des centres de santé du Mali.
Le Réseau Médicaments et Développement, association référence sur l’accès aux médicaments dans les pays du Sud, mène campagne sur les dangers de la vente illicite des médicaments. Elle informe sur les dangers de l’automédication et travaille à améliorer l’image du circuit formel et des médicaments génériques, trop souvent dévalorisés.
[…]
Des dons qui nuisent aux politiques locales
Dans les années 80, d’importants efforts ont été faits pour atteindre « la santé pour tous », mais la dette et la chute des matières premières ont eu raison des espoirs de l’époque. Face à la crise des systèmes de santé, 24 pays africains ont adopté en 1987 une stratégie, dite « de Bamako », visant à améliorer et surtout à financer les systèmes de santé. Cette stratégie se base sur l’abandon de la gratuité des soins. La majorité des pays s’est ralliée à ce principe qui fait participer les patients au financement des services de santé. Cela pose problème, notamment pour les plus démunis, mais cela a permis des avancées notables en termes de vaccination ou d’accès aux médicaments. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des directives de l’OMS qui prône l’utilisation des Médicaments Essentiels Génériques (des médicaments génériques adaptés aux pathologies et aux services de santé locaux), et la mise en place de Centrales d’achat nationales qui achètent ces médicaments en quantité afin de les rendre moins chers et accessibles au maximum de personnes.
Globalement, depuis 1990, tous les pays ont mis en place des politiques pharmaceutiques de ce type. Or, ce système ne peut fonctionner que si les populations fréquentent les centres de santé et s’approvisionnent dans les circuits publics. Donner des médicaments met en péril ces politiques et fragilise les systèmes de santé locaux, rendant les pays encore plus vulnérables.
Les principes de l’Organisation Mondiale de la Santé. Depuis 1996, l’OMS a édicté des principes directeurs applicables aux dons de médicaments afin de prévenir les effets négatifs des dons. Elle rappelle notamment que :
- « Les médicaments qui ont été délivrés aux patients puis retournés à la pharmacie ou à d’autres officines ou qui ont été distribués aux membres des professions de santé sous forme d’échantillons gratuits, ne devraient pas faire l’objet de dons. »
- « Tous les médicaments donnés doivent figurer sur la liste nationale des médicaments essentiels génériques ou, à défaut de liste nationale, sur la liste modèle OMS des médicaments essentiels. »
Charte complète sur www.culture-developpement.asso.fr
« Dans un contexte d’urgence où les ressources humaines, la capacité des infrastructures et la capacité logistique sont limitées, les dons de médicaments n’ont pas d’utilité : ils créent des problèmes supplémentaires de santé publique pour la population sinistrée et des problèmes économiques au pays qui devra assurer les coûts de leur gestion et de leur destruction. » Pharmaciens sans frontières
[…]
Un comble ! Les entreprises pharmaceutiques tentent de s’approprier les principes actifs des plantes en les brevetant. Elles pourront ainsi rendre payantes des ressources naturelles et, après avoir dépossédé les communautés de leurs savoirs traditionnels, elles leur vendront
des médicaments ! En 2001, Agir ici a organisé une campagne contre le brevetage du vivant.
Quelques pistes pour faire autre chose
- Soutenir des associations spécialisées Il existe des organisations formées et préparées à l’action d’urgence, qui possèdent des compétences professionnelles pour ces actions et qui agissent avec des « kits » sanitaires répondant aux besoins.
Mieux vaut soutenir ces structures que se lancer dans une collecte. - Travailler avec des partenaires dans des pays du Sud Des partenariats basés sur un soutien financier approprié peuvent permettre aux acteurs locaux d’acheter des médicaments dans les centrales d’achat du pays, d’organiser leur acheminement dans les zones défavorisées, de mener des campagnes de prévention, d’agir pour permettre l’accès à l’eau potable…
- Offrir des abonnements « Au Congo, il n’existe qu’un seul magazine médical et l’éditeur a du mal à se maintenir à flot. » L’association Médecins Sans Vacances offre des abonnements aux médecins qui pratiquent dans l’arrière-pays congolais
afin que ceux-ci n’aient plus à se contenter de leurs notes universitaires. - soutenir des associations locales travaillant à l’éducation sanitaire et à la prévention (campagne pour le préservatif, campagne de Remed contre l’automédication).
- Favoriser les médecines alternatives et les ressources locales
Soutenir l’étude et la protection des plantes médicinales locales, les médecines traditionnelles adaptées aux pathologies du pays, la création de jardins médicinaux, etc. Transmettre les savoirs locaux, préserver l’environnement et les plantes locales participe de l’autonomisation des populations et assure des soins moins coûteux, accessibles au plus grand nombre.
Les dons de médicaments peuvent, au contraire, renforcer une dépendance néfaste lorsqu’il existe des ressources locales. Pharmaciens sans frontières, ENDA Tiers Monde ou l’ONG Nomad-rsi, par exemple, soutiennent des projets qui renforcent l’autonomie des populations et améliorent la prévention, en développant la connaissance et l’usage des plantes médicinales locales.
[…]
Donner des ordinateurs ?
Le fossé entre le Nord et le Sud en termes d’accès aux nouvelles technologies est à la mesure des inégalités dans d’autres domaines. Le matériel informatique reste inabordable pour la majorité des habitants des pays du Sud. Moins de 7 % de la population mondiale a accès à Internet (3,2% de la population en Amérique latine et 0,4 % de la population en Asie du Sud ou en Afrique contre plus de 50 % aux Etats-Unis). Ces disparités sont d’autant plus dommageables que les nouvelles technologies sont désormais un enjeu de développement et qu’Internet est devenu un outil d’information essentiel. Ne pas y avoir accès peut vite devenir un handicap. Dans des pays occidentaux où le rythme de renouvellement des parcs informatiques est de deux ans en moyenne, de plus en plus d’associations s’orientent donc vers la récupération et l’expédition d’ordinateurs devenus obsolètes (ou simplement plus assez performants), pour en faire profiter ceux qui en auraient besoin ailleurs. Or, non seulement il n’est pas sûr que cela puisse être une solution mais par ailleurs, cela pose de graves problèmes environnementaux, surtout quand les dons ressemblent à des déchets non assumés.
Non aux vieux coucous !
« En Afrique, on peut tout réparer ! » Avec cette idée – en partie fondée – que le manque de moyens entretient la débrouillardise et l’art du recyclage, on pense trop souvent que l’on peut tout envoyer dans les pays pauvres, même des appareils qui ne fonctionnent plus. On imagine qu’il s’y trouvera toujours quelqu’un pour le réparer. Mais il y a des choses que même des doigts de fée ne pourraient réparer. Et, un ordinateur n’est pas un vélo ni une pendule, il faut des compétences techniques et une solide formation pour pouvoir « bidouiller ». Si, ici, avec les moyens financiers, la disponibilité des pièces et la maintenance dont nous disposons, nous ne pouvons rien faire, il y a peu de chances que d’autres, bien plus démunis, le puissent. Avant de donner un ordinateur, il est donc essentiel de vérifier qu’il fonctionne correctement mais il faut également le reconditionner : supprimer les données encore présentes et installer des logiciels. Il existe de nombreux organismes spécialisés qui peuvent prendre cela en charge.
Décharge des pays riches. L’accumulation de déchets informatiques, particulièrement polluants, a transformé la Silicon Valley, aux Etats-Unis, en dépotoir. Pour résoudre ce problème, les Américains n’ont rien trouvé de mieux que d’exporter ces déchets. Et l’Asie se transforme donc peu à peu en décharge de pays riches. Ce genre d’exportation « place les populations des pays pauvres devant un dilemme socialement inacceptable, choisir entre la misère et l’empoisonnement », dénonce la Silicon Valley Toxics Coalition, une ONG américaine. Le don d’ordinateurs usagés, même effectué avec de meilleures intentions, peut avoir le même type de conséquences.
Trop de pollution
Plusieurs millions de mètres cubes de déchets se promènent dans les lacs et rivières de la région de Guiyu, en Chine. Quelque 100 000 personnes y démontent de vieux ordinateurs pour récupérer ce qui peut l’être. La pollution est telle que l’eau potable doit être acheminée par citernes. La réputation de cette région surpolluée qui accueille les déchets électroniques du monde entier n’est plus à faire. Mais il existe de nombreux sites semblables à Karachi (Pakistan), New Delhi (Inde) ou Lagos (Nigéria). Selon l’ONG Basel Action Network (BAN) qui suit le trajet des déchets toxiques sur la planète, 500 conteneurs bourrés de matériel informatique de seconde main arrivent chaque mois à Lagos, essentiellement d’Europe ou des Etats-Unis. Environ 75 % de ces 400 000 machines iront à la poubelle. Or les émanations de leur combustion sont très nocives : elles peuvent provoquer des avortements chez les femmes enceintes qui vivent près des décharges.
Recycler chez soi !
L’illusion qui consisterait pour les pays riches à se débarrasser des vieux ordinateurs en rendant service aux Africains a fait long feu mais recycler un ordinateur coûtant environ 10 euros, certains préfèrent les donner plutôt que d’assumer ce coût ! Les pays de l’Union européenne sont signataires de la Convention de Bâle qui prohibe l’exportation de matières dangereuses, ce qui devrait permettre d’éviter ces exportations détournées de déchets informatiques ; mais les états n’exigeant aucun test du matériel avant export, cela reste plus théorique que réel. Donner un ordinateur ou du matériel électronique au lieu de le jeter peut donc s’apparenter à un transfert de déchet toxique. « En envoyant du matériel usagé dans le tiers monde, ne participe-t-on pas surtout à la croissance de l’énorme tas d’ordures commencé avec les vieilles voitures, les pneus lisses ou les frigos au CFC ? » Avant tout, il est urgent d’assumer nos déchets. Depuis 2005, une directive européenne oblige, en théorie, les fabricants à récupérer et à recycler leurs produits et interdit les exportations de déchets électroniques. Pour se préparer à cette loi, les grands fabricants informatiques ont commencé à utiliser des composants moins polluants et à mettre en place des circuits de reprise de leurs anciens équipements. Il existe encore de nombreuses lacunes dans le traitement des déchets électroniques mais dorénavant, les producteurs sont responsables et doivent assurer la collecte, la gestion et le financement de la dépollution et du recyclage.
Pas de transfert d’outils sans transfert de compétences
Au Bénin 30 % seulement de la population est alphabétisée et l’informatique n’est pas au programme de la scolarité. Beaucoup de circonscriptions restent sans courant et ne sont pas reliées au réseau téléphonique. Le matériel reçu, souvent des dons d’ONG ou des appareils d’occasion achetés en France, tombe fréquemment en panne, ce qui aggrave encore les difficultés.
Les ordinateurs, même en état de marche ne peuvent pas servir à tout le monde. Pour les utiliser il faut un minimum de formation. Dans de nombreux pays, le développement d’Internet se heurte en effet aussi à l’analphabétisme et au manque de formation. Donner un ordinateur sans transmettre les moyens de son utilisation, ne sert à rien. Tout don de matériel informatique doit s’accompagner d’un transfert de compétences permettant aux acteurs locaux, non seulement d’entretenir le matériel, mais aussi d’acquérir des compétences qui correspondent à leurs besoins.
Quelques règles
- S’appuyer sur le désir exprimé d’un destinataire identifié car envoyer un ordinateur, même neuf, à un village qui n’a pas l’électricité est aberrant.
- Réparer ou faire réparer l’objet avant de le donner.
- N’envoyer que des ordinateurs en état de recevoir des données et si possible de se connecter à Internet.
- S’assurer qu’un local adapté (suffisamment aéré, frais et sec), pourra accueillir le matériel.
[…]
Informatique durable.
Microsoft ou Linux ? Même en termes de logiciel, on peut avoir une réflexion durable. En effet certains logiciels coûtent très cher et supposent des mises à jour fréquentes (elles-mêmes coûteuses). Les logiciels libres, gratuits et produits de façon coopérative sont plus durables et plus adaptés quand on n’a pas les moyens de payer des licences.
Soutenir les usages collectifs
« On observe qu’il se développe un usage de l’Internet de la part de populations qui n’y ont pas accès. Des associations de développement, installées dans des villages qui n’ont pas le téléphone, communiquent via l’Internet. Soit elles se rendent dans la capitale, soit elles laissent un message à un chauffeur qui va en ville et envoie un e-mail, tout en relevant le courrier » selon Yam Pukri, à l’origine de l’ouverture de plusieurs cybercafés à Ouagadougou et Bobo Dioulasso au Burkina Faso (www.reciprocites.org). Dans de nombreux pays, les usages de l’informatique et de l’Internet ne sont pas les mêmes qu’en Europe ou aux Etats-Unis où l’usage privé est surdéveloppé. D’autres formules s’y développent. L’Afrique, par exemple, est le continent où se pratique le plus l’utilisation partagée. Les cybercafés ne cessent de se multiplier dans les villes, attirant un grand nombre d’utilisateurs. Et, dans le cadre de pratiques communautaires, le problème de l’analphabétisme peut être dépassé. Il se trouve toujours quelqu’un dans ces cybercafés pour taper les messages de celui ou celle qui ne sait pas écrire.
Cybercafés populaires. Au Sénégal, l’association Enda a installé des cybercentres dans les quartiers défavorisés de Dakar pour soutenir les initiatives de leurs habitants et dynamiser l’économie informelle. Ainsi les médecins traditionnels de Yeumbeul créent une base de données sur la santé et les plantes même de financer ce projet de cybercafés populaires. www.enda. médicinales ; et les femmes de pêcheurs de Pikine ont élargi leur clientèle aux delà des frontières du Sénégal grâce à Internet. L‘association a formé des écrivains publics aux principaux logiciels et la demande très forte permet sn/cyberpop.
Financer l’achat de matériel adapté
Mieux vaut financer l’achat d’ordinateurs neufs, adaptés à l’usage prévu sur place, que de donner de vieux modèles, mêmes réparés. D’autant que, depuis peu, il existe du matériel beaucoup plus adapté que nos machines aux contextes de pays pauvres. SoftComp, créé par une entreprise indienne, est présenté comme « l’ordinateur le moins cher et le plus simple d’utilisation au monde ». Il bat tous les records de prix et est accessible à tous. Il pourrait créer une révolution informatique dans les pays en développement. Très bon marché (moins de 180 euros l’unité), il est équipé de logiciels libres (modifiables à loisir et souvent gratuits, comme Linux). Il a été conçu pour les néophytes et la présence d’un système de reconnaissance vocale le rend même accessible aux analphabètes. Enfin, il ne nécessite que 8 watts pour fonctionner, un atout majeur pour des pays où les fluctuations de courant sont quotidiennes.
[…]
Des pistes pour faire autre chose
- Financer l’achat de matériel adapté au contexte
- Soutenir des projets renforçant l’usage collectif des ordinateurs
- Participer à des campagnes visant à diminuer la toxicité du matériel informatique
- Financer des formations
Le don, un déchet qui s’ignore ?
Après le tremblement de terre au Pakistan en 2005, une association a organisé une collecte, précisant qu’on pouvait tout donner : « même des choses usées, même des couvertures trouées ». Cela part d’un bon sentiment, celui de vouloir venir en aide à des victimes, mais la formulation peut choquer. Faut-il en effet tout donner ? Notamment, faut-il donner ce dont nous ne voulons plus, ce qui nous encombre, ce qui est abîmé, périmé, endommagé, dépassé ? Est-ce une bonne façon de manifester notre solidarité ?
Une grande partie des dons résulte de hasards, d’opportunités, d’occasions à ne pas manquer et n’est pas le résultat d’un projet concerté, réfléchi et mûri à partir d’une demande précise. De nombreuses collectes sont faites « à l’envers ». Elles ne partent pas d’un besoin auquel elles chercheraient à répondre, mais d’une occasion de récupérer des choses. Et ces effets d’aubaine sont en général précipités : « Il faut faire vite, sinon, ça part à la poubelle », « il faut débarrasser les locaux avant telle date ». Le « donateur » souhaitant être débarrassé le plus rapidement possible, les collecteurs n’ont souvent même pas le temps de trier pour identifier ce qui pourrait être utile. Au final, le don se trouve être une alternative à la déchetterie.
[…]
Privilégier la qualité
De nombreux dons inappropriés ou néfastes ont paradoxalement demandé beaucoup d’efforts, d’énergie, de motivation à ceux qui ont collecté, amassé, convoyé, couru après des financements, des sponsors, fait du porte à porte, insisté, argumenté, convaincu, pour réaliser leur projet. Malheureusement le plus souvent, la quantité est privilégiée aux dépens de la qualité. Les dons sont évalués en tonnes de matériel ou en nombre de camions nécessaires pour les convoyer, non en fonction de leur pertinence par rapport à une situation. Réorienter ses efforts vers une aide de qualité témoigne aussi de notre volonté d’aider.
Reconsidérer sa consommation ?
On peut être choqué par le gâchis gigantesque que génèrent les sociétés occidentales et révolté par la pauvreté qui existe par ailleurs, mais il n’est pas sûr que donner soit la solution pour lutter contre le gâchis et contre les inégalités. Peut-être faut-il se demander d’abord pourquoi nous pouvons nous permettre de gâcher quand d’autres n’ont pas le nécessaire ? À une époque où une grande partie de ce que nous consommons est produit ailleurs, payer les ressources naturelles et le travail à leur juste prix ne serait-il pas plus solidaire que de donner ce dont nous ne voulons plus ? Payer les choses à leur juste prix réduirait sûrement notre capacité de consommation, mais cela ne serait-il pas une façon efficace de lutter contre le gâchis ?
[…]
Donner des vêtements ?
Vêtements, le don qui s’achète….
Un des gestes de solidarité le plus ancré dans les comportements est d’aller chercher dans son armoire des vêtements ou des couvertures « à donner ». Un geste qui s’inscrit dans une longue tradition et qui peut faire des heureux. Mais, cette forme de don semble plus utile à faire du rangement dans ses propres affaires qu’à soulager la misère d’autrui… Surtout, elle alimente souvent un réseau commercial loin d’être philanthropique.
Jeté ou vendu
Le don de vêtements constitue encore la majeure partie des dons en nature. Pourtant, il a quelque peu perdu son sens et il est bien illusoire de penser qu’il puisse être une aide directe aux démunis du Sud. En effet, ces dons ont aujourd’hui deux grands débouchés : ils sont jetés ou revendus ! La majorité est jetée ou transformée en chiffons pour l’industrie. Le meilleur est vendu en Europe à des fripiers ou au grand public. Le reste est vendu dans des pays du Sud !
De mauvaise qualité
Une enquête réalisée en Belgique montre que la fripe n’est plus ce qu’elle était. Si la quantité augmente car les gens changent de plus en plus souvent de vêtements, ce n’est pas le cas de la qualité. Car production de masse et habitudes de l’éphémère font que la qualité des vêtements portés au Nord a considérablement baissé. Cela accroît le travail du tri mais pas les résultats car la part « récupérable » n’augmente pas. Une grande partie inutilisable est donc détruite. L’association belge Les petits riens, qui pratique la collecte en Belgique utilise moins de 1 % des 3000 tonnes récoltées par an. 20 % sont évacuées en décharge, 30 % deviennent des chiffons, 10 % sont vendus dans des magasins en Belgique et le reste à des opérateurs privés qui exportent vers l’Afrique. En France, seuls 7 à 10 % des 160000 tonnes de vêtements que nous donnons chaque année aux associations caritatives sont distribués dans des vestiaires associatifs, 50 à 60 % sont détruits.
« La rupture avec la seule logique de l’aide impose que la solidarité soit construite sur deux piliers : d’une part la reconnaissance de l’Autre, de son autonomie, de ses capacités, de ses projets, et d’autre part la remise en cause des comportements, des structures, des modes de vie chez nous renforçant les inégalités. » CRID, les cahiers de la Solidarité, 1998
« La friperie ne date pas d’hier. Les rebuts des armées napoléoniennes avaient déjà à l’époque une seconde vie dans les colonies. » Sabrina Kassa
Un circuit de plus en plus commercial
À partir du moment où le don passe dans un conteneur ou entre les mains du bénévole d’une association de récupération, il entre dans les rouages d’une véritable économie de la seconde main ! Depuis plusieurs années, en effet, les associations caritatives ne sont plus seules à s’intéresser au vêtement d’occasion. La fripe est devenue un business qui connaît recherche de rentabilité et délocalisations ! « Nous trions selon 180 catégories différentes, selon le type de vêtement, la matière, la destination du vêtement... Ce tri ne peut se faire qu’à la main. La rentabilité de l’activité est assurée par la revente des vêtements de bonne qualité dans les magasins de seconde main en Europe »18. Pour les opérateurs commerciaux, spécialisés dans l’exportation de fripes, l’activité est de moins en moins rentable, d’autant qu’elle est concurrencée par la production à bas prix venue de Chine. Le tri est alors délocalisé vers des pays où la main d’œuvre est moins chère.
Au Sud, le petit tailleur se retrouve sur le tapis
« Soulevez, jetez », c’est le nom donné aux fripes par les Kinois (les habitants de Kinshasa), pour illustrer le geste des clients qui fouillent dans les étals de seconde main. Et il y a de quoi faire car ce sont des mètres cubes de ballots qui envahissent le continent. En 2001, l’Union Européenne a exporté environ 595 000 tonnes de fripes dont 310000 vers l’Afrique. Triées à leur arrivée, les fripes sont, une seconde fois, vendues à des petits détaillants ou à des colporteurs qui iront dans les villages reculés. « Si vous tombez sur de la bonne qualité, un ballot d’habits vous rapporte 10 fois plus que le salaire mensuel d’un enseignant dans une école » témoigne une femme qui s’est lancée dans l’activité. La fripe génère de nombreux emplois informels et supprimer la friperie en Afrique reviendrait à supprimer des centaines de milliers d’emplois. Mais ces créations d’emplois très précaires se font au détriment de la confection locale, déjà malmenée par la concurrence internationale. Dans toute l’Afrique, ces importations massives mettent au chômage tailleurs et couturières. 7000 tonnes de vieux vêtements provenant de dons sont importées chaque année au Sénégal. Cela représente une concurrence insupportable pour les producteurs locaux. Même les tailleurs confectionnant des vêtements occidentaux ne résistent pas à la concurrence de vêtements qui peuvent être vendus à très bas prix puisqu’ils proviennent de dons. « La fripe est vendue à un prix en dessous de la valeur de la matière première, sans parler du travail… C’est une catastrophe pour tout le secteur de la confection. »
Une mode de seconde zone
La fripe a également un impact culturel non négligeable. Beaucoup y cherchent en effet des restes du « luxe occidental ». Mais d’autres s’insurgent : « à quoi ça sert de valoriser des vêtements occidentaux, alors que nous avons ici des centaines de couturiers au chômage qui auraient pu créer une élégance à la congolaise ! »21. Sans vouloir maintenir à tout prix des habitudes, il est fort regrettable d’uniformiser ainsi les habitudes vestimentaires, au détriment de la diversité.
Ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul
« Pour un poste créé dans les pays industriels dans le ramassage et le recyclage des vêtements, dix sont perdus dans les pays en développement ». Selon le secrétaire de la Fédération internationale du textile, « les organisations humanitaires exportent de la pauvreté » ! La Fédération dénonce régulièrement les fripiers de Grande-Bretagne qui emploient même de la main-d’œuvre immigrée clandestine22. Un grand nombre de ces travailleurs sont originaires du Pakistan, où la fermeture de leur usine de textile les a mis au chômage. Certaines associations caritatives du Nord ont pris conscience du paradoxe de cette situation. Ainsi, le Secours Catholique, qui a été interpellé par son réseau sur les effets néfastes de ce commerce tente de prendre en compte ce problème : « Du coup, depuis quelques années, nous réduisons la collecte de vêtements »23, mais ce n’est pas facile car les images d’Épinal ont la peau dure.
Renforcer l’économie solidaire
Le don de vêtement n’est pas toujours mal utilisé. Certes, il ne sert pas souvent à habiller les victimes de catastrophes, mais des associations continuent à l’utiliser pour des projets d’insertion sociale. Et certaines comme Emmaüs ont développé une véritable démarche éthique. Avec d’autres (Secours Catholique, Secours Populaire, etc.), l’association adhère en effet à une Charte nationale du don de vêtements afin d’en garantir « la finalité sociale et humanitaire ».
Cette charte, « Vêtements, tissons la solidarité » engage ceux qui y participent à respecter un certain nombre de règles pour contribuer à la création d’emplois au Nord pour des personnes en difficulté et à utiliser toutes les possibilités de recyclage existant au niveau local et national « afin de limiter la part des exportations qui ne correspond pas aux besoins réels des pays destinataires ». En cas d’exportations, les adhérents à la Charte s’engagent à ne pas « perturber l’équilibre économique fragile des pays destinataires », à constituer « des stocks de bonne qualité », et à ne livrer aux associations « que des vêtements répondant aux besoins des populations » ; enfin, à nouer des partenariats dans les pays importateurs en priorité avec des organisations « ayant pour objectif la promotion de la personne humaine ». En dehors des structures qui adhèrent à cette Charte, le don de vêtement est déconseillé.
[…]
Fripe occidentale. En Afrique, « tout le monde porte de la fripe, les pauvres comme les riches », car les bas prix et l’attrait des marques en font une des sources principales de l’habillement. Ce qui fait que le vêtement le plus courant est bien le jean et le tee-shirt venus d’Europe ou d’Amérique. Au Cameroun, le prix du ballot varie de 30 000 à 500 000 FCFA (46 à 762 euros).
À Madagascar, on trouve aussi bien des costumes pour hommes à 57 euros que des articles à 0,35 euros pour les plus démunis. En Inde arrivent les « lourds » : cabans, manteaux qui n’intéressent pas l’Afrique. Les fibres sont effilochées pour en faire des tapis.
Importations interdites. En 1971, au Cameroun, l’interdiction des importations de fripes a permis de recréer plus de 15 000 emplois dans la confection. Malheureusement, depuis 1992 les pressions en faveur de la libéralisation de l’économie ont contraint le pays à autoriser à nouveau ces importations. Au Zimbabwe, qui était un grand producteur de coton, 20 000 ouvriers du textile se sont retrouvés au chômage après l’ouverture aux importations de fripes. Pourtant… l’Afrique produit un des meilleurs cotons du monde.
Quelques pistes pour faire autre chose
- Donner à des associations qui ont signé la Charte « Vêtements : tissons la solidarité ».
- Vendre vos vêtements passés de mode dans un vide grenier et financer d’autres types de projets avec l’argent collecté.
- Acheter des vêtements du commerce équitable ou issus de coopératives de femmes d’un pays du Sud par exemple. Vous participerez ainsi au maintien d’une activité artisanale, à la diversité culturelle et à l’autonomie de chacun !
- Soutenir des campagnes pour une culture durable du coton.
[…]
Les ambiguïtés du don
« Le don n’est autre que la vie, comme la condition nécessaire d’une participation effective au monde. » G. Berthoud
L’homme a un besoin fondamental de donner, au point qu’on a pu voir dans l’obligation de « donner, recevoir et rendre » un des socles des sociétés humaines. Le vrai besoin est au fond celui de donner et non d’accumuler, car en donnant, nous nous posons comme humain. Contrairement à ce que l’on voudrait quelquefois nous faire croire, nous ne sommes pas que des êtres calculateurs, nous avons besoin de donner et d’être généreux car c’est une façon de s’estimer soi-même et d’être reconnu des autres. Nous n’avons pas besoin que de biens matériels et « sans cette reconnaissance qui fournit les bases de la dignité et de l’estime de soi, nous ne saurions vivre. »
La violence du don
La main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Proverbe africain
Le don n’est pas le lieu de l’innocence bienheureuse, il est conflictuel et chargé de violence. Dans un célèbre Essai sur le don, Marcel Mauss, un des pères de la sociologie, décrit ce qu’il appelle le don de rivalité où différents groupes se donnent leurs richesses dans une sorte de défi permanent. Celui qui reçoit étant dans l’obligation de rendre toujours plus, dans un cycle infernal allant jusqu’à la destruction des biens. Le don est violent car il rend l’autre redevable et crée une dette qui doit être acquittée. « On perd la face à jamais si on ne rend pas ». Par ces dons, les hiérarchies s’établissent, car donner est une façon de manifester sa supériorité alors qu’accepter sans rendre, c’est se subordonner, devenir client, serviteur.
Don et réciprocité
« C’est en mettant l’autre au défi de rendre qu’on le reconnaît comme participant d’une commune humanité. » Alain Caillé
Il n’y a pas de générosité pure, dégagée de plaisir égoïste ou d’attente de retour. Mêlant besoin de reconnaissance et souci de l’autre, gratuité et prise de pouvoir, le don est fondamentalement ambivalent. Dans de nombreuses langues, le même mot signifie don et poison, il est à la fois ce qui fait vivre et ce qui tue. Recevoir un cadeau, se retrouver endetté, c’est être menacé dans son existence d’homme. Et certaines formes de don sont, selon psychologues et anthropologues, proprement déshumanisantes. Le « don d’orgueil », qui atteste de la puissance de celui qui donne, mais aussi la charité, la bienfaisance, toutes les formes d’assistance qui créent de l’humiliation et de la domination en faisant de l’autre un assisté, incapable de rendre, brisent celui qui reçoit en blessant son amour-propre. Celui qui reçoit l’aumône a une dette qu’il ne peut acquitter. Les pauvres ou les victimes, avec qui on ne partage rien, et que l’on couvre de dons anonymes, peuvent y perdre leur dignité en se voyant dénier leur capacité à rendre. Pour certains même, le don caritatif reste colonial, continuant à affirmer la supériorité des uns sur les autres.
Don et reconnaissance
Le don n’est pas à rejeter, il est fondamentalement nécessaire, mais à condition d’avoir conscience de son ambivalence, de s’interroger sur la position de celui qui reçoit et de chercher le point d’équilibre entre reconnaissance de soi et reconnaissance d’autrui. À travers les rites liés au don, ce que l’on a découvert, c’est l’obligation universelle du contre-don : la nécessité fondamentale pour chacun de rendre à hauteur de ce qu’il a reçu. Le don véritable est donc aussi éloigné du sacrifice qui écrase, que de la charité qui méprise, il laisse à l’autre la possibilité de re-donner pour affirmer sa dignité et son appartenance à la communauté des humains.
Don ou redistribution ?
De même que la bienfaisance a pu être critiquée car elle semblait servir à faire oublier l’inégalité fondamentale des sociétés, la solidarité déployée au niveau international pose question quand elle n’interroge pas le fondement des inégalités Nord/Sud. Pour sortir de l’ambivalence du don, il peut être utile de se demander d’où proviennent les biens donnés et ce qui fait que certains ont le pouvoir de donner ? Pour que chacun soit mis en position de donner, il faut que les biens soient équitablement répartis et les richesses redistribuées. Être généreux ne dispense pas de réclamer la justice. Si certains ne peuvent vivre de leur travail, si l’organisation politique et commerciale internationale ne cesse de fragiliser les uns et de renforcer les autres, donner peut-il encore avoir un sens ?
Une dette, une plaie et le feu ne doivent pas s’éterniser. Proverbe indien
[…]
Du don au partenariat
Les échecs générés par des projets inadaptés aux réalités locales, l’expérience et la remise en cause de certaines certitudes ont beaucoup modifié les relations entre associations du Nord et du Sud depuis trente ans. De nombreuses associations ont réalisé que les populations restent les mieux placées pour savoir ce qui leur est nécessaire. Elles sont donc passées d’une certaine forme d’assistanat à la co-responsabilité et à la réciprocité.
Le partenariat se construit sur : la confiance réciproque qui suppose du temps pour la construire ; la transparence, notamment financière et l’information mutuelle ; la connaissance de ce que chacun peut apporter (compétences, moyens…) ; l’engagement dans la durée ; des engagements mutuels et des responsabilités claires traduits dans une charte ou un contrat.
Partir des initiatives locales
Même dans les situations d’urgence, il existe sur le terrain une société civile qui organise les premiers secours et continue à agir après le départ des associations étrangères. Sa connaissance du terrain est irremplaçable, et il est illégitime et inefficace de prétendre agir sa place. « Les associations étrangères d’urgence mettent trop souvent en place leurs propres programmes comme si elles débarquaient en terrain vierge. Les acteurs locaux souhaiteraient, quant à eux, que les organisations étrangères appuient les initiatives et structurations en cours. »52 De même pour les actions de développement ou de lutte contre la pauvreté, les premiers acteurs sont les acteurs locaux qu’il ne s’agit pas de remplacer mais de soutenir.
Un comble ! Certaines victimes de catastrophes ont été utilisées comme « sous-traitants » par des ONG étrangères. En Indonésie, la fédération nationale de mouvements paysans a ainsi dénoncé le fait que les populations « bénéficiaires » de l’aide n’ont été « associées aux activités de reconstruction qu’en tant que main-d’œuvre d’exécution. »
Tisser des liens
Trop souvent le don intervient avant que les gens aient pris le temps de se connaître, de se comprendre. Seul un « travail-ensemble », sur un pied d’égalité peut aboutir à une véritable relation et permettre une solidarité efficace. Cela suppose de se défaire de ses présupposés, d’être à l’écoute mais aussi de mettre en place des règles à respecter des deux côtés.
Les ONG de la première génération (celles qui ont vu le jour dans les années 60) ont progressivement compris que c’était aux populations du Tiers-monde de s’organiser elles-mêmes sur place pour concevoir et exécuter leurs propres projets.
Définir les priorités en commun
Les projets établis de l’extérieur sont en général le reflet des priorités de celui qui donne, non de celui qui reçoit. Le partenariat suppose de collaborer dès la définition des priorités. « Je me suis dit que pour démarrer des actions dans les villages, il ne faut pas y aller avec des programmes pré-établis. Non ! Ces programmes-là n’intéressent pas les populations parce qu’ils ne touchent pas leurs priorités. C’est pour cela que le Graif [ notre organisation] part des situations vécues par les gens, et pas de leurs besoins [supposés]. On chemine avec eux et au fur et à mesure qu’ils trouvent la nécessité de participer à un programme d’alphabétisation ou de gestion, alors seulement nous intervenons. »54
Voisins Mondiaux, Mali
Une opération ratée. « J’ai été récemment en contact avec une association, Afrique Tandem, composée de jeunes, nés de Maliens résidant en France. Ils souhaitaient faire parvenir des livres aux élèves maliens. Ils avaient fait du porte-à-porte en France : les gens sont allés chercher dans leur grenier et ont donné, souvent de bon cœur, des livres, parce qu’on a leur dit « les enfants du Mali n’ont pas de livres ». Ils avaient ainsi collecté plusieurs milliers de livres et les ont envoyés au Mali. Ils ont pris contact avec moi lorsque ces livres étaient en transit, à Bamako, parce qu’ils n’avaient plus d’argent pour financer les frais de douane. […] Dans un premier temps, j’avais décidé de ne pas m’impliquer dans cette opération, n’ayant pas été consulté à l’origine du projet. […] Je n’ai pas voulu décourager ces jeunes, et j’ai même eu une séance de travail avec leur responsable à Paris. Je l’ai fait par humanisme, parce qu’en réalité, ce n’était pas une opération réussie. » Modibo Bah
Partager les responsabilités
La commune d’Essakane, habitée par des nomades touareg, a signé un contrat pour la construction d’un puits, équipé d’une pompe qui fonctionne avec un panneau solaire. Le village a été associé à chaque étape, de la prise de décision à l’exploitation. Même le financement du forage est partagé. Une partie est prise en charge par la commune et les familles : cela permet d’assurer la maîtrise du projet par les premiers intéressés. Ce type de coopération est de plus en plus prisé. L’association Eau Vive qui développe l’accès à l’eau dans des villages sahéliens, n’intervient que lorsque les villageois contribuent financièrement au projet et assument des responsabilités essentielles, comme le choix de l’entreprise car, à terme, ils doivent prendre seuls en charge l’entretien de ce puits. Une façon de reconnaître la capacité des autres à se prendre en charge.
« Si on part des initiatives déjà en cours et menées par les femmes elles-mêmes, je crois que ça ne peut que favoriser et contribuer à améliorer leur dynamique. » Joséphine Ndione, Sénégal
Evaluer
Un véritable partenariat suppose du temps passé à évaluer la qualité du projet pour le faire évoluer si nécessaire. Il suppose également le respect, par chacun, des engagements pris. Une relation de partenariat nécessite donc que soit consacré du temps à discuter, négocier, débattre.
« Chacun des partenaires assume le suivi de ses propres activités, et l’autre respecte cette autonomie, à condition que les résultats des deux contrôles soient disponibles et transparents. » Bernard J. Lecomte
Partager les objectifs
« On doit accepter d’instaurer un dialogue fréquent, permanent,
de s’asseoir à chaque fois que c’est nécessaire. » Mme Ndeye Sarr
Le partenariat est une association en vue de mener une action commune. Le partenariat ne prétend pas se substituer aux initiatives locales et se propose au contraire de les appuyer. Il s’inscrit dans une vision de la solidarité internationale, qui vise à renforcer la participation des sociétés civiles, pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi une transformation de leurs sociétés pour plus de justice sociale et de respect de leur environnement. Une lutte que chaque citoyen doit mener sur son propre terrain, au Nord comme au Sud, pour construire un monde plus équitable et plus harmonieux.
Un article de Julien Rémy et Alain Caillé fait écho à ces pages du guide de RITIMO : « Nous vous demandez pas ce que vous pouvez-faire pour l’Afrique »
