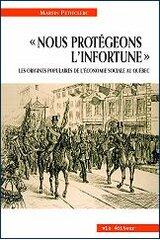
« Nous protégeons l’infortune ». Les origines populaires de l’économie sociale au Québec
VLB Editeur, Montréal, Québec, 278 p., 2007.
Un ouvrage consacré aux origines populaire de l’économie sociale au Québec qui s’ouvre avec une longue citation de l’Essai sur le don et s’achève par un plaidoyer polanyien pour une économie plurielle, ne peut pas être fondamentalement mauvais. Il peut même être excellent. Et tel est bien le cas de ce beau livre d’histoire sociale à la E.P Thompson, rédigé à partir de sa thèse par un jeune professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal.
« Nous protégeons l’infortune », telle était la devise de l’Union Saint-Joseph, l’une des plus importantes sociétés de secours au Québec, fondé en 1851. Cet ouvrage nous en raconte d’abord l’histoire, avec toute la rigueur, dans le travail méticuleux sur archives, de l’historien. Mais son ambition est bien plus large encore. L’auteur propose en effet d’étudier la mutualité au Québec comme un « fait social total », selon la formule et à la manière de cet illustre militant socialiste des coopératives ouvrières françaises que fut Marcel Mauss. Or cela suppose déjà de rompre avec une mauvaise habitude de l’historiographie dans ce domaine. Comme l’auteur le rappelle, celle-ci tend trop souvent à réduire la mutualité à une organisation transitoire, sans intérêt et pertinence propres, vouée à son dépassement nécessaire, soit sous la forme de la seule organisation ouvrière authentique et conforme à ses intérêts de classe - la forme syndicale - soit comme prologue amateur et brouillon aux services économiques professionnels offerts par les dispositifs assurantiels au 20ème siècle. Contre cette double réduction, l’auteur souligne la nécessité de saisir la mutualité dans sa totalité en renouant ce que cette historiographie dominante tend à dissocier, à savoir le lien profond qui unissait les activités économiques de ces sociétés et la culture de solidarité sur lesquelles elles reposaient. Bref de les appréhender comme une expression pionnière d’une « économie solidaire » ou même d’une « démocratie participative » où, au travers d’une « rationalité mutualiste » autant singulière que cohérente se manifesterait une vision authentiquement populaire de la question sociale. Dans cette perspective, l’originalité de la réponse mutualiste aux problèmes sociaux dans la seconde moitié du 19ème siècle reposerait précisément sur l’effort conscient d’encastrer les activités économiques de l’association dans une culture d’entraide fraternelle.
Cette thématique polanyienne précieuse de l’encastrement - puis du désecanstrement - constitue le fil directeur de ce travail. Il permet de mettre en lumière et de contraster avec force les deux formes historiques et successives de la mutualité au Québec, la « mutualité pure » et la « mutualité scientifique », de type actuarielle. Et ainsi et surtout de saisir les enjeux et les raisons de l’éclipse de la première au profit de la seconde pour enfin problématiser d’une façon originale la (ir)résistible marche vers la société assurancielle. L’analyse de cette « mutualité pure », pionnière puis défaite est passionnante. En éduquant ses membres, en s’occupant des chômeurs, mais aussi des orphelins et des veuves, en rendant visite aux malades ou en organisant les funérailles des membres décédés, ces sociétés remplissaient concrètement pour l’auteur une fonction de « famille fictive », au sein de laquelle chaque associé pouvait trouver « une nouvelle mère, un père, des frères ». En dépit d’un certain exclusivisme inhérent à la fraternité mutualiste, cette parenté fictive ne saurait pour autant être interprété comme un repli communautaire et conservateur. En effet les sociétés de secours mutuel ont su déployer, en mobilisant ces ressources communautaires, des activités proprement modernes : couverture des risques du salariat, gestion démocratique des associations. La modernité paradoxale de la mutualité est parfaitement exposée par l’auteur. En effet, contrairement à l’assurance (ou à l’épargne), la mutualité n’a jamais constitué une simple protection économique contre les aléas de la vie. Si le développement de l’assurance des personnes a suscité tant de résistance dans le monde ouvrier, c’est avant tout parce qu’elle soumettait le domaine « sacré » de la vie à des considérations marchandes. Or, précise Martin Petitclerc, en un certain sens, la mutualité faisait exactement l’inverse : « elle soumettaient les considérations marchandes à sa morale des rapports sociaux, le fraternalisme (…) elle visait à prendre en charge la vie humaine dans sa totalité, en refusant d’isoler la dimension économique des dimensions sociales de la vie ». En ce sens, parce qu’elle s’appuyait sur des rapports concrets de réciprocité, elle ne peut pas être assimilée à un simple prolongement de l’éthique libérale de la responsabilité individuelle ou de celle de la responsabilité collective prônée par les promoteurs de l’assurance.
Pour l’auteur, si les sociétés de secours mutuel ont eu un tel succès auprès des classes populaires, ce n’est pas seulement en raison de la qualité des prestations qu’elles offraient à leurs membres, c’était aussi parce qu’elles étaient le seul remède à la question sociale que les ouvriers pouvaient contrôler et même administrer directement. Contre la double humiliation de la charité privée et de l’assistance publique, se dévoilent avant tout dans ces pratiques à la fois le sens et la prégnance de « l’économie morale », de l’éthique de la mutualité propres aux classes populaires - traduite notamment dans le principe de la cotisation égale pour tous et non de la prime graduée aux risques - ainsi que leur exigence de faire leurs affaires eux-mêmes (d’où la quête d’autonomie, difficile, à l’égard des élites et de l’Eglise). L’encastrement des activités économiques dans une culture d’entraide mais aussi dans une pratique très exigeante de la démocratie participative constitue ainsi la caractéristique essentielle de la mutualité pure. Cette dimension politique de la mutualité est parfaitement étudiée par l’auteur. Il rappelle ainsi qu’à la différence des primes d’assurances, le paiement des cotisations ne suffisait pas à avoir droit aux bénéfices. En effet, il devait être accompagné d’une participation active aux activités associatives. Cette participation souvent obligatoire, sous peine d’amendes, et fortement ritualisée, devait ainsi manifester pratiquement la solidarité et l’engagement de ses membres, renforçant par là leurs liens mutuels et assurant la diffusion pratique d’une véritable « culture démocratique » dans les classes populaires. En ce sens, la démocratie, pas plus que le principe de la cotisation égale, ne constituait une simple technique de gestion mais le prolongement de cette culture populaire de la réciprocité.
En montrant à la suite de l’ouvrage en quoi, à terme, l’assurance va conduire à un désencastrement total de l’économie et du social à l’intérieur des sociétés de secours mutuel, et par là à une dégradation utilitaire du vieil objectif d’entraide concrète, à une « sérialisation de la solidarité » et à une dépolitisation de la question sociale, l’auteur souligne parfaitement en quoi le destin singulier de la mutualité au Québec participe d’un mouvement voire d’un basculement plus général. Car c’est bien cette morale, cette économie et cette politique du don (et de la réciprocité) qui progressivement se voit défaite. Mais tout l’intérêt de la thèse est de montrer que cette défaite, et donc cette victoire du schème assuranciel à travers d’abord la « mutualité scientifique », n’allait pas de soi, ne relevait pas de simples contraintes de techniques ou de gestion et ne s’est pas opérée sans résistance. L’analyse marxienne, du Marx historien du 18 Brumaire dans son étude du rôle de la petite-bourgeoisie, est éclairante ainsi que les critiques, souvent trop implicites, adressées aux approches canoniques de la naissance de l’Etat-Providence.
Car, et c’est le sens sa conclusion, on aurait tort de trop insister sur la continuité entre la mutualité et l’Etat-Providence, la première, sous une forme un peu brouillonne, amateur et idéaliste, annonçant le second. C’est en quelque sorte la thèse de Polanyi. Or, pour l’auteur, « l’optimisme de Polanyi dans les années 40, qui voyait dans la mise en place de l’Etat-Providence une « grande transformation » qui réaffirmerait après un siècle de folie libérale, la primauté du social sur l’économie, semble aujourd’hui empreint d’une relative naïveté ». En effet, ce compromis d’après-guerre, indexant en quelque sorte la protection sociale sur la croissance économique, relevait-il véritablement d’un projet solidaire et d’une réelle tentative de réarticuler les rapports entre l’économique et social ? Petitclerc ne le croit pas et la crise des années 1970 nous aurait clairement montré combien l’extraordinaire puissance du marché, fut en quelque sorte camouflée, pendant un temps, derrière la croissance de l’Etat-Providence. Cette hypothèse de discontinuité, certes critiquable notamment au regard de l’histoire française de l’assurance sociale, est néanmoins parfaitement féconde dans le contexte de crise de cet Etat-Providence. Elle permet notamment de saisir toute la portée de la constellation contemporaine de l’économie solidaire ou plurielle tant elle renoue, elle, avec cette volonté profonde de la « mutualité pure » d’une démocratisation d’une société soumise au marché et de son ré-encastrement dans une culture du don et de la réciprocité.
A lire également, sur ce site, un article de Martin Petitclerc, « Les origines populaires de l’économie sociale au Québec : de l’encastrement à l’utopie ».
